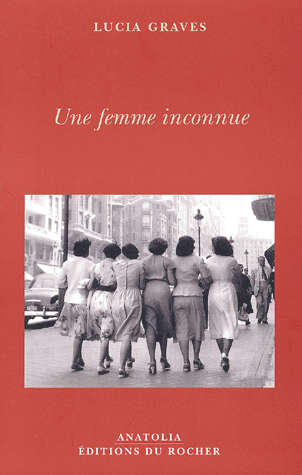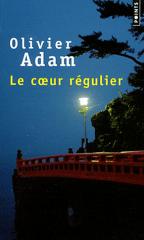Ces derniers temps, les livres m’emmènent en Asie, cette fois pour un véritable récit de voyage de Vita Sackville-West avec son époux, Harold Nicolson, diplomate en poste à Téhéran. Une aristocrate en Asie (1928) est le « récit d’un voyage en pays bakhtyar, dans le sud-ouest de la Perse ». Il lui a fallu du temps pour « extraire un livre de ce voyage », mais « il est nécessaire d’écrire si on ne veut pas que les jours s’écoulent en vain ».

Vita Sackville-West - Lady in a red hat, William Strang, 1918
En préparant leur itinéraire à l’aide de cartes lacunaires et d’une « poignée de lettres » évoquant les difficultés et les dangers de la route bakhtyar, ils sont persuadés de posséder une énergie et une résistance suffisantes pour entreprendre ce voyage. Les nomades Bakhtyari ne disposent pas d’une route à proprement parler, même s’ils le prétendent ; il s’agit d’une piste, voire d’un sentier qui monte et descend tour à tour « dans une région sauvage et montagneuse ». Ils sont cinq Occidentaux à se lancer dans l’aventure, le couple accompagné de Gladwyn Jebb, Copley Amory (de la légation américaine à Téhéran) et Lionel Smith.
Départ d’Ispahan à la nouvelle lune, en avril. Vita rêve de trouver en route des bulbes de ces « petits iris pourpre et or » qu’elle a admirés au bord d’un ruisseau. Le voyage commence en voiture, à l’étape ils cherchent une chambre à louer, on les réveille à l’aube. La caravane de chameaux les précède. « L’aube, l’espace, la caravane : là était la beauté immémoriale de la Perse, encadrée par l’ouverture carrée de cette fenêtre ménagée si haut dans la muraille, la falaise de Yezd-i-Khast. »
Après une journée de route « cahin-caha, de bourgade en bourgade », le terrain devient impraticable, les pneus crèvent l’un après l’autre. Les voyageurs n’ont pas voulu emprunter la route de Téhéran à Chiraz, trop centrale : « Au fond de moi, je veux aller là où aucun Blanc ne s’est jamais rendu, loin, très loin des endroits qui figurent sur les cartes. La planète est trop petite, trop explorée, et le cinéma trop actif. » Après une région peuplée et prospère, voilà « la désolation des hautes terres » où ils croisent parfois un berger. Vita est comblée par « le vide et la nudité » des paysages. A Shalamzar, elle voit des femmes « occupées à recopier un ancien tapis de soie bakhtyar – le plus beau tapis que j’aie vu de toute la Perse. »
Bientôt on n’avance plus qu’à pied pour atteindre les trois mille mètres d’altitude, monter, descendre. Plus de maison où s’abriter, on dresse des tentes. On redécouvre les besoins essentiels. « Il suffit de s’égarer dans les montagnes, en Asie, pour se rendre compte qu’une source ou un ruisseau importent plus que la splendeur du panorama. Sans oublier le combustible : dans la fraîcheur de la nuit, les flammes d’un bon feu sont un luxe à ne pas négliger. Au bout d’un jour ou deux, on en vient très vite à des considérations matérielles. »
Vita Sackville-West aurait voulu marcher d’un bout à l’autre, mais des orteils meurtris, des ampoules aux talons l’obligent à s’avouer vaincue. Elle jette alors son dévolu sur la plus petite mule de la caravane, appelée la Souris en raison de sa couleur, et qui se révèle une monture idéale. Averses, éclaircies, orages. La montagne offre ses décors, quelques rencontres, des haltes bienfaisantes. C’est à regret, à la fin de la route, que la voyageuse observe les mulets en attente, qui agitent leurs cloches et lancent des coups d’oreilles aux mouches. Le retour dans la plaine signifie le retour à la civilisation de la vitesse et de la technologie : route goudronnée, téléphone, champs de pétrole. Où sont la splendide Persépolis, Palmyre, « fille de bédouins qui rit parce qu’elle est habillée en dame romaine » ?
Une aristocrate en Asie – douze jours dans les montagnes de Perse dans les années 1920 – nous en apprend autant sur ces voyageurs anglais déterminés à explorer des pays lointains que sur le pays bakhtyar lui-même. Si ses interrogations sur l’avenir des Persans trahissent l’idéologie de son milieu, l'amie de Virginia Woolf a le bon goût de ne pas se prendre trop au sérieux, elle assume sa part de snobisme (ah, étiqueter dans son jardin les plantes venues de très loin qui s’y sont acclimatées !) et tâche de se montrer impartiale – en aristocrate.