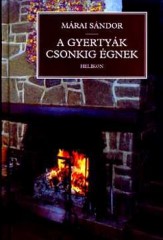J’aurais pu simplement garder le titre de Zeruya Shalev : Mari et femme (Baal ve-isha, 2000, traduit par Laurence Sendrowicz) ou intervertir – c’est une femme qui parle dans ce roman : « Femme et mari ». (Distingue-t-on « femme » et « épouse », « homme » et « mari » en hébreu ?) Mais Naama et Oudi ont une fille, Noga, dix ans, et cela importe.
C’est pour elle que le réveil sonne ce matin-là. Son père, absent durant une semaine pour guider des touristes en excursion, lui a beaucoup manqué. Naama s’irrite de l’entendre maugréer parce qu’on le tire de son sommeil, de le voir traîner au lit, alors que la petite part pour l’école, et n’en croit pas ses oreilles quand il déclare qu’il ne sent plus ses jambes, qu’il ne peut pas se lever, lui, le marcheur infatigable. Oudi est incapable de bouger, elle finit par appeler une ambulance.
En route vers l’hôpital, Naama se rappelle le jour où son mari, qui tenait la petite dans ses bras, l’avait laissé tomber du haut de la terrasse, quand elle n’avait que deux ans. Elle voit qu’on rase le café où un homme, un jour, lui avait montré le portrait qu’il avait fait d’elle au fusain, en hommage à sa beauté. Dans la panique de l’admission aux urgences, elle craint le pire : « Me voilà soudain sans lui, à distance respectueuse de ses jambes inertes, de ses yeux fermés qui m’observent depuis que j’ai douze ans, de toute sa présence qui me définit, moi, plus qu’elle ne le définit, lui. »
Assistante sociale, Naama s’occupe de très jeunes femmes enceintes sans l’avoir voulu et qui se demandent comment elles vont élever leur bébé ou l’abandonner. Elle croit reconnaître parmi les patients une mère à qui l’on a fini par enlever son fils qu’elle maltraitait. Quand le juge avait déclaré « La question n’est pas de savoir si elle l’aime mais comment elle l’aime », Naama avait appliqué cette façon de voir à sa vie de couple : « je me suis répété pendant tellement d’années qu’il m’aimait au lieu de me demander comment il m’aimait et si, moi, j’aimais cet amour. »
Le mal soudain dont souffre Oudi réveille les démons. Naama ressent sa maladie comme dirigée contre elle, contre leur famille. Depuis l’accident de Noga, miraculeusement sauvée par le seau d’une femme de ménage qui avait amorti sa chute, elle n’a plus osé les laisser seuls, « un fossé empoisonné » s’est creusé entre son mari et elle. Quand elle a admis avoir posé, en secret, pour le peintre jamais lassé de sa beauté, l’incompréhension s’est encore aggravée.
« Je me tourne vers Noga, viens à la cafétéria, allons manger quelque chose, mais elle se plaque contre le lit vide, je reste ici jusqu’à ce que papa revienne, elle s’agrippe au drap comme elle s’agrippait, petite, à son doudou. Nogui, je la supplie, je n’en peux plus, j’étouffe, viens, allons prendre un peu l’air, mais elle s’entête, on doit rester ici si on veut que papa guérisse, moi je sens que je perds patience, ma chérie, ça ne dépend pas de nous, j’aimerais bien, mais ça ne dépend vraiment pas de nous. »
Les examens médicaux d’Oudi ne révélant rien, un psychiatre diagnostique une « paralysie de conversion », une réaction somatique au stress mental. Oudi ne supporte pas de voir Naama accaparée par son métier, même à l’hôpital une collègue l’appelle pour une accouchée de quinze ans qui la réclame. Il n’arrête pas de la culpabiliser pour ce travail et de la dénigrer. Menacé d’un transfert en hôpital psychiatrique, Oudi arrive à remarcher avec un déambulateur et décide de quitter l’hôpital, furieux d’être considéré comme un simulateur.
Entre Naama et Oudi, les retrouvailles sexuelles ont toujours servi d’exutoire, et cela les rapproche à nouveau. Ils décident de confier leur fille deux jours à sa grand-mère pour partir à deux dans un bel endroit avec piscine où ils pourront évacuer la pression. Tout se passe bien, Oudi nage, sourit, enchanté de sentir sa femme disponible. Mais le lendemain matin, il se plaint cette fois de ne plus rien voir et l’accuse de le rendre malade. Naama est prête à tout « sauf à entrer dans le périmètre de sa cécité ». D’autant plus qu’Oudi ressasse des passages bibliques qu’il interprète comme des mises en garde, voire des interdits, et décide d’éviter tout contact avec elle.
Leur vie de famille est de plus en plus gâchée par ces accès dépressifs. Pendant qu’Oudi traîne et maigrit dans leur chambre où il dort seul désormais, Naama s’empiffre, grossit, évite ses collègues qui l’ont déjà accusée de se plaindre de sa situation sans jamais agir. Elle passe ses nuits sur le canapé, se montre de plus en plus distraite au travail, se sent devenir indifférente aux problèmes des autres. Noga trouve souvent refuge chez sa grand-mère, la seule à qui elle peut se confier.
Désespérée, Naama fait alors appel à une doctoresse tibétaine dont on lui a parlé comme d’une excellente guérisseuse. Celle-ci, Zohara, est une jeune femme étonnante, maigrichonne, qui se présente à leur porte, son bébé au sein. Après avoir vu Oudi, elle choque Naama en lui parlant de la maladie comme d’une opportunité, d’une épreuve dont ils peuvent sortir renforcés : « Vous êtes maître de votre bonheur, indépendamment des aléas de la vie. »
Mari et femme, c’est l’histoire d’une crise, d’un couple, d’une famille, à travers laquelle Zeruya Shalev (née en 1959) interroge les rapports entre les hommes et les femmes, et pas seulement entre ces deux-là. Elle fait parler les corps autant que les esprits. Ce roman sur « l’humiliation de la vie conjugale » est au centre d’une « trilogie de l’amour moderne », dit-elle dans un entretien à Libération, entre Vie amoureuse (la passion) et Théra (la rupture et la reconstruction).
Cela dit, l’originalité du roman tient à la manière dont il est écrit, à la première personne et au présent : grossissant de virgule en virgule, un flux irrépressible, souvent véhément, parfois logorrhéique, d’observations, de paroles, de pensées, nous fait découvrir le point de vue de Naama, attachante et épuisante, ses angoisses, sa culpabilité, ses doutes, ses souvenirs, ses désirs, entremêlés aux éléments extérieurs. Elle en a tant voulu à sa propre mère d’avoir quitté la maison familiale, est-elle condamnée à revivre elle aussi la séparation ?