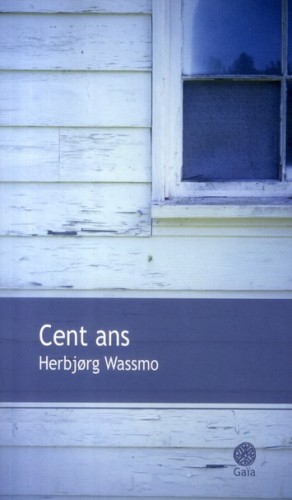En refermant Le cœur cousu (2007) de Carole Martinez, son premier roman, avant le déjà fameux Du domaine des murmures (2011), il me reste en tête un cortège de robes de mariées prodigieuses, celles des filles de Frasquita Carasco et celle de ses propres noces. C’est Soledad, la plus jeune, qui raconte leur histoire. Dans la boîte secrète que les filles de cette famille ont reçue en devenant femme, chacune à son tour, la dernière a trouvé « un grand cahier, de l’encre et une plume ». 
Photo Imagine Philomène…
La nuit où Frasquita perd « le premier sang », sa mère lui indique tous les interdits de son nouvel état : ce qu’il ne faut pas manger, boire, toucher – « la vie était plus simple avant ». Mais le premier soir des règles, « immanquablement, sa mère entrait dans sa chambre au beau milieu de la nuit, lui jetait une couverture sur les épaules et la menait dans un champ de cailloux où, quelle que soit la saison, elle la lavait en murmurant d’énigmatiques prières. » Fille unique, Frasquita n’a personne à qui se confier et garde le secret des « excentricités » de sa mère qui l’initie à de multiples rituels ; durant la Semaine sainte, elle lui enseigne des prières dont elles héritent « de mère en fille, de bouche à oreille » et même des « incantations qui font lever les damnés comme des gâteaux et permettent de jeter des ponts entre les mondes, d’ouvrir les grilles des tombeaux, de faire jaillir l’achevé. »
Après Pâques, le don de Frasquita depuis l’enfance pour les travaux à l’aiguille se transforme en art : elle reprise, recoud, brode si bien que le vêtement paraît neuf. Sa mère lui remet alors une boîte en bois qu’elle ne pourra ouvrir avant neuf mois – elle-même a « perdu le don » pour l’avoir ouverte trop tôt, par curiosité. Aussi demande-t-elle à sa fille de la cacher très loin. Frasquita l’enterre une nuit sous un gros olivier et se retrouve nez à nez avec un « ravissant visage de jeune homme ». Celui-ci s’obstine étrangement à compter et recompter les arbres dans l’oliveraie de son père. Le jour venu, la boîte révèle son contenu : des bobines de fils, des épingles, des ciseaux, un dé à coudre, des aiguilles, une boîte à couture aux couleurs resplendissantes.
Le cœur cousu déploie le destin de Frasquita la couturière, de ses premiers éventails aux robes de mariées, en passant par ce cœur miraculeux qu’elle fait battre sous la robe de la Madone bleue qu’on promène deux fois par an en procession dans les rues de Santavela. A seize ans, on la marie au fils du charron, José Carasco. Dans la vieille « petite robe fade » reçue pour ses noces, Frasquita fait tout passer : « les sentiers, les villes qu’elle n’avait jamais vues et la mer lointaine, tous les moutons d’Espagne, tous les livres, tous les mots et les gens qui les lisent, les chats, les ânes, tout aurait succombé à sa folie tisserande. » Le jour du mariage, elle y pique toutes les fleurs blanches de la roseraie voisine et éblouit ceux qui la regardent marcher jusqu’à la petite église. Mais le village malveillant refuse, conspue, ternit cette splendeur. La seule à s’en réjouir est Lucia, la prostituée, qui sera sa plus fidèle amie.
Pas de médecin à Santavela, mais deux « femmes qui aident », qui font les bébés et les morts, La Maria, instruite, et la Blanca, une bohémienne. Anita, la première fille de Frasquita, vient au monde dans les mains de la Maria. Bien que sa mère la baigne dès sa naissance « dans un univers de mots », sa fille aînée reste muette. Il faut dire que José Carasco ne leur est d’aucun secours depuis la mort de sa vieille mère : il a abandonné son atelier et s’est installé dans le poulailler. Lorsqu’il émerge de son étrange maladie, c’est comme s’il redécouvrait Frasquita pour la première fois. Neuf mois plus tard naît Angela. Mais José veut un fils. Frasquita suit alors les conseils de la bohémienne et accouche de Pedro el Rojo, dont la « tignasse rousse » réveille les médisances. Ensuite viendront d’autres filles, Martirio, la lumineuse Clara, et enfin Soledad, celle qui raconte.
« L’homme aux oliviers », comme le surnomme Frasquita depuis qu’elle l’a surpris à compter les arbres, accroche un jour son habit noir aux coqs de fer forgé dont Carasco a orné ses fenêtres – « Ma mère répondit tout de suite au cri du tissu. » Elle attrape le vêtement et le répare avec grâce. « L’homme se soumit au tranquille pouvoir de la main et du fil. » Le voilà dévoré de désir. Quand José Carasco prétend faire fortune avec son coq rouge dressé au combat, son rival relève le défi en jetant un affreux coq sauvage dans l’arène, prêt à tout pour posséder sa femme.
Carole Martinez attise le feu du récit, amène un ogre à Santavela, chasse Frasquita « en grande robe de noces » sur les routes d’Espagne, avec ses enfants. A la montagne, des anarchistes menés par un Catalan au « cœur noble », Salvador, finissent par se faire attraper par la garde civile. Torturé, l’homme perd son visage sous les coups de couteau ; on l'exhibe, pour l’exemple. Celui qui le soigne connaît Frasquita la vagabonde, la seule à pouvoir recoudre ce visage déchiré. Leurs destinées seront désormais liées.
Soledad est née sur « l’autre rive », après que sa mère a dessiné un grand cercle « dans la steppe d’alfa, les déserts de pierre et les djebels de ce pays immense ». Son génie de couturière permettra à Frasquita de s’y refaire une vie, pour elle et surtout pour ses enfants. Ses filles découvriront, l’âge venu, leurs propres dons singuliers, puis revêtiront la robe de mariée que leur mère leur a cousue, à l’exception de la conteuse vouée à l’encre et au papier. Neuf prix littéraires ont récompensé Carole Martinez – qu’on a rapprochée de Gabriel Garcia Marquez et de Carson Mac Cullers, pas moins – pour ce portrait d’une femme aux doigts de magicienne et le récit passionné de ses errances.