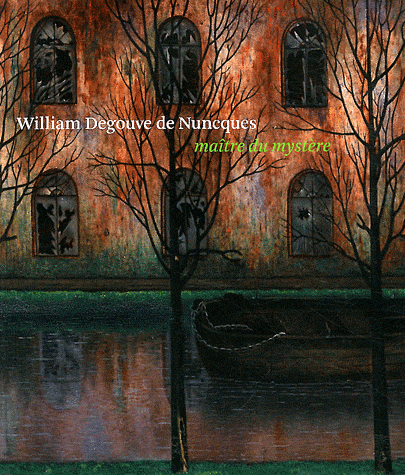Un torii, portail traditionnel, marque l’entrée du jardin japonais d’Hasselt, le plus grand d’Europe. Cerisiers et magnolias auraient mérité une visite un mois plus tôt, mais même sous un ciel gris de mai, le charme opère dès le début de la promenade. Dans ce jardin où l’eau, le bois et la pierre jouent un rôle particulier, l’impression dominante est d’équilibre et de quiétude.
Depuis 1985, des liens d’amitié unissent les villes d’Itami (Japon) et de Hasselt (chef-lieu du Limbourg belge). En échange d’une tour à carillon, les Japonais ont aménagé ce jardin près d’un grand parc, selon leurs principes : respect et utilisation de l’environnement naturel, maintien des arbres et arbustes présents, passages aérés « sans marquer démesurément les limites » (Guide de la promenade).
Contre le petit bâtiment en bois du guichet, une magnifique viorne illumine l’entrée (première photo). Ce Viburnum plicatum 'Watanabe' présente une masse d’inflorescences blanches et plates comme celles de l’hydrangea – de petites étiquettes vertes permettent d’identifier les arbres et arbustes du jardin.
L’eau serpente à proximité du chemin, des rochers encadrent une chute. Ces pierres, parfois de plusieurs tonnes, imitent et symbolisent un paysage montagneux. Impérissables, elles sont les éléments permanents du décor. Au-dessus du chenal en courbes douces, de petits ponts japonais. De fines baguettes de bambou, simplement glissées dans les petits trous des piquets en bois, bordent le passage des visiteurs.
Bientôt les marronniers à fleurs rouges laissent la place à de superbes érables japonais. Des verts et des pourpres se côtoient souvent, ce qui met en valeur leurs fins feuillages au port étalé. On est passé en douceur d’un jardin de transition au jardin japonais proprement dit.
Comme dans l’art du bonsaï, les Japonais veillent à donner une silhouette élégante aux arbres et à laisser la lumière, le regard les traverser. Sur l’autre rive, on aperçoit des échafaudages en bambou qui maintiennent à l’horizontale des branches de pins sylvestres : ainsi exposées à la pleine lumière, elles bourgeonnent magnifiquement. On peut préférer les arbres au naturel, mais l’art du jardin japonais est une culture, et selon sa tradition, c’est à l’homme de révéler la beauté cachée de l’arbre en le taillant, de rendre hommage au paysage en le miniaturisant. La nature est idéalisée, stylisée, apprivoisée.
Le chenal s’élargit peu à peu vers l’étang central. Et voici une grande lanterne japonaise ou tōrō, au bord de l’eau ; comme le torii, elle marque à l’origine l’entrée d’un sanctuaire. Cette lanterne de pierre offre un beau point d’appui à la vue vers la maison japonaise en bois, construite en partie sur l’étang, avec sa galerie qui permet d’admirer la vue et de superbes koïs.
Une plage de gros galets en pente douce invite à se rapprocher de l’eau. Les carpes colorées, tachetées viennent y défiler, par gourmandise sans doute. Plus loin, dans la dernière partie du jardin, un grand espace équipé de tables et de bancs permet de pique-niquer à l’ombre des arbres et des glycines, dans la cerisaie.
Avant de visiter la maison, nous allons au petit temple un peu plus loin, une réplique d’un temple shinto à Hiroshima. On peut accrocher ses vœux au portique d’entrée en bambou, glisser un papier roulé dans une encoche ou suspendre une plaquette. Dans le temple miniature, un miroir, symbole de sagesse, renvoie au visiteur son reflet et l’appelle à tourner son regard vers l’intérieur de lui-même.
Un large pont mène à la maison de cérémonie : de beaux espaces séparés par des cloisons mobiles en papier. Des sièges à même le sol, autour d’une table laquée. Des coussins dans le grand salon, des tatamis. Du bois, des pierres naturelles, du bambou, de l’argile… Les ouvertures révèlent une architecture en harmonie avec le jardin et l’étang où elle se reflète.
Un peu plus haut, une maison de thé, entre des bambous et des des pins sylvestres. Un dimanche par mois, on y organise une cérémonie du thé. Lorsqu'on fait le tour de l’étang, la vision du site change à chaque pas et permet d’apprécier la disposition des pierres et des végétaux, la surface de l’eau toujours changeante.
Au bord du chemin, différents cornouillers, dont un très beau cornus kousa. Dans le jardin japonais d’Hasselt, on peut aussi marcher sur l’eau, je vous en laisse la surprise. J’imagine ce jardin sous la neige, ce doit être merveilleux. C’est un espace où cheminer lentement, qui appelle à contempler.
Il y a plein de détails « à la japonaise » à observer dans l’aménagement du jardin. Et quand on approche de la sortie, un tapis de pétales au pied d’un arbre, les courbes d’une haie, d’une branche basse, d’une clôture, l’élan d’un érable champêtre vers le ciel, tout paraît différent, subtil, harmonieux.