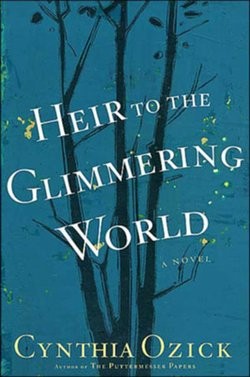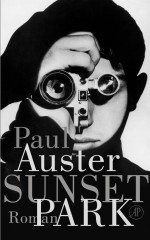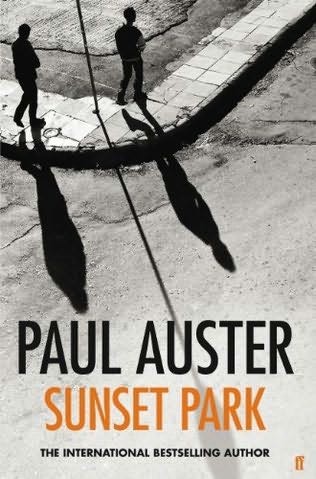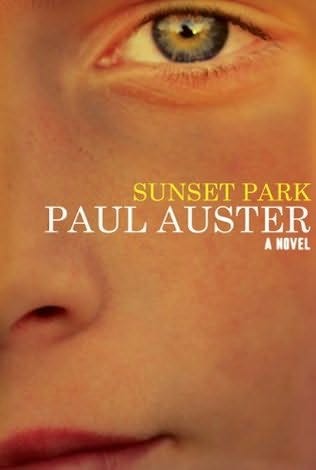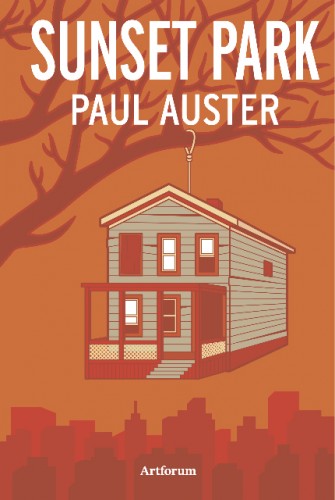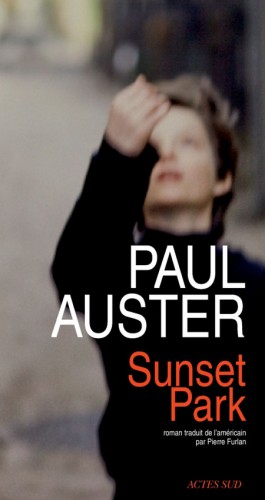Pourquoi Miles Heller est-il parti de chez lui ? Dans Sunset Park (traduit de l’américain par Pierre Furlan cette fois, et non plus par Christine Le Bœuf qui suivait Paul Auster depuis ses débuts en français), le personnage principal, 28 ans, travaille en Floride pour une entreprise chargée d’enlever les rebuts dans les maisons récupérées par les banques locales, le plus souvent dans un terrible état d’abandon et de saleté. Miles vit de petits boulots depuis qu’il a quitté New-York, ses parents, l’université, il y a sept ans et demi, sans explications. Depuis il s’efforce de vivre sans projet, sans désir, frugalement, au jour le jour.
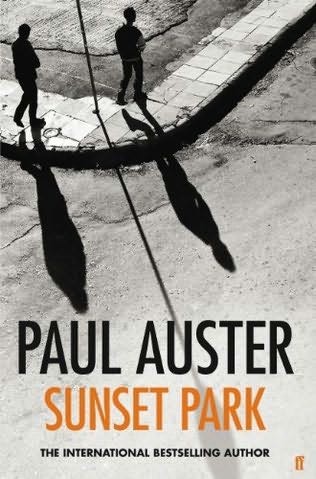
Alors qu’il songe à repartir, il fait connaissance dans un parc, où ils sont tous deux occupés à lire la même édition de Gatsby, avec une jeune femme de dix-sept ans, Pilar Sanchez. Miles lui dit que ses parents sont morts, elle parle de la maison qu’elle partage avec ses trois sœurs. Sa curiosité de lectrice, son vocabulaire, son intelligence, sa beauté, tout lui plaît chez Pilar, mais elle est mineure. Et quand elle s’installe chez lui (il a soudoyé ses sœurs en imitant pour une fois ses collègues qui ne se gênent pas pour dérober des objets de valeur), ils font très attention pour ne pas être remarqués ensemble en public.
Miles n’a raconté à personne les circonstances exactes de la mort de son jeune demi-frère. Miles est le fils de Morris Heller, des éditions Heller Books (fondées par lui) et de Mary-Lee Swann, actrice, qui les a quittés six mois après sa naissance. Bobby était le fils du premier mariage de Willa, sa belle-mère. Miles et lui se disputaient souvent. Le premier était brillant dans les études, Bobby le « bad boy ». Le jour de l’accident, ils étaient tombés en panne de voiture dans un endroit isolé, Bobby avait oublié de faire le plein. Furieux de ce n-ième signe de désinvolture, Miles s’était bagarré avec lui, l’avait fait tomber sur la route – geste fatal : une voiture l’avait fauché, écrasant « toute vie en lui, changeant ainsi à jamais leur vie à tous. » Après les funérailles de Bobby, Miles s’est muré dans le silence et le jour où il a entendu ses parents déplorer entre eux sa froideur, sa dérive, il a choisi de partir sans laisser d’adresse.
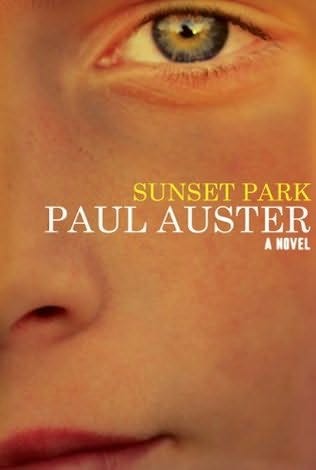
Avec Pilar, Miles s’amuse à lire l’Encyclopédie du base-ball, son sport préféré et celui de son père, passionné comme lui par les destins chanceux ou malchanceux des joueurs vedettes. Son seul lien avec son ancienne vie, c’est Bing Nathan, ils s’écrivent une fois par mois. Son ami lui annonce avoir trouvé une maison à Sunset Park (Brooklyn) : avec d'autres, il l’a remise en ordre et une chambre du squat est réservée pour lui. Miles a toujours refusé les invitations de Bing à revenir, mais sa situation se complique quand Angela, une sœur de Pilar, exige qu’il lui rapporte à nouveau « de jolies choses ». Miles refuse, elle menace alors de le dénoncer à la police pour relation illicite avec une mineure. Pilar et Miles ont compris qu’il a intérêt à quitter l’Etat au plus vite, elle le rejoindra à New York dès qu’elle sera majeure.
La suite du roman se déroule à New York. Miles lit dans le journal que sa mère va bientôt y jouer Oh les beaux jours – « un hasard extraordinaire dans un monde de hasards extraordinaires et de désordre sans fin. » En 1980, elle l’avait laissé à une nourrice jamaïcaine pour commencer une carrière au cinéma et une nouvelle vie de couple à Los Angeles. Après un second divorce, sa mère s’était remariée. Il lui avait rendu visite de temps en temps.
Place alors à « Bing Nathan et Compagnie ». Le fidèle ami de Miles a des convictions très fortes contre « l’état actuel des choses », la société du jetable, la dérive technologique. Convaincu de la seule réalité du « tangible », Bing a créé un Hôpital des objets cassés où il répare tout ce qui peut l’être. Grand ours débraillé et barbu, un clou en or à l’oreille, il est le batteur des Mob Rule. A Sunset Park, il a invité d’abord Ellen Brice qui travaille dans une agence immobilière et qui peint, puis Alice Bergstrom, doctorante à Columbia (le studio de son petit ami écrivain est trop petit pour deux).
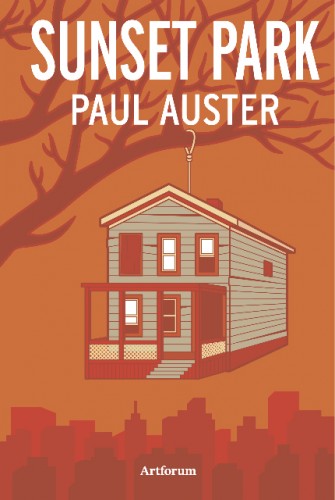
Même si la maison est inconfortable quand il fait froid, cela leur permet à tous des économies appréciables. Alice a été étonnée de l’absence de réaction des voisins, qui ont cru Bing quand il leur a dit l’avoir achetée à bon compte. Sa relation avec Jake bat de l’aile, elle grossit, et elle se raccroche à sa thèse sur les relations et les conflits entre hommes et femmes dans les livres et les films de 1945 à 1947. Elle ne cesse de visionner Les plus belles années de notre vie de Wyler, un film à succès dont elle ne se lasse pas de noter les détails significatifs.
Ellen a d’abord eu du mal à s’habituer à leur vie en commun, mais s’efforce de ne plus prendre de médicaments contre l’angoisse. Les corps, le sexe l’obsèdent. Huit ans plus tôt, en 2000, elle s’est retrouvée enceinte d’un garçon de seize ans, un des enfants d’un professeur qu’elle gardait pendant les vacances. Après avoir avorté, elle a tenté de se suicider, mais l’amitié d’Alice et la peinture l’ont sauvée. Les critiques d’une ex-petite amie de Bing sur ses « vues urbaines » l’ont persuadée de revenir à la figure humaine, elle aimerait qu’Alice pose pour elle, nue. Voilà ceux de Sunset Park. Bing, qui admire Miles depuis qu’il le connaît (non sans trouble), l’y accueille très chaleureusement.
Le récit se tourne alors vers Morris Heller, le père, rentré précipitamment de Londres où il tentait de se rapprocher de Willa (elle ne se remet pas de la mort de son fils et en veut à Miles) pour assister aux funérailles de la fille d’un de ses auteurs fidèles, qui vient de se suicider à 23 ans, « une vie disloquée par les trop et les trop peu de ce monde ». Avec son ami Renzo, écrivain toujours entre deux déprimes, parrain de Miles, il va ensuite dans un Delicatessen où ils parlent de sa maison d’édition qui subit la crise mais résiste, du retour de Miles à Brooklyn sans qu’ils se soient revus. Dès qu’il a eu des nouvelles de Floride, Bing a tenu les parents de Miles au courant de la vie que leur fils menait là-bas (Miles l’ignore) et il espère qu’à présent, l’heure des retrouvailles est venue.
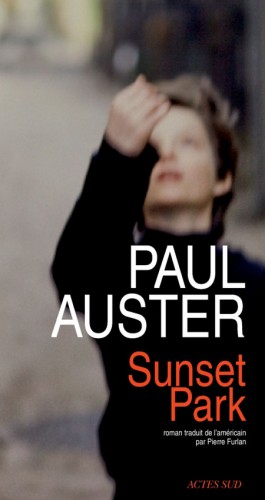
Son père « sait pourquoi Miles est parti », blessé par leurs paroles. A 62 ans, il fait le bilan de sa vie – les raisons du départ de Mary-Lee, les reproches de Willa qui, à la suite d’une infection sexuelle, a appris un « écart idiot » de son mari et le repousse. Il remonte le cours du temps passé avec son fils, se rappelle une phrase dans un devoir de lecture qui l’avait bouleversé quand il l’avait lue, tant elle montrait de maturité et de clairvoyance littéraire chez son enfant : « Tant qu’on n’est pas blessé, on ne peut pas devenir un homme. »
Sunset Park est le roman de ces vies blessées, de ces relations toujours problématiques qui font les couples, les familles, les solitudes, dans un monde en crise. Paul Auster éclaire tour à tour les jeunes et les vieux, les femmes et les hommes. Les allusions littéraires sont nombreuses, il y a de belles pages sur l’art, le cinéma, le théâtre.
Comment ceux qui s’étaient perdus vont-ils se retrouver ? Pilar tiendra-t-elle le choc en découvrant New York et la vérité sur Miles ? Combien de temps reste-t-il aux squatteurs de Sunset Park ? Le roman semble parfois bancal, certaines pages artificielles (anaphores soudaines sur la joie, le corps), mais le romancier américain nous touche quand il se tient au plus près des souffrances et du cœur.