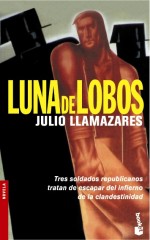Roman policier ? Ce serait réducteur. Avec Pleine lune (1997), Antonio Muñoz Molina enrichit la littérature espagnole d’une œuvre romanesque au sens fort : une intrigue palpitante, une écriture magnifique, servie par la traduction de Philippe Bataillon. Incipit : « Jour et nuit il marchait dans la ville à la recherche d’un regard. Il ne vivait que pour cette obligation, même s’il tentait de faire d’autres choses ou feignait de les faire, il ne faisait que regarder, il épiait les yeux des gens, les visages des inconnus, des garçons de café, des vendeurs de magasins, les visages et les regards des prisonniers sur les fiches d’identité. »

Juan Gris, Pierrot
Tout de suite, on marche, avec l’inspecteur, on est pris dans le rythme de ses obsessions : retrouver l’assassin de Fátima, une petite fille de neuf ans sortie pour s’acheter à la papeterie du papier bristol et des Crayolors, jamais rentrée, dont le cadavre a été retrouvé sur un talus dans le parc de la Cava, une nuit de pleine lune. C’est pour résoudre cette affaire que l’inspecteur a enfin obtenu la mutation que sa femme et lui attendaient depuis des années, à Bilbao, usés par l’angoisse, les menaces et le harcèlement téléphonique, au point que sa femme, en dépression, suit maintenant une cure en résidence psychiatrique et que lui, insomniaque, se tient sur ses gardes jour après jour pour vérifier à chaque instant autour de lui les signes d’un danger potentiel. Ils n’ont pas d’enfant.
De retour dans la petite ville où il a fait ses études à l’internat, il y a rendu visite au
père Orduña à qui il avait écrit pendant quelque temps, reconnaissant pour la bourse qu’il lui avait obtenue, et c’est le vieux jésuite anticonformiste qui lui a dit : « Cherche ses yeux ». En scrutant le regard des gosses alignés devant lui, en classe, le prêtre identifiait toujours le coupable. Le visage blanc de la petite obsède l’inspecteur, morte étouffée par le tissu de sa culotte enfoncée dans la bouche. « Il cherchait des yeux
un visage qui serait le miroir d’une âme embusquée, un miroir vide qui ne reflétait rien, ni le remords ni la compassion, peut-être même pas la peur de la police. » Mais chacun vit « avec son secret enfoui dans son âme, qui lui ronge le cœur, toujours inaccessible, non seulement aux inconnus mais aussi à ceux qui sont les plus proches ».
Ici, on ne le connaît pas encore, cela permet à l’inspecteur de surveiller plus à l’aise. « L’hiver et la peur, la présence du crime, étaient tombés sur la ville comme des frissons simultanés, comme un saisissement de rues silencieuses et désertes au crépuscule, battues par une pluie froide et un vent chargé d’odeurs de terre qui en une ou deux nuits avait fait tomber toutes les feuilles des platanes et des marronniers, jaunies depuis avant l’été à cause de la longue sécheresse. » Jusqu’au jour où il voit son propre visage au journal télévisé, pris de très près, son nom et sa fonction inscrits au bas de l’écran – « et il s’irrita beaucoup et s’inquiéta plus qu’il n’était prêt à le reconnaître. (…) Il se demanda si ces images avaient été vues par l’un de ceux qui lui envoyaient des lettres anonymes quand il était dans le nord ».
Par ses parents, qui lui ont montré le film de sa communion, par l’école, par les voisins, l’enquêteur s’est fait une idée de la personnalité de la victime, une fillette attentive aux autres et qui aimait apprendre. Susana Grey, son institutrice, qui vit seule avec son fils, est la première à oser s’approcher de cette « clarté froide qui était le nouveau pays où habitait maintenant l’inspecteur », un homme dans la cinquantaine qui ne boit plus d’alcool, ne fume plus, n’a plus de femme qui l’attend chez lui. Une vieille femme est enfin venue témoigner, elle a vu sortir l’enfant avec un homme jeune qui la tenait par l’épaule. Elle a répété sa description devant l’institutrice, au cas où celle-ci y reconnaîtrait quelqu’un : un homme d’une vingtaine d’années, sans doute un travailleur manuel aux ongles mal coupés avec des bords tranchants, d’après Ferreras, le médecin légiste.
Soudain un paragraphe entre guillemets, un extrait de rapport très précis sur les allées et venues quotidiennes de l’inspecteur, sur ses habitudes. Habitué à suivre les obsessions de l’enquêteur, le lecteur découvre tout à coup celles d’un inconnu qui vient de s’installer en ville et le piste. Puis c’est un autre monologue intérieur : les préoccupations d’un homme qui vit avec ses vieux parents qui le dégoûtent, dans un appartement du centre historique aux odeurs nauséabondes, qui « passe sa vie à travailler plus d’heures que n’en compte le cadran » ; il prend soin de mettre à part du linge souillé qu’il veut laver lui-même.
Quand elle le revoit, Susana Grey apprend à l’inspecteur que son anorak et ses chaussures suffisent à l’identifier comme venant du nord. Intéressée par cet homme enfermé en lui-même, elle le questionne sur sa vie, sa femme ; elle l’emmène dans sa voiture à « L’île de Cuba », un restaurant près du fleuve et lui parle « comme presque jamais dans sa vie depuis qu’elle était adulte ». Ces deux-là n’ont pas fini de se rencontrer.
« Les mains propres, les mains molles de tant d’humidité, les mains rougies par le travail et le froid, les mains aux doigts grands, aux ongles cassés, avec leurs tranchants rugueux et cornés, des ongles toujours cernés de noir… » Ainsi
débute une phrase de deux pages et demie qui nous entraîne avec l’assassin vers un autre crime, presque identique, qui va faire avancer l’enquête. C’est un des passages les plus forts de Pleine lune où la phrase longue, de virgule en virgule, porte sensations, pensées, pulsions. La traque se précise, elle aboutira, mais rien ne sera
plus jamais comme avant pour l’inspecteur, pour sa femme, pour Susana. Rien n'est plus jamais comme avant pour personne.
Antonio Muñoz Molina excelle à rendre le va-et-vient permanent du corps à l’esprit et de l’esprit au corps : le regard qui parle ou se tait, les mains qui disent qui nous sommes, ce que nous cachons, ce que nous cherchons. Le va-et-vient du temps aussi, dans nos vies, de l’enfant à l’adulte en nous, de la vieillesse à la jeunesse. « C’est que je veux que tu saches qui tu étais », dit le prêtre rouge à l’inspecteur en lui montrant ses archives, « Tu n’as pas l’air de bien te souvenir. Aujourd’hui les gens oublient tout, de sorte que personne ne sait qui il est vraiment. » Nous n'oublierons pas ces personnages dont nous avons presque partagé le souffle et en tout cas l'inquiétude dans ces nuits froides chevauchées par la lune, comme une malédiction.