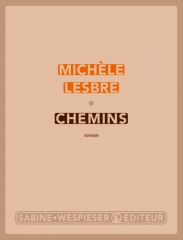Karine Tuil raconte dans L’invention de nos vies l’histoire de Sam, Samuel et Nina. Variation contemporaine sur le trio amoureux, entre Paris et New York, mais pas seulement : l’identité, la culture, le couple, le mensonge, le sexe, les relations sociales, l’écriture, l’ambition et beaucoup de thèmes d’actualité nourrissent ce roman à suspense.
 © http://www.parisnewyork.info/
© http://www.parisnewyork.info/
Samuel Baron, éducateur social à Clichy-sous-Bois, n’en revient pas de reconnaître sur CNN son ami de la fac de droit, Samir Tahar, devenu un virtuose du barreau new-yorkais, très séduisant dans un costume sur mesure. Défenseur des familles de deux soldats morts en Afghanistan, il affiche « la morgue et l’assurance d’un homme politique en campagne ».
Nina les a aimés tous les deux, quand elle avait vingt ans, dans les années 1980. Elle était déjà en couple avec Samuel, « un homme dont toute l’existence était une somme de névroses et dont l’ambition – la seule – était de faire de cette souffrance mentale la matière d’un grand livre ». A ses dix-huit ans, ses parents français d’origine juive, communistes, profs de lettres, avaient appris à Samuel que sa mère polonaise l’avait abandonné après sa naissance, et qu’ils l’avaient adopté.
A la consternation de ses amis, son père avait choisi de l’appeler Samuel, de le faire circoncire, « alors qu’il ne l’était pas lui-même », et de changer son propre prénom Jacques en Jacob en renouant avec ses racines juives. Quand tout cela lui est révélé, Samuel quitte la maison de ses parents pour toujours. Seule compte pour lui Nina dont il est fou amoureux. Très belle, elle aussi vit « sans confiance » et « sans repères », sa mère est partie quand elle avait sept ans, son père militaire s’est mis à boire.
Samir, fils d’immigrés tunisiens, est « l’électron libre » de la petite bande, jusqu’au drame : les parents de Samuel meurent dans un accident de voiture. Samuel ne peut échapper à son rôle de fils et accompagne leurs corps en Israël, confiant Nina à son meilleur ami. Mais jamais Samir ne résiste à ses désirs, il couche avec elle, tombe amoureux, la somme après quelques mois de liaison secrète de choisir entre Samuel et lui. Nina hésite, une tentative de suicide de Samuel la retient.
Ils ont renoncé alors tous les deux aux études de droit, Samuel a suivi des études de lettres par correspondance et Nina a fait des petits boulots avant de devenir mannequin pour les catalogues de grandes enseignes commerciales. C’est pourquoi ils restent « pétrifiés » devant la réussite sociale de Samir, vingt ans plus tard.
Mais ce n’est pas Samir qui fête ses quarante ans, c’est Sam. Ce n’est pas le « bon musulman » que sa mère espère, comme elle le lui écrit dans une lettre qu’il prend soin de détruire, mais le mari juif de Ruth, « la fille de Rahm Berg ». Son père, « l’une des plus grosses fortunes des Etats-Unis, le client le plus important du cabinet », l’a pris pour un juif séfarade, a fait confiance à Pierre Lévy, un célèbre avocat français qui a mis Sam Tahar à la tête de la succursale new-yorkaise. Celui-ci ne les a détrompés ni l’un ni l’autre.
Samuel et Nina, en cherchant des informations, tombent sur un un portrait de Sam Tahar dans le Times. Déjà éberlués d’apprendre que Sam est juif à présent, Nina et Samuel n’en reviennent pas : dans l’article, c’est le passé de Samuel que raconte Sam Tahar, l’accident de ses parents comme si c’étaient les siens, il prétend même s’appeler Samuel – il lui a volé son histoire.
Ils avaient cru oublier Samir, mais à présent il les obsède, ils ne peuvent plus vivre comme avant. Samuel veut que Nina reprenne contact avec lui, pour le démasquer. Nina refuse d’abord puis cède, « elle accepte alors qu’elle sait, au fond, que c’est elle qui sera piégée. » Elle n’a pas oublié Samir, elle pourrait encore l’aimer. Ensemble, ils vont tenter de le mystifier.
Une fausse identité, c’est encore trop peu pour Sam Tahar. Incapable de résister aux jolies femmes, il prend des risques, les attire dans sa garçonnière, persuadé de ne pas éveiller le moindre soupçon chez Ruth, la mère de ses deux enfants. Elle l’a bien cru, et son père aussi, quand il a prétendu ne plus avoir de famille. Ruth ignore tout de l’existence de sa belle-mère Nawel, du demi-frère de Sam, fils d’un notable dont elle était la femme de ménage.
L’engrenage fatal se met en branle : « Nina Roche a appelé », annonce sa secrétaire à Sam Tahar, et l’homme « parfait » qui s’est « composé un personnage comme un auteur crée son double narratif » ne peut que céder à son envie de l’appeler, de la revoir, et de prendre l’avion sous le prétexte d’une affaire à régler à Paris.
On en est à la centième page, au cinquième du roman, et la vie du trio va connaître bien des rebondissements. Sam est le plus fort au jeu du paraître, Samuel le plus en souffrance, et Nina la plus faible – le moins crédible des trois personnages. La romancière ne craint pas la caricature et l’invraisemblance, mais son thriller tient tout de même en haleine, avec « efficacité » – le mot est de Bernard Pivot, enthousiaste.
Le titre, L’invention de nos vies, annonce aussi, disséminée dans l’intrigue, une réflexion sur l’écriture et l’invention romanesque. Le texte est très rythmé, avec un usage inattendu de la barre oblique et des notes en bas de page. « Chaque homme doit inventer son chemin », écrivait Sartre. Ici, c’est l’interaction entre les trois membres du trio, sans oublier les personnages secondaires et les contextes sociaux, qui fait avancer le récit et exploser le drame, forcément.
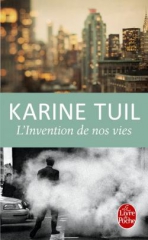 « On vit bien dans le non-dit, personne ne demande où est le père. Le mensonge, les perspectives d’intégration et d’évolution qu’il offre. La vie comme une fiction à vivre au jour le jour. Le roman dont il est le héros. Ces possessions qu’il s’invente. Et sa capacité à esquiver les coups, quelle que soit la violence de l’attaque. Une telle aptitude au rebond, ça l’épate lui-même. Avec une imagination pareille, il pourrait être écrivain, mais déjà, à quinze ans, il est trop fasciné par l’argent et la liberté qu’il procure pour se limiter à une carrière artistique dont il pressent qu’elle l’encagerait. Il pense : je vais/je veux réussir, fût-ce sur les fondements d’une histoire créée de toutes pièces. »
« On vit bien dans le non-dit, personne ne demande où est le père. Le mensonge, les perspectives d’intégration et d’évolution qu’il offre. La vie comme une fiction à vivre au jour le jour. Le roman dont il est le héros. Ces possessions qu’il s’invente. Et sa capacité à esquiver les coups, quelle que soit la violence de l’attaque. Une telle aptitude au rebond, ça l’épate lui-même. Avec une imagination pareille, il pourrait être écrivain, mais déjà, à quinze ans, il est trop fasciné par l’argent et la liberté qu’il procure pour se limiter à une carrière artistique dont il pressent qu’elle l’encagerait. Il pense : je vais/je veux réussir, fût-ce sur les fondements d’une histoire créée de toutes pièces. »