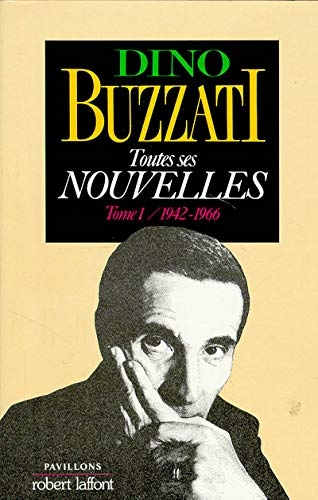La vie mensongère des adultes, le dernier roman d’Elena Ferrante (traduit de l’italien par Elsa Damien), confirme son talent pour accrocher d’un bout à l’autre. Je l’ai dévoré avec appétit, c’est un roman facile à lire et il en faut pour nous distraire en cet été pas comme les autres.
Giovanna, douze - treize ans, fille unique, un âge où l’on est souvent mal dans sa peau, y raconte un tremblement de terre intérieur, annoncé dès la première phrase : « Deux ans avant qu’il ne quitte la maison, mon père déclara à ma mère que j’étais très laide. » Ce père professeur à l’université de Naples, qu’elle trouve intelligent et élégant, la couvre depuis toujours de compliments. Elle s’est habituée à sa voix douce et affectueuse, même si elle connaît son autre voix, tranchante et précise, lorsqu’il discute avec les autres.
Pour la première fois, elle est rentrée avec de mauvaises notes qui inquiètent sa mère, une enseignante. Celle-ci met son père au courant de ce qu’on lui a dit à l’école et celui-ci laisse échapper, sans se douter que sa fille l’entend de sa chambre à la porte entrouverte : « Ça n’a rien à voir avec l’adolescence : elle est en train de prendre les traits de Vittoria ».
Giovanna a ses règles depuis un an, les changements de son corps la préoccupent, la rendent même apathique. Elle n’en revient pas d’être comparée à cette tante : son père a toujours associé sa sœur à la laideur et à la « propension au mal ». Contrairement à ce qu’elle espérait, sa mère réagit mollement. Elle en est si troublée qu’elle n’envisage qu’une solution : « aller voir à quoi ressemblait vraiment Zia Vittoria. »
Elle a connu ses grands-parents maternels et le frère de sa mère avant qu’il ne s’éloigne, mais elle ne sait pas grand-chose de la famille de son père qui vit « au bout du bout de Naples », dans un quartier très différent du haut de la ville où ils habitent, pas loin du parc de la Floridiana. Un jour où ses parents sont absents, elle fouille dans leurs albums de photos pour voir à quoi ressemble Vittoria et découvre que, là où elle figurait, on a gratté méthodiquement un petit rectangle à la place de son visage !
Tout cela ne fait que la perturber davantage, à la maison où elle s’examine sans fin dans la glace et au collège où elle est trop distraite pour redevenir bonne élève. Ses meilleures amies, Angela, du même âge qu’elle, et sa petite sœur Ida, sont les filles d’un couple ami de ses parents, Mariano et Costanza. En leur présence aussi, Giovanna devient « grincheuse ». Quand ses amies la rassurent – elles aussi deviennent laides quand elles ont des soucis –, elle se demande si elles mentent, bien qu’on leur ait appris comme à elle de ne jamais dire de mensonges.
Sa mère a vu qu’elle avait touché aux albums dans leur chambre, ses parents devinent qu’elle a entendu leur conversation et il leur faut bien répondre à ses questions au sujet de cette tante « terrible » qui travaille comme domestique et qu’ils disent envieuse, rancunière, destructrice. Vu son obstination, ils lui permettent de lui rendre visite, tout en la mettant en garde. Son père va la déposer devant sa porte un dimanche, dans les bas quartiers de Naples où il est né et où il a grandi.
« J’appris de plus en plus à mentir à mes parents. » La tante Vittoria, bien habillée, bien coiffée, ne ressemble pas du tout à « l’épouvantail » de son enfance, même si façon de parler, brutale et grossière, dans un « dialecte âpre », surprend Giovanna. Très vite, elle lui parle du bracelet qu’elle lui avait offert à sa naissance, qu’elle ne porte pas, et dont sa nièce n’a jamais entendu parler. Et d’Enzo, son grand amour, un homme marié, à qui elle va régulièrement parler au cimetière – Vittoria accuse son frère d’avoir fait son malheur.
Sous son influence, Giovanna commence à regarder ses parents autrement. Ce qu’elle découvre derrière les apparences d’un couple uni et cultivé est inattendu, choquant même. Eux aussi mentent et l’adolescente va voir ce qui l’entoure d’une manière tout à fait nouvelle en oscillant désormais entre le monde dans lequel elle a été éduquée et celui de Vittoria, si différent, qu’elle va fréquenter davantage.
La vie mensongère des adultes développe les thèmes abordés dans L’amie prodigieuse : la recherche chaotique de sa propre personnalité, les troubles du corps, les confidences et les rivalités entre amies, les rapports ambivalents avec les garçons, les débuts sexuels et amoureux, les études, les différences sociales. Ici aussi, l’héroïne est attirée par un jeune homme plus instruit, qui aime discuter avec elle bien qu’il soit fiancé.
Comme résumé dans Le Monde, « Portraits de femmes ciselés et Naples en toile de fond : c’est le nouveau roman de la mystérieuse écrivaine italienne. Le talent est là, guère la surprise. » C’est très bien vu, très bien rendu, j’ai lu La vie mensongère des adultes avec grand plaisir, tout en me demandant parfois si Elena Ferrante ne nous donne pas là une version disons plus intellectuelle des mélos sentimentaux d’autrefois.