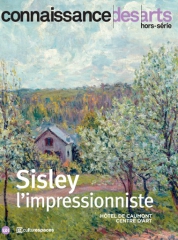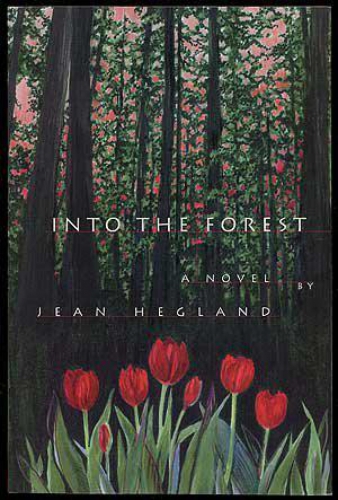Les prévisions météorologiques annoncent encore des températures au-dessus de vingt degrés dans le pays de Nyons. Elle me manque déjà, cette douceur de la Drôme provençale au passage de l’été à l’automne. En voici quelques moments à partager avec vous.
D’abord une promenade qui part de Venterol où il ne reste quasi pas de traces du tournage du film « Raoul Taburin » cet été, avec Édouard Baer et Benoît Poelvoorde, qui a laissé bien des souvenirs aux habitants. On descend entre deux murs de pierres sèches vers la Sauve, le ruisseau qu’on suit vers le bas avant de traverser la route et de remonter sur la route de Vinsobres. Près des vignes de Provensol, on monte à droite sur la crête de Serre Long, d’où on a une très belle vue sur Venterol (ci-dessus) et sur toutes les montagnes derrière, de la Lance jusqu’au Ventoux, en passant par le Corbiou.
La fine lumière de septembre s’accrochait aux graminées le long du sentier et aussi à ces clématites sauvages dont j’ai eu tant de plaisir à regarder les aigrettes plumeuses, tantôt blanches, tantôt roses, qui enguirlandent les murs ou les haies au bord des chemins à cette saison. Quelle surprise, à mon retour, de voir une nouvelle fleur sur la clématite de mon jardin suspendu et même un autre bouton – le soleil reviendra-t-il l’aider à s’ouvrir ?
Quel beau pays où marcher, se promener, se reposer. Et quel plaisir aussi de pouvoir nager dans une eau même un peu fraîche dans ce cadre enchanteur ! Ne faire qu’un avec les bleus du ciel et de l’eau, les blancs des nuages, les verts des vignes et des lavandes coupées, des oliviers, des chênes truffiers, se poser là comme une hirondelle de passage.
Près des poubelles d’un hameau, une petite troupe de chats sauvages survit grâce aux dépôts de leurs amis. De jeunes tigrés, tachetés, gris, et cette belle siamoise, moins farouche, qui semblait curieuse de ce que nous lui disions doucement, pour ne pas l’effrayer.
Un peu partout flambe là-bas l’or de ce que nous prenons pour un crocus d’automne, qui s’appelle en réalité sternbergia lutea ; ce bulbe qu’on surnomme aussi la Vendangeuse fleurit en septembre, octobre, de l’Italie à l’Iran, et ces notes jaune vif sont inattendues dans un paysage qui prend jour après jour des teintes automnales.
Septembre permettait encore de déjeuner en terrasse. Mention spéciale pour le Bistrot de Venterol : on y mange sur l’agréable place du Château ou à l’intérieur, dans un décor de brocante chaleureux, où j’aime ces belles boîtes de thé anciennes. Et à Grignan, près du lavoir rond à colonnes, sur le Mail, pour Le Clair de la Plume où nous avons apprécié un midi la formule Bistro dans la véranda – toutes les tables du jardin étaient occupées.
Nous arrivions de Notre-Dame d’Aiguebelle où nous voulions voir en particulier le Mémorial de Tibhirine. L’abbaye cistercienne ne se visite pas, on peut y assister aux offices. Le site, calme et paisible, offre des endroits de contemplation et aussi des chemins de promenade balisés (brochure en vente sur place). Le Mémorial dédié aux chrétiens et aux musulmans – vous vous rappelez sans doute le film Des dieux et des hommes – comporte des photos, le rappel des faits, des textes forts comme le testament spirituel de frère Christian ou la lettre écrite à ses amis par Mohammed Bouchikhi, musulman, chauffeur et ami de Mgr Claverie.
Et aussi des œuvres d’art : un chemin de croix sculpté par un artiste drômois, un vitrail d’un artiste polonais, une mosaïque. Je suis restée émue devant le beau Christ de l’oratoire. « Sur le rocher au fond du mémorial, comme un rappel des montagnes de l’Atlas, le Christ Ressuscitant. Il n’est plus fragile, il est solide, de la solidité de Dieu. Il sort de la nuit (d’où la couleur sombre du bas de la statue) et entre dans la lumière. Sa résurrection engendre celle de nos frères ; il est leur solide point d’appui. » (Livre du Mémorial, à consulter en ligne.)
Douce Drôme au couchant – plusieurs fois, nous sommes montés sur la colline pour admirer ce paysage, ces lumières, cette paix du jour qui s’éteint et de la saison qui s’achève.