Si tu n’es pas présent à l’instant que tu vis
que peut-il te donner ?
Prends ce qui est là
devant toi
et que tu n’as
pas vu
Charles Juliet, Pour plus de lumière
En poursuivant votre navigation sur ce site, vous acceptez l'utilisation de cookies. Ces derniers assurent le bon fonctionnement de nos services. En savoir plus.
Si tu n’es pas présent à l’instant que tu vis
que peut-il te donner ?
Prends ce qui est là
devant toi
et que tu n’as
pas vu
Charles Juliet, Pour plus de lumière
Les lecteurs du Journal intime de Charles Juliet le connaissent mieux que ceux qui, comme moi, ont découvert cet écrivain hors du commun à La Grande Librairie le mois dernier. Il a choisi lui-même des poèmes de 1990 à 2012 pour son Anthologie personnelle intitulée Pour plus de lumière. En ce jour le plus court de l’année, entrons dans l’hiver avec le poète.
Jean-Pierre Siméon commence ainsi « La conquête dans l'obscur », préface de ce Poésie/Gallimard : « Qui, une fois, a rencontré Charles Juliet ne peut pas ne pas avoir été frappé par ce trait dont on sent immédiatement qu’il n’est ni anecdotique, ni circonstanciel, ni véniel, dont on comprend, au rebours, qu’il est profondément constitutif : son extrême précaution devant la parole. »
Ce qui frappe d’abord en lisant ce familier de la nuit, c’est son mal-être.
« des milliers
de fois
tu es parti
et revenu
tu as frappé
et guetté
des milliers
de fois
tes yeux scrutaient
a nuit tu t’emplissais
de silence et tes mains
restaient vides
tandis que
tu partais
et revenais
frappant
et guettant
tes yeux
de plus en plus
fiévreux
tes lèvres
toujours plus
avides
tes mains
chaque fois
plus lasses »
(Affûts, 1990)
Du sentiment d’être « hors jeu » dans cette vie qui lui échappe et l’écrase naissent des poèmes âpres, sombres, où il s’identifie davantage à ce qui meurt – feuille morte, bois mort – qu’à ce qui vit. Ecrire pour survivre :
« accroché au flanc
de la paroi
c’est là que tu veilles
interroges écris »
Sa courte biographie à la fin du recueil dit sa naissance en 1934 à Jujurieux (Ain), son placement à trois mois dans une famille de paysans suisses, une école militaire de dix à vingt ans, puis l’Ecole de santé militaire de Lyon (où il vit) – études abandonnées trois ans plus tard
« pour se consacrer à l’écriture ».
« mes chemins mes mots
tous mes chemins mènent
à la faille
dont ils m’ont éloigné
tous mes mots
conduisent
vers un certain silence
tous mes efforts et mes échecs
vers cela qui interdit
l’effort ignore les échecs
mes mots et mes échecs
mes chemins »
Vers libres, strophes courtes, petits poèmes en prose, tout chez Charles Juliet est brièveté. Pas d’exposé, plutôt des cris. Des textes très rythmés, d’autres comme balbutiés. Peu à peu, les ténèbres sont traversées d’éclats de lumière ; la faim et la soif font place au feu, voire à l’ivresse. Le poète fouille au plus profond de lui-même, dit ses peurs, ses manques, et parfois l’apaisement de la rencontre, la joie même.
« février
déjà ici
le printemps
triomphe
jamais
l’élan
ne fléchit
la faim
ne s’apaise
jamais
ne vient
le repos
et comment
vivre
comment aller
du labour aux moissons
comment ne rien détruire
et consentir à la soif
être un jour cet amandier
ne plus avoir
à t’inventer un chemin »
(Ce pays du silence, 1992)
Ce sont poèmes de silences et de murmures, un apprentissage de l’échange :
« savoir donner
savoir recevoir
être délivré
de la peur
découvrir enfin
l’accord la confiance
l’abandon »
C’est surtout un travail sur soi :
« Creuser. Fouiller. Désenfouir.
Tirer au jour ce qui exige de venir à la lumière. »
Pour plus de lumière : ce très beau titre donne le mouvement du recueil, d’une œuvre de poète retenue par l’obscurité née de l’exil : « Au commencement est la perte, violente, irréparable. Pour tous, cet arrachement à l’éden de la vie intra-utérine. (…) Mais on sait que pour Juliet, cette douleur primordiale est doublée d’une seconde, plus irrévocable encore : à trois mois, il est dépossédé de sa mère, dépressive, internée dans un hôpital psychiatrique où elle mourra bientôt. » (Siméon)
« Je n’avais pas huit ans
Tu es apparue ce jour de juillet
où j’ai appris ta mort
Avant ce jour
j’ignorais que tu existais
j’avais une maman
qui m’aimait et que j’aimais
et rien ne me laissait
soupçonner que j’avais
une autre mère
Puis en quelques mots
on m’a appris ton décès
Je crois bien qu’à cet instant
je n’ai rien éprouvé
On ne peut ressentir
de la peine
en apprenant la mort
d’une inconnue
Mais je me souviens
de ce qui a suivi »
(L’opulence de la nuit, 2006)
Cette belle anthologie de Charles Juliet fait découvrir le poète et l’homme, indissociables. La mère perdue, l’absente, l’inconnue, redeviendra source :
« et ces mots qui te sont
à jamais restés dans la gorge
ils alimentent la source
de ceux que j’ai engrangés
pour toi dans mes livres »
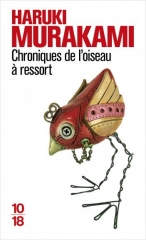 « – Si vous n’aviez plus de nom à présent, monsieur Okada, comment devrais-je vous appeler ?
« – Si vous n’aviez plus de nom à présent, monsieur Okada, comment devrais-je vous appeler ?
– Oiseau-à-ressort. C’est du moins le seul nouveau nom envisageable pour moi.
– Monsieur Oiseau-à-ressort, répéta-t-elle en écho, avant de laisser les syllabes flotter dans l’air pour les admirer. Je trouve que c’est un nom magnifique, mais qu’est-ce que c’est que cet oiseau ?
– L’oiseau à ressort existe réellement. Je ne sais pas à quoi il ressemble. Je ne l’ai jamais vu. La seule chose que je connaisse de lui, c’est son cri : ki kii kiii ! Il se perche sur une branche d’arbre et remonte régulièrement la pendule du monde. Sans son intervention, le monde ne peut pas fonctionner. Tout le monde l’ignore. Les gens sur terre croient que le monde fonctionne correctement grâce à un mécanisme gigantesque, complexe, splendide. Eh bien, non. En fait, l’oiseau à ressort se rend dans toutes sortes d’endroits, et là où il est, il remonte peu à peu les petits rouages qui font marcher le monde. »
Haruki Murakami, Chroniques de l’oiseau à ressort
Intriguée par le titre de Haruki Murakami, Chroniques de l’oiseau à ressort, je me suis plongée dans ce gros roman d’abord publié en trois volumes au Japon en 1994-1995. L’histoire est racontée par Toru Okada, trente ans, marié, qui vient de quitter son emploi. Sa femme Kumiko n’y voit pas d’inconvénient, son propre salaire est suffisant pour eux deux ; elle aimerait qu’il retrouve leur chat disparu depuis une semaine.
 L’oiseau à ressort, ainsi baptisé par Kumiko, est un oiseau du voisinage au « ki kii kiii » régulier, comme s’il remontait un ressort : « Je ne sais pas à quelle espèce d’oiseau il appartenait en réalité. Je ne sais même pas à quoi il ressemblait. Mais ce volatile n’en avait cure, et venait tous les jours remonter les ressorts de notre petit monde paisible. »
L’oiseau à ressort, ainsi baptisé par Kumiko, est un oiseau du voisinage au « ki kii kiii » régulier, comme s’il remontait un ressort : « Je ne sais pas à quelle espèce d’oiseau il appartenait en réalité. Je ne sais même pas à quoi il ressemblait. Mais ce volatile n’en avait cure, et venait tous les jours remonter les ressorts de notre petit monde paisible. »
Un muret sépare leur jardinet d’une ruelle, espace à l’abandon derrière les jardins des propriétés voisines. Toru n’y trouve pas leur chat, mais en explorant les environs, il va faire toutes sortes de découvertes. Outre la jeune May qui observe tout ce qui se passe dans cette ruelle, d’autres voix féminines vont s’introduire dans sa vie d’une manière ou d’une autre. Et puis un jour, Kumiko ne rentre pas du travail. Sa femme l’a quitté, sans explication. Surpris, il décide de l’attendre, puis de la retrouver, même quand une lettre lui apprend qu’elle est partie avec un autre homme.
 Le narrateur de Murakami est un type sans histoire, qui se contente de prendre soin du foyer – il cuisine, nettoie, range, fait les courses – et se montre très disposé à écouter les histoires des autres. Il aime ne rien faire, s’asseoir quelque part et observer les gens, dormir, rêver. Chroniques de l’oiseau à ressort se mue peu à peu en un puzzle dont le nombre de pièces ne cesse d’augmenter : ce que vit Toru Okada en réalité (bien que cette expression soit de plus en plus mouvante au fur et à mesure que le roman s’écoule), ce qui lui arrive en rêve, ce que lui racontent les gens, etc.
Le narrateur de Murakami est un type sans histoire, qui se contente de prendre soin du foyer – il cuisine, nettoie, range, fait les courses – et se montre très disposé à écouter les histoires des autres. Il aime ne rien faire, s’asseoir quelque part et observer les gens, dormir, rêver. Chroniques de l’oiseau à ressort se mue peu à peu en un puzzle dont le nombre de pièces ne cesse d’augmenter : ce que vit Toru Okada en réalité (bien que cette expression soit de plus en plus mouvante au fur et à mesure que le roman s’écoule), ce qui lui arrive en rêve, ce que lui racontent les gens, etc.
J’ai suivi avec attention les apparitions de l’oiseau à ressort, qui a un double muet, un oiseau de pierre, dans le jardin d’une maison vide du quartier. Je suis descendue avec le narrateur jusqu’au fond d’un puits à sec où sa vision du monde va changer, puis j’ai décroché, je l’avoue, de ce roman foisonnant qui vire au fantastique. Si les fantasmes sexuels du narrateur sont plutôt doux, les scènes de guerre que lui raconte l’un ou l’autre sont d’une violence effrayante.
 Le romancier japonais m’a surprise par sa grande attention aux vêtements de ses personnages, aux couleurs. Comme Woody Allen, il mêle des airs de musique à ses histoires. Murakami opte souvent pour le réalisme magique, voire le surréalisme. Il n’a pas vraiment réussi à m’emmener dans ces mondes parallèles où son héros vit toutes sortes d’expériences peu banales, tout au long de ce roman de près de mille pages aux digressions inattendues.
Le romancier japonais m’a surprise par sa grande attention aux vêtements de ses personnages, aux couleurs. Comme Woody Allen, il mêle des airs de musique à ses histoires. Murakami opte souvent pour le réalisme magique, voire le surréalisme. Il n’a pas vraiment réussi à m’emmener dans ces mondes parallèles où son héros vit toutes sortes d’expériences peu banales, tout au long de ce roman de près de mille pages aux digressions inattendues.
En me promenant dans le quartier, cela fait plusieurs fois que j’entends dans la même rue une mésange solitaire qui appelle, appelle, juchée sur un platane dépouillé de ses feuilles. Aussi l’ai-je photographiée pour illustrer ce billet et baptisée pour quelque temps « oiseau-à-ressort ».
 « Nous prenons nos repas sur cette table en plastique.
« Nous prenons nos repas sur cette table en plastique.
C’est là aussi que j’écris les discours pour ma défense et mes textes personnels, avec des stylos-billes que j’achète à la cantine.
Pendant que j’écris, mes camarades de cellule sont assis à côté de moi et regardent la télévision.
Je peux écrire n’importe où, le bruit et l’agitation ne m’ont jamais dérangé. D’ailleurs, une fois que je suis plongé dans l’écriture, tout ce qui m’entoure disparaît. Je romps le contact avec le monde extérieur et m’enferme dans une pièce invisible où personne ne peut entrer que moi.
J’oublie absolument tout en dehors du sujet qui m’occupe.
L’une des plus grandes libertés qui puissent être accordées à l’homme : oublier. Prison, cellule, murs, portes, verrous, questions, hommes – tout et tous s’effacent au seuil de cette frontière qu’il leur est strictement défendu de franchir. »
Ahmet Altan, Je ne reverrai plus le monde