Elizabeth Finch, le dernier roman de Julian Barnes (2022, traduit de l’anglais par Jean-Pierre Aoustin), est d’abord le portrait d’une femme qui donne un cours pour adultes intitulé « Culture et Civilisation ». « Elle se tenait devant nous, sans notes, livres, ni trac. Le pupitre était occupé par son sac à main. Elle laissa errer son regard sur nous, sourit, immobile, et commença. » (Incipit) En présentant son cours, elle indique que les lectures seront facultatives, qu’elle privilégiera le dialogue, et attendra d’eux la même rigueur que celle dont elle fera preuve.

« Je n’ai pas souvenir de ce qu’elle nous a appris pendant ce premier cours. Mais je savais obscurément que, pour une fois dans la vie, j’étais arrivé au bon endroit. » Le narrateur décrit son élégance un peu désuète. Tous étaient curieux de sa vie privée, de la marque des cigarettes qu’elle rangeait dans un étui en écaille de tortue. Il était frappé par son immobilité, sa voix « calme et claire » pour exposer ce qui était dans sa tête, « entièrement pensé et élaboré ».
Elle leur parlait par exemple de sainte Ursule, belle et vertueuse princesse britannique qui, demandée en mariage en l’an 400, avait obtenu de son père « trois années de grâce » pour faire un pèlerinage à Rome, ce qui permettrait à son prétendant de s’instruire « dans la vraie foi » et de se faire baptiser. Ursule était accompagnée de onze mille vierges – le M du premier scribe voulait-il dire Mille ou Martyres, étant donné leur mise à mort par les Huns devant Cologne ? Ayant raconté cette histoire, elle leur avait demandé ce qu’il fallait « penser » de tout cela, et « dans le silence », avait fourni une réponse très inattendue.
Cette « lettrée indépendante » dont la situation financière était un mystère, avait un appartement dans les beaux quartiers de Londres. Ses deux livres publiés étaient « courts, et épuisés ». Neil la considérait comme « un esprit élevé, indépendant, européen ». (Elle rappelle un peu Brookner, une amie de Barnes.)
Parmi les étudiants, de trente à quarante ans environ, le narrateur faisait partie d’un petit groupe avec « Anna (hollandaise, et donc parfois scandalisée par la frivolité anglaise), Geoff (provocateur), Linda (émotionnellement instable, dans l’étude comme dans la vie elle-même) et Stevie (urbaniste cherchant à élargir son horizon). » Ni ordinateurs portables, ni réseaux sociaux à cette époque « où les informations venaient des journaux et où le savoir venait des livres ».
Un jour, E.F, comme ils l’appelaient, avait précisé qu’elle n’était pas employée pour les aider, mais pour les « aider à réfléchir et à argumenter » ainsi qu’à « penser » par eux-mêmes. Neil avait d’abord été acteur (de petits rôles à la télé), puis producteur de champignons et de tomates. Deux fois marié, une fille. Rien de glorieux. Il appréciait Anna, malgré leurs désaccords fréquents.
Quant à Elizabeth Finch, elle affrontait la vie, selon lui, avec stoïcisme. Elle avait cité Epictète : « De toutes les choses qui existent, certaines dépendent de nous, d’autres non. » Elle les questionnait sur le passé, sur ce qui serait arrivé si une bombe avait tué Hitler, ou si Julien l’Apostat avait réussi à endiguer « la désastreuse marée du christianisme », si Julien d’Eclanum avait gagné contre saint Augustin à propos du péché originel…
Au fil des mois, les idées s’approfondissaient, les cours devenaient « plus libres de forme et plus ouverts ». En fin d’année, Neil va la trouver : il n’arrive pas à écrire un essai comme demandé, accaparé après son divorce par « la fragilité des relations humaines ». Ce qu’elle lui dit alors ne prendra sens que plus tard, comme souvent. La relation de Neil avec Elizabeth Finch se prolongera au-delà du cours, et surtout le questionnement qu’elle est parvenue à lui insuffler, stimulant son intelligence.
S’il fait la part belle aux sujets enseignés, comme Julien l’Apostat en particulier, le personnage auquel E.F. revenait fréquemment (et sur qui Neil fait à son tour des recherches – l’essai à écrire ?), le roman de Julian Barnes mêle à la réflexion sur l’histoire un point de vue sur le présent. J’ai aimé cet hommage original à l’enseignement, si prégnant quand celui-ci s’incarne dans la personne qui le donne. Il m’a rappelé « mon » Elizabeth Finch, en quelque sorte – reconnaissance éternelle.
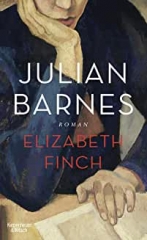 « Et ainsi une autre partie de ma vie a commencé. Nous nous retrouvions, deux ou trois fois par an, dans un petit restaurant italien de l’ouest de Londres, près de l’endroit où elle habitait. Les règles étaient claires, sans être jamais vraiment énoncées. J’arrivais ponctuellement à 13 heures ; elle était assise là, fumant une cigarette. Nous prenions les pâtes du jour, une salade verte, un verre de vin blanc et un café noir. Une fois, au début, je suis sorti des rails et j’ai commandé l’escalope de veau. « Comment c’est ? a-t-elle demandé en se penchant avec curiosité vers mon assiette. Décevant ? » »
« Et ainsi une autre partie de ma vie a commencé. Nous nous retrouvions, deux ou trois fois par an, dans un petit restaurant italien de l’ouest de Londres, près de l’endroit où elle habitait. Les règles étaient claires, sans être jamais vraiment énoncées. J’arrivais ponctuellement à 13 heures ; elle était assise là, fumant une cigarette. Nous prenions les pâtes du jour, une salade verte, un verre de vin blanc et un café noir. Une fois, au début, je suis sorti des rails et j’ai commandé l’escalope de veau. « Comment c’est ? a-t-elle demandé en se penchant avec curiosité vers mon assiette. Décevant ? » »
