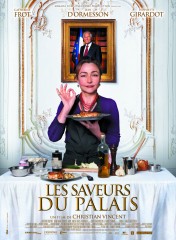Léon Tolstoï et sa femme s’écrivaient presque chaque jour, lorsqu’ils étaient éloignés l’un de l’autre. Le point de vue de Sofia, l’épouse de Tolstoï, apparaît largement dans Ma vie, dont je vous ai longuement entretenus à la fin de l’année dernière. Aussi m’en tiendrai-je cette fois à des extraits. Bernard Kreise a rassemblé dans Tolstoï, Lettres à sa femme, parmi les 839 lettres qu’il lui a écrites, « celles qui permettent de mieux connaître cet homme de génie, avec l’ombre de sa femme en contrepoint » (quelques lettres de Sofia sont reprises dans les notes). A l’exception de la première, la fameuse lettre où il lui demande de l’épouser en septembre 1862, il s’agit de lettres rédigées par Tolstoï (1828-1910) après ses cinquante ans, après La Guerre et la Paix et Anna Karénine. Elles vont du 11 juin 1881 au 30-31 octobre 1910, quelques jours avant sa mort.

« Maintenant, je vois les choses autrement. Je continue à penser et à ressentir de la même façon, mais je me suis guéri de cette erreur qui me poussait à croire que les autres peuvent et doivent tout envisager de la même façon que moi. J’ai été très coupable vis-à-vis de toi, ma chérie, coupable de façon inconsciente, involontaire, tu le sais, mais coupable tout de même. » (Métairie sur la Motcha, le 2 août 1881)
« Quand je suis seul, je me représente toujours avec plus de clarté, plus de vivacité, la mort à laquelle je pense en permanence, et quand je me suis représenté que j’allais mourir sans amour, cela m’a terrorisé. Ce n’est que dans l’amour qu’on peut vivre dans le bonheur et ne pas s’apercevoir que l’on meurt. » (Iasnaïa Poliana, le 1er février 1885)
« Toutes les choses, ou du moins la plupart de celles qui t’angoissent, comme les études des enfants, leurs résultats, les questions d’argent, même de publication, tout cela me semble vain et superflu. (…) Ma présence à Moscou, dans la famille, est presque inutile : les conventions de la vie là-bas me paralysent, la vie là-bas me répugne, encore une fois en raison de mon point de vue sur la vie d’une manière générale, que je ne peux changer, et là-bas j’ai moins de possibilités de travailler. » (Iasnaïa Poliana, le 17 octobre 1885)
« Vous m’attribuez tout cela, mais il y a une chose que vous oubliez : c’est vous qui êtes la cause, la cause involontaire et fortuite de mes souffrances.
Des hommes vont à cheval et derrière eux se traîne un être battu jusqu’au sang, qui souffre et qui se meurt. Ils ont pitié de lui, ils veulent l’aider, mais ils ne veulent pas s’arrêter. Pourquoi ne pas essayer de s’arrêter ? » (Moscou, 15-18 décembre 1885)
« Tu emploies de nouveau les mêmes mots : une tâche au-dessus de mes forces ; jamais il ne m’aide, c’est moi qui fais tout ; la vie n’attend pas. Autant de paroles que je connais, mais, surtout, qui n’ont aucun rapport avec ce que j’écris et ce que je dis. J’ai dit et je continue de dire une seule et même chose : il faut chercher à comprendre et déterminer ce qui est bien et ce qui est mal, de quel côté aller ; si tu ne cherches pas à comprendre, il ne faut pas s’étonner que tu souffres et que les autres souffrent également. » (Obolianovo, le 21 ou le 22 décembre 1885)
« Personne ne me distrait ni ne me dérange. Un livre, une réussite, du thé, des lettres, des pensées sur les choses bonnes ou sérieuses, sur le grand voyage à venir pour aller là d’où personne ne revient. Et c’est bien. Seules tes lettres me rendent terriblement triste – aujourd’hui c’est Tania qui l’était –, sachant que tu es toujours mélancolique. » ((Iasnaïa Poliana, le 9 novembre 1892)
« Ce qui est affreux, c’est que tous ces écrivailleurs, ces Potapenko, ces Tchekhov, ces Zola et ces Maupassant ne savent même pas où est le bien et où est le mal : la plupart du temps, le mal, ils le considèrent comme le bien et de cette façon, sous le couvert de l’art, ils régalent le public en le pervertissant. » (Iasnaïa Poliana, le 20 octobre 1893)
« Tu me demandes si je t’aime toujours. Mes sentiments pour toi maintenant sont tels qu’ils ne sauraient aucunement se modifier, il me semble, car il y a en eux tout ce qui peut lier des êtres. Non, pas tout. Il manque une concorde extérieure dans les croyances – , je dis extérieure, car je pense que nos divergences ne sont qu’extérieures et je demeure convaincu qu’elles disparaîtront. Le passé, les enfants, la conscience de nos fautes, la pitié, une attirance irrésistible nous lient aussi. Bref, tout est lié et solidement noué. Et je suis content. » (Iasnaïa Poliana, le 13 novembre 1896)
« J’écris cela en particulier parce que je voudrais te souhaiter, ma chère Sonia, de t’adonner à une activité dont tu saurais qu’il s’agit de la meilleure chose que tu puisses faire, et qu’en la faisant tu demeurerais sereine face à Dieu et face aux hommes. (…) Quelle activité ? Je l’ignore et je ne peux te l’indiquer, mais elle existe, elle est propre à toi et est importante, elle est digne, c’est une activité sur laquelle on peut faire reposer sa vie entière, et il en existe une pour chaque individu, et elle ne consiste en aucun cas pour toi à jouer du piano et à aller assister à des concerts. » (Iasnaïa Poliana, le 26 novembre 1897)
« En ce qui concerne le fait que tu ne m’as pas suivi dans mon évolution spirituelle personnelle, je ne peux te le reprocher et je ne te le reproche pas, car la vie spirituelle de tout individu est le secret qu’il entretient avec Dieu, et les autres ne peuvent rien exiger de lui. Et si je l’ai exigé de ta part, je me suis trompé et j’en suis coupable. » (Iasnaïa Poliana, le 14 juillet 1910)
« Mon départ te peinera. Je le regrette, mais comprends et crois bien que je n’ai pu agir autrement. Ma situation à la maison devient, est devenue insupportable. En dehors de tout le reste, je ne peux plus vivre dans les conditions de luxe dans lesquelles j’ai vécu, et je fais ce que font habituellement les vieillards de mon âge : ils abandonnent la vie mondaine pour vivre dans la solitude et le calme les derniers jours de leur existence. » (Iasnaïa Poliana, le 28 octobre 1910)