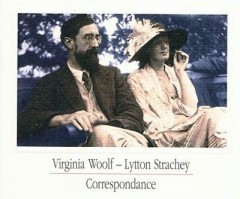Vous vous souvenez peut-être du Passage de Vénus ? La romancière australienne Shirley Hazzard y montrait déjà avec sensibilité la manière dont les femmes et les hommes se lient ou se délient, et j’en avais retenu cette phrase : « Les femmes ont une aptitude à la solitude, mais ne veulent pas être seules. » Ce pourrait être un résumé de La baie de midi (1970), traduit de l’anglais par Jean et Claude Demanuelli pour Gallimard en 2010.
On y quitte l’Angleterre avec la narratrice pour Naples, où elle arrive comme traductrice sur une base de l’Otan, un automne, et loge par chance dans un hôtel au bord de la mer et non dans un immeuble d’appartements réservé aux militaires. La première fois que son supérieur lui donne quelques heures de liberté, Jenny en profite pour découvrir un peu la ville en se rendant chez le seul contact qu’elle ait à Naples, une femme qu’elle n’a jamais vue, connaissance d’une connaissance, une écrivaine dont quelques ouvrages ont été adaptés avec succès au cinéma.
Dans San Biagio dei Librai, en plein centre de Naples, elle tombe d’emblée sous le charme de Gioconda, une femme plutôt belle, pleine d’endurance et de vitalité, d’une « puissance aussi retenue, aussi peu écrasante que celle d’un arbre majestueux », servie par Tosca, suivie par Iocasta, son chat blanc. A l’intérieur de l’appartement aux plafonds hauts, la Napolitaine l’emmène jusqu’à son bureau « baigné de lumière et jonché de papiers et de livres » ; d’emblée, elles se racontent l’une à l’autre. Jenny, de son vrai prénom Pénélope, était enfant lorsqu’elle a embarqué pour l’Afrique du Sud au début de la guerre, et la femme qui s’occupait d’elle a confondu Penny et Jenny, prénom qui lui est resté. Elle fait à cette inconnue qui pourrait devenir une amie le bref récit d’une « enfance naufragée » puis découvre le lieu idéal de l’appartement, sa terrasse avec vue sur la ville : « D’ici, on voit tout. »
Jenny a quitté son frère Edmund, dont elle a d’abord tenu la maison au Somaliland jusqu’à son mariage avec Norah, une « petite femme catégorique », puis qu’elle a suivi à Londres, après la mort de leur mère. Voir Edmund perdre sa personnalité sous la coupe de Norah lui était insupportable. De comprendre qu’elle était en réalité amoureuse de son frère l’a décidée à accepter ce poste à Naples.
Dans l’appartement de Gioconda, elle voit partout des photos d’un homme de quarante-huit ans, très sûr de lui. C’est Gianni, l’amant de Gioconda, un metteur en scène qui travaille pour le cinéma. Il l’invite dès leur première rencontre à passer la journée du lendemain avec eux pour essayer sa nouvelle Maserati. Lors de cette excursion à Herculanum, Gianni tente de l’embrasser, ce qui gâche la sortie de Jenny. Gioconda a raison quand elle lui dit, lors d’un déjeuner : « Ca va changer ta vie, ce séjour ici. Naples est un saut. Un passage à travers le miroir. » Quand Jenny s’installe dans un appartement meublé donnant sur la mer au pied du Pausilippe, les deux pièces les plus vastes dont elle ait jamais disposé, ce sont les « premiers moments de pur bonheur » de sa vie.
Un véhicule de l’armée passe la prendre tous les matins, c’est sur le chemin de son supérieur, un colonel sombre et ennuyeux, mais parfois Justin Tulloch, un Ecossais désinvolte, l’emmène dans sa voiture. Il lui fait une cour irrégulière, ils s’entendent bien, Jenny et lui, tout en restant sur la défensive côté cœur. La vie de Gioconda comporte des zones d’ombre. Gianni voudrait qu’elle aille vivre avec lui à Rome, mais elle sait qu’il y voit d’autres femmes, de plus Gianni est un homme marié, qui a deux enfants.
Roman d’analyse, La baie de midi est à Naples ce que Tempo di Roma d’Alexis Curvers est à Rome : le roman d’une ville, de ses paysages, de ses habitants, d’un mode de vie. Naples dans les années cinquante, Naples aux quatre saisons, jusqu’à cet été brûlant – « un caldo da morire » – où Gioconda accepte de rejoindre Gianni à Tripoli, où Jenny tombe malade alors que tous partent en vacances, et qui va tout bouleverser. Shirley Hazzard donne une telle présence à ses personnages que l’on se réjouit de les retrouver d’un chapitre à l’autre, comme si on allait prendre le thé chez eux ou qu’on les accueillait chez soi pour une de ces conversations après lesquelles on a l’impression de respirer plus large, plus profond. Beaucoup d’élégance dans ce roman de lumière et d’ombre, où Jenny va à la découverte des autres, et finit par mieux se comprendre elle-même.