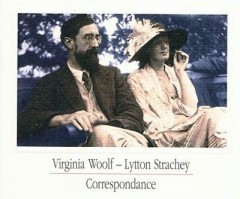Loin des conventions du récit d’intrigue avec ses péripéties, Virginia Woolf explore la personnalité humaine à travers les impressions et les émotions de ses personnages, auxquelles se mêlent leurs souvenirs. En 1925, quand Mrs. Dalloway est publié, le renouvellement du roman moderne est en cours : Proust a écrit les premiers tomes d’A la recherche du temps perdu ; Joyce a fait sensation avec Ulysse.

En couverture de l'édition Penguin Books 1992, un détail de
Stanley Cursiter, The Sensation of Crossing the Street, 1913
« Mrs. Dalloway said she would buy the flowers herself. » (« Mrs. Dalloway dit qu’elle irait acheter les fleurs elle-même. ») Le récit commence par cette phrase, le matin, et se terminera à la fin de la soirée que Clarissa donne chez elle. Virginia Woolf raconte cette journée du mercredi 13 juin 1923 à travers différents personnages. On suit d’abord Clarissa Dalloway dans les rues de Londres, grisée par la fraîcheur matinale : celle-ci lui rappelle l’air de Bourton (elle a grandi à la campagne) qu’elle respirait par la fenêtre ouverte, à dix-huit ans, et une remarque de son ami Peter Walsh sur la terrasse, disant qu’il préférait les gens aux choux-fleurs. Il lui a écrit d’Inde qu’il doit revenir bientôt.
Une voisine l’aperçoit de loin – Clarissa ne l’a pas vue – et lui trouve le charme d’un oiseau, même à plus de cinquante ans et très blanche depuis sa maladie. Clarissa regarde tout ce qui se passe autour d’elle : « […] what she loved ; life ; London ; this moment of June. » Elle le dit à un ami qu’elle rencontre, Hugh Whitbread : « I love walking in London. Really, it’s better than walking in the country. »
Depuis quelques années, Mrs. Dalloway attendait sur l’étagère : pas la traduction française par S. David (Livre de poche), lue et relue (chaque fois qu’une de mes élèves de rhéto choisissait Virginia Woolf sur la liste de littérature étrangère pour un exposé oral), mais l’exemplaire en anglais (Penguin Books) de la bibliothèque de maman, excellente polyglotte, qui s’était inscrite une année à un cours de littérature anglaise dans sa commune.
En marge de la description des mouvements d’un aéroplane qui va tracer des lettres publicitaires dans le ciel, ma mère a noté « Voilà ce que Papa faisait (…) » – mon père était pilote à la Force aérienne belge. Elle a écrit « Papa » et non son prénom, comme si cette note m’était destinée – elle connaissait mon amour pour Virginia Woolf. J’ai toujours pensé que ma faible connaissance de l’anglais mettait hors de portée mon rêve de la lire un jour dans sa langue originale. Cet été, je me suis attelée à ce défi, quelques pages par jour, d’abord en anglais puis en français, avec des allers-retours pour vérifier la compréhension et en cas de blocage. Quelques recours au dictionnaire, pas trop. Je ne cherchais pas à traduire mot à mot, mais à entrer dans le texte et à sentir son mouvement.
C’est fabuleux. Jamais je n’avais imaginé pouvoir me mettre au diapason d’une langue aussi rythmée, musicale, d’une narration plus fluide dans l’original que dans la traduction, avec des répétitions, des anaphores… Encore mieux qu’en français, j’ai ressenti ce que ressentent tour à tour Clarissa, puis Rezia, la femme de Septimus, puis Septimus lui-même, traumatisé par la guerre – une sorte de double inversé de Clarissa tournée vers la vie, alors que lui pense à la mort. Ce n’est qu’à la fin que leurs destins se croiseront. Tous les thèmes (vie publique, vie privée) sont présents dans ce roman génial.
Présent, passé et futur cohabitent dans la conscience. Se souvenant de sa grande amie Sally Seton, Clarissa pense à l’amour entre elles, un doux souvenir qu’elle oppose à la relation entre sa fille Elizabeth et Miss Kilman, censée l’éduquer aux bonnes manières, une femme fanatique et sectaire. De retour chez elle, Mrs Dalloway est en train de féliciter Lucy pour le brillant de l’argenterie quand on sonne à la porte – à onze heures du matin, le jour où on prépare une soirée ! Peter Walsh, son ancien amoureux, vient la voir dès son arrivée à Londres.
Il est à Londres pour régler des affaires personnelles. Il est amoureux d’une femme indienne, mariée, deux enfants. Clarissa l’invite à sa soirée, puis on le suit, lui, dans ses pensées, ses visions, ses souvenirs, ses activités du jour. Le flux de conscience, dans Mrs. Dalloway, est rendu aussi pour d’autres personnages qu’elle : Peter, le couple Rezia-Septimus, et d’autres dont nous découvrons les préoccupations au fur et à mesure de la journée dont Big Ben sonne les heures.
Durant la soirée, Clarissa joue son rôle d’hôtesse à la perfection. Peter et Sally, à qui elle a promis de revenir près d’eux, pensent à leur jeunesse. Virginia Woolf fait dire à Sally Seton qu’il n’y a « qu’une chose qui vaille la peine d’être dite : ce que l’on sent ». Une seule fois dans la traduction. Or il y a deux phrases de plus dans l’original : « For she had come to feel that it was the only thing worth saying : what one felt. Cleverness was silly. One must say simply what one felt. » (« L’intelligence est/était stupide. On doit dire simplement ce que l’on sent. »)
Lire Mrs. Dalloway, c’est le bonheur inépuisable de la redécouverte, la marque d’un chef-d'œuvre.