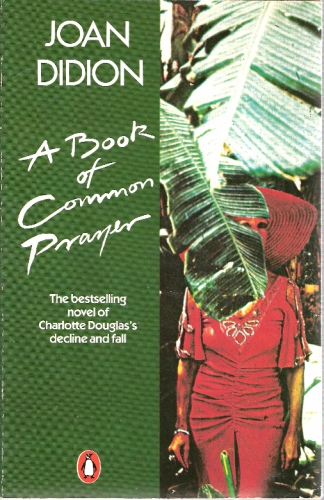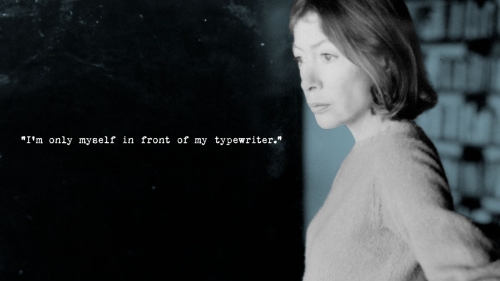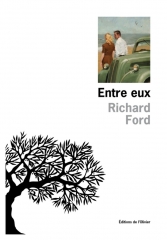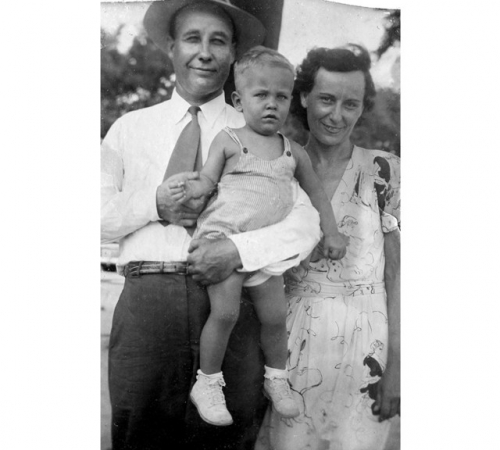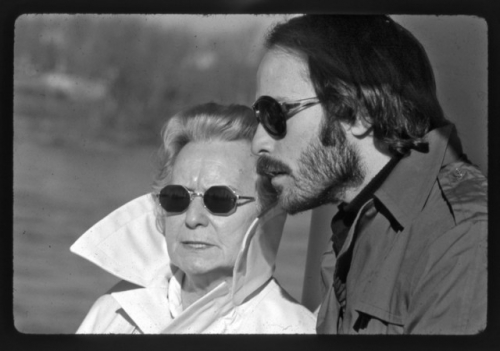Les entretiens publiés dans La Libre Belgique sont souvent très intéressants, comme ces quatre pages où Florence Aubenas répond aux questions de Francis Van de Woestyne dans le journal du week-end dernier. Vous vous souvenez peut-être du Quai de Ouistreham (2010) où la journaliste racontait son expérience de « salariée précaire », et sûrement de son enlèvement en Irak avec son accompagnateur, 157 jours dans une cave (2005) qui lui valent encore, trop souvent, d’être reconnue comme « l’otage ».

Source © Francis Van de Woestyne, Florence Aubenas, La Libre Belgique,
samedi 27 et dimanche 28 janvier 2018, pp. 50-53.
Elle vient de donner à Bruxelles une conférence intitulée « Grandeur et misère du journalisme aujourd’hui », Bruxelles où elle est née et a vécu dix-huit ans. Son père y était fonctionnaire européen avant de devenir diplomate. Sa mère, critique de cinéma, enseignait à l’Université libre de Bruxelles (Jacqueline Aubenas ! Je n’avais jusqu’à présent pas fait le lien entre la journaliste et sa mère, une des fondatrices des Cahiers du Grif et de Voyelles, rencontrée lors de réunions féministes dans les années 1970). Florence Aubenas, née en 1961, a fait ses études à l’Ecole européenne : « Cela vous donne une tournure d’esprit très particulière : l’Europe est une évidence, cela ne se discute pas. »
Le journalisme n’était pas son objectif au départ. Après des études de lettres sans désir d’enseigner, elle a passé le concours de journalisme et est devenue secrétaire de rédaction. Un remplacement l’a conduite à faire un premier reportage et elle a tout de suite aimé ce travail concret, sur le terrain, les rencontres avec des gens qui ne soient pas « des professionnels de la communication ». Puis elle est partie (pour Libération, puis Le Monde) au Rwanda, en Algérie, au Kosovo, en Irak – elle est devenue « correspondante de guerre ».
Inévitablement, Francis Van de Woestyne l’interroge sur son expérience d’otage. Florence Aubenas décrit ses conditions de détention et son instinct de survie, à la fois physique et mental – « il faut tenir ». Elle s’était intérieurement « programmée » pour tenir cinq ans avant d’avoir droit au désespoir ; elle avait confiance dans son pays, sa famille, ses amis, sûre de leur engagement pour la faire libérer. Sans preuve, elle pense qu’une rançon a été versée, contrairement aux pratiques américaines, et estime que « négocier » ainsi n’est pas de la faiblesse, mais une façon de priver les terroristes d’une victoire – un débat ouvert.
« Otage un jour, otage toujours ? » Florence Aubenas, ne voulant pas être réduite à cela, a repris le travail très rapidement. Elle explique pourquoi elle a pris ensuite un temps sabbatique et s’est inscrite à Pôle Emploi, pour vivre de l’intérieur la situation des travailleuses précaires et « dénoncer un problème économique et social » (dans Le quai de Ouistreham). Les réactions après coup l’ont surprise : « surprise de voir que la révélation de ces conditions de travail puisse poser un problème auprès des personnes que j’ai côtoyées ».
« En toute bonne foi », la journaliste a voulu se mêler à leur vie pour éviter la distance et les silences que peut susciter un micro tendu. Certaines lui ont reproché cette intimité, elles ont eu l’impression de « passer pour des imbéciles », « trop bêtes pour savoir dire non ». Lors d’un autre reportage dans une biscuiterie où les femmes étaient toutes moins payées que les hommes, elle a décrit leur « fatalisme » et elles lui en ont voulu, comme si elles étaient « des idiotes qui acceptent de se faire maltraiter. »
La tendance du journalisme, aujourd’hui, est de faire « parler les gens » : il importe de ne pas donner la parole qu’aux dirigeants, « l’homme de la rue » raconte aussi l’Histoire à sa manière. Mais ce n’est pas aussi simple de le montrer qu’elle ne l’avait cru d’abord, elle s’en est rendu compte. L’objectif, en évitant de « dupliquer » les institutions, reste d’intéresser les gens « à des sujets qui ne font peut-être pas partie de leurs préoccupations premières ». Un travail fondamental : « C’est le rôle des journalistes de maintenir des sujets importants. » (Son dernier livre, En France (2014), rassemble une cinquantaine d’articles parus dans Le Monde.)
Dans une partie plus personnelle de l’entretien, Florence Aubenas confie se ressourcer en pratiquant la natation, la marche, en allant au cinéma, en lisant. Les arts lui importent : « Un artiste vous fait entrer dans une autre dimension. » Le sujet qui préoccupe actuellement cette passionnée de justice sociale, « c’est la mobilité sur terre, les migrations. Dans trente ans, notre position vis-à-vis des grandes migrations économiques, écologiques, politiques, celles liées aux guerres, fera dresser les cheveux sur la tête des générations suivantes. »