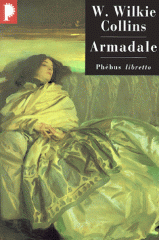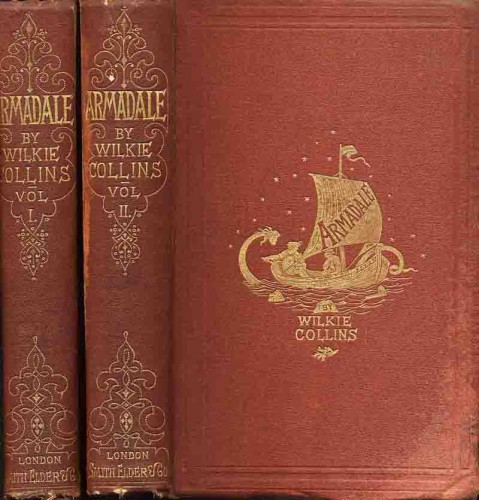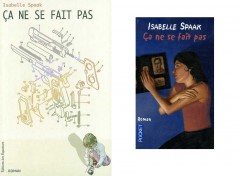Le titre fait mouche : Ça ne se fait pas (2004). Un roman, voilà ce qu’Isabelle Spaak, née à Bruxelles en 1960, a fait du terrible drame familial : en 1981, sa mère a tué son père avant de se suicider. « On hérite toujours de ses parents », confie-t-elle à Olivier Barrot. Certes. Dans toutes les familles. Et l’on en souffre parfois terriblement.

Rue Emile Claus à Ixelles © MRBC-DMS www.irismonument.be
La famille Spaak est très connue en Belgique, voire en Europe : Paul-Henri Spaak, le grand-père d’Isabelle, s’est attelé à la construction de la Communauté Européenne. Antoinette Spaak, première femme belge à présider un parti, est sa tante.
Vingt-cinq ans après les faits, Isabelle Spaak dédie à ses fils un récit fragmenté – souvenirs, bouts de correspondance, instants, images – sans chronologie. N’est-ce pas ainsi que le passé nous travaille, par des rappels, des questions, des blancs ? « Il n’y avait ni criminel ni enquête. Seulement un meurtre, le parfum d’un scandale qui pouvait éclabousser une famille au nom trop connu dans un pays trop petit. Et cette famille, c’était la mienne. »
C’est aux archives du Soir qu’elle est allée chercher des informations, des détails, mettant fin à un silence de plus de vingt ans sur l’événement qui a « mis en pièces » sa jeunesse : son père tué au fusil de chasse, sa mère électrocutée dans son bain avec un fer à repasser. Crime passionnel.
« Je voulais essayer de connaître les derniers jours de mon père ou plutôt ses dernières amours. Ce sont elles qui l’ont tué. » Sa fille avait une chambre réservée dans cet appartement de la rue Emile Claus à Ixelles où il vivait seul – si l’on peut dire pour un homme à « l’ardeur bibliophile » qui partout où il a vécu avait toujours « une pièce tapissée de livres du sol au plafond », et, en promenade, un livre en poche.
La tache de sang sur la moquette, les deux chariots recouverts d’un drap blanc dans l’entrée de l’immeuble, une crémation « presque à la sauvette ». Un dernier billet : « Tendres baisers de ton papa adoré qui est parti à Luxembourg et autres lieux jusqu’à samedi. » Isabelle Spaak a lu toutes les lettres conservées par son père, la plupart féminines, pour mieux approcher l’homme derrière la figure aimée. « Il nous laissait seules mais riches. Riches de conversations que nous n’avons jamais eues. »
Dans sa famille, il y avait d’abord « le grand homme », un des six « Pères de l’Europe », Paul-Henri : « Sa présence rythmait nos dimanches et métamorphosait nos vacances. » Ses petits-enfants ne savaient pas ce grand-père corpulent si célèbre. Isabelle Spaak recueille des bribes le concernant, évoque son entretien avec Léopold III (qui ne veut pas suivre ses ministres à Londres en mai 40), sa gourmandise, ses chiens, ses « patiences ».
A dix-neuf ans, Fernand Spaak, son fils unique, le père d’Isabelle, s’engage dans la Marine anglaise. Une tendre correspondance révèle l’amour entre père et fils, ils s’adoraient. L’élégance classique, « un peu ennuyeuse », de Paul-Henri Spaak contrastait avec celle du grand-père maternel, un dandy. Quant à Fernand, « il avait une façon d’accorder ses vêtements, de les choisir et d’y tenir comme à des amis ». La beauté « totale » de son père, perçue tant par les hommes que par les femmes, Isabelle Spaak en témoigne, il était « exalté, romantique et courageux aussi ».
Elle va à la rencontre des gens qui l’ont connu. On lui parle souvent de son grand-père, on reconnaît son nom de famille. « C’est devenu presque un jeu. Je prends goût à ces moments de flottement où le nom que je porte tourne comme une toupie dans la mémoire de mes interlocuteurs au hasard de leurs affinités politiques, cinématographiques, ou plus rarement littéraires. » Paul-Henri et ses frères. Sa nièce, Catherine Spaak, « actrice fétiche de la Nouvelle Vague ». Et Suzanne Spaak, sa belle-sœur, résistante fusillée en avril 1944. Pour le fils de celle-ci, « malgré les apparences, ce sont les femmes et non les hommes de la famille qui ont le plus d’importance. » Marie Janson, par exemple, sénatrice, membre du Parti ouvrier, première femme parlementaire belge.
Du côté de la mère d’Isabelle Spaak, Anna Farina, « une ascendance plus obscure » (une grand-mère « cocotte ») : « Ma mère qui n’aimait que mon père au point de quitter ses premiers enfants, pour en avoir trois autres avec l’amour de sa vie. D’elle me vient la fantaisie. » Que de pleurs, de soupçons, de jalousie. Il collectionnait les maîtresses. « Mais je sais que leur histoire n’est pas la mienne. »
Souvent accusée de trop aimer son père, Isabelle Spaak trouvait indigne la façon dont sa mère s’humiliait pour le garder, pour le ramener à elle. « Je ne voulais pas voir que parfois on n’aime qu’une fois. » Mais il tournait tant de femmes autour du diplomate à Washington, où il représentait la Communauté européenne. Réceptions, déplacements – « je n’ai gardé de mes parents que des signes d’éloignement. Nous menions notre vie sans qu’ils y prennent garde. » Elle s’en veut de n’avoir pas su comprendre sa mère, de n’avoir pas vu sa « trop grande solitude ».
Ça ne se fait pas est une exploration du chaudron familial où Isabelle Spaak intègre aussi des bribes de sa vie personnelle, reliant l’histoire de ses parents à ses propres rapports avec les hommes, avec les femmes, avec ses enfants, avec ses frères et sœurs. Qu’est-ce qui lui vient de sa mère ? de son père ? Dans un style net et parfois tranchant, plus autobiographique que romanesque, au-delà du drame familial, il s’agit aussi, dans un désir de vérité qui se heurte à l’impossibilité de tout savoir, de tout comprendre, d’essayer de faire la paix avec soi-même.