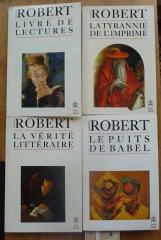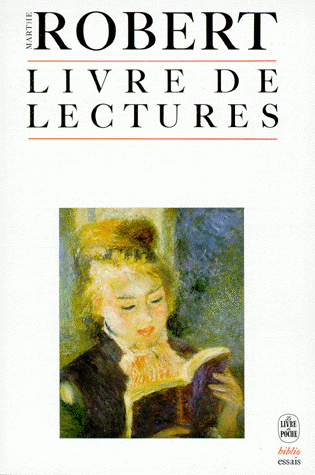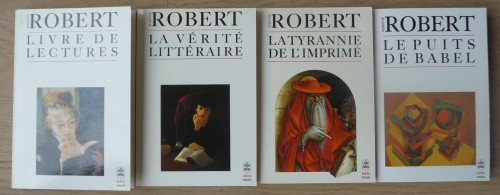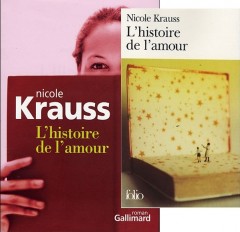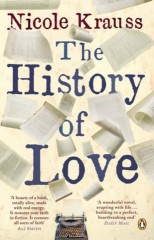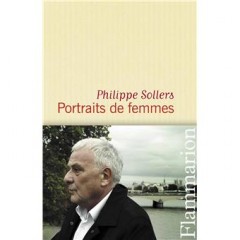Dédié en premier à ses grands-parents « qui (lui) ont appris le contraire de la disparition », en second à son époux, le premier roman traduit en français de Nicole Krauss (par Bernard Hoepffner) s’intitule L’histoire de l’amour (2005). Comme dans La grande maison, le récit déploie plusieurs intrigues, mais ses personnages que tout semble séparer vont peu à peu se rejoindre dans leur quête de vérité et de bonheur.

© Jean Lambert-Rucki (Cracovie, 1888 - Paris, 1967)
Il y a d’abord le vieux Léopold Gursky qui fait chaque jour « un effort pour être vu » par quelqu’un : demander quelque chose dans un magasin, hésiter, sortir sans rien acheter, par exemple. Ou même, expérience périlleuse, en réponse à une petite annonce, poser nu devant une classe de dessin pour quinze dollars. Léo a travaillé cinquante ans comme serrurier chez un cousin. Son ami d’enfance, Bruno, s’est installé dans le même immeuble que lui, il passe régulièrement et multiplie les attentions.
Enfant, Léo aimait écrire. Son premier livre parlait de Slonim, l’endroit où il vivait en Pologne, puis il a écrit une fiction « pour la seule personne de Slonim dont l’opinion (lui) importait » : son amie Alma. Son troisième livre, sa lectrice bien-aimée n’a pu le lire, partie en Amérique dès 1937 – « Aucun Juif n’était plus en sécurité. » Sa mère a sauvé Léo en l’envoyant se cacher dans la forêt, il y est resté trois ans et demi, avant de rencontrer des Russes et d’échouer pour six mois dans un camp de réfugiés. Les autres membres de sa famille n’ont pas survécu à la Shoah.
En 1941, il est parti chez un cousin à New York. Quand il a retrouvé Alma, elle lui a appris qu’elle était enceinte de lui quand elle avait quitté la Pologne. Isaac, son garçon, est le frère d’un autre enfant né deux ans plus tard, Alma a épousé le fils de son patron. « Tu as cessé d’écrire. Je te croyais mort. » Elle refuse de le suivre à présent.
Une nuit, quelqu’un appelle Léo pour une porte à ouvrir à l’autre bout de la ville. Il ne travaille plus, mais l’homme insiste, et Léo va le dépanner. Dans la bibliothèque de cette belle maison, il y a un recueil de nouvelles d’Isaac Moritz, Maisons de verre. Léo étonne le propriétaire en se déclarant le père de l’écrivain – il suit la vie de son fils, année après année, il s’est même rendu à une de ses lectures publiques, sans jamais avoir trouvé la force de lui dire qui il était. Mais un jour, il met dans une enveloppe kraft toutes les pages qu’il a écrites et les lui envoie.
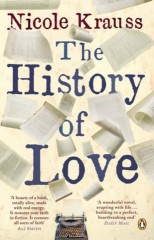
Alors commence le récit d’une autre Alma, Alma Singer, qui va avoir quinze ans. Elle écrit sur sa famille, sur son frère Bird, sur leur mère inconsolable de la mort de leur père. Celle-ci est traductrice. Un certain Jacob Marcus lui écrit pour lui demander de traduire en espagnol, contre une bonne rémunération, « L’Histoire de l’amour » de Zvi Lirvinoff, un Polonais exilé au Chili en 1941, un livre publié par une petite maison d’édition et devenu quasi introuvable. Or l’héroïne de ce roman porte le même prénom qu’Alma. Coïncidence qui ne va cesser de l’intriguer.
Et puis Léo Gursky apprend par le journal la mort de son fils romancier à l’âge de soixante ans. Il décide d’aller à ses funérailles, s’achète avec peine un costume convenable et arrive en retard, à la fin de la cérémonie. Bernard, le demi-frère d’Isaac, n’accorde de l’attention au vieillard que lorsqu’il lui parle de Slonim. Chez Bernard, Léo reconnaît une photo d’Alma enfant avec lui, que ses fils ont trouvée à la mort de leur mère quelques années plus tôt. Il la subtilise avant qu’on le reconduise chez lui.
L’histoire de l’amour, par tours et détours, révèle peu à peu les dessous de textes écrits par quelqu’un, confiés à quelqu’un d’autre, et leurs voyages dans l’espace et dans le temps. A Slonim, Alma avait plus d’un admirateur : « Elle était douée pour garder les secrets. » A New York, la jeune Alma Singer espère un improbable rendez-vous avec une autre Alma. Il faut parfois se perdre pour trouver.
Dans un entretien, Krauss répond à la question « A quoi sert la littérature ? » :
« Bellow disait que la littérature est une compensation pour la méchanceté du monde. J’aime ce mot : compensation. Je dirais aussi que la littérature est une longue conversation sur ce que c’est d'être humain. Les grands livres nous empêchent de nous recroqueviller face à la peur, ils réduisent la distance entre les individus, ils nous enseignent l’empathie. » (Libération)