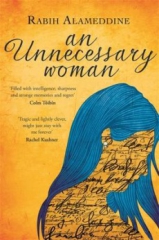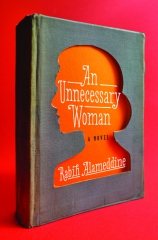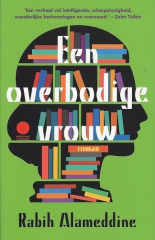Hubert Haddad possède l’art de nous immerger dans un univers différent à chacun de ses romans et d’y glisser, chaque fois, la contemplation, la douleur et l’interrogation du monde. Après le Japon du Peintre d’éventail et de Mā, Premières neiges sur Pondichéry (2017) nous emmène en Inde du Sud, à la suite de Hochéa Meintzel, un violoniste de renom qui vient de quitter Israël pour toujours.
A Chennai, l’ancienne Madras, il débarque au milieu des odeurs, la tête encore emplie des sons de Jérusalem où, déjouant les espoirs de paix, « rien n’est advenu que violence, rancune et spoliation. » L’ombre de Samra, sa fille adoptive, a bien tenté de le retenir, mais il laisse derrière lui « une vie d’espoir et de colère » : « Je ne suis plus Israélien et je ne veux plus être juif, ni homme, ni rien qui voudrait prétendre à un quelconque héritage. »
Une interprète est venue le chercher à l’aéroport : Mutuswami est émue d’accueillir le vieux musicien, de s’asseoir près de lui dans le taxi, de voir son étui à violon sur ses genoux. « Vous êtes bien jeune. Et musicienne, je l’entends à votre voix… » Elle a tout fait pour être choisie comme accompagnatrice par le Centre de recherche de l’Académie de musique. Meintzel avait refusé toutes les sollicitations durant ces dernières années – « A quoi bon ajouter du bruit au bruit quand le silence est si précieux » – avant d’accepter cette invitation.
Dans sa chambre d’hôtel, les bruits de Chennai refluent tandis qu’il rêve de Jérusalem et que revient son cauchemar : l’explosion, une pluie de sang, des sirènes d’ambulance. Le violoniste se souvient d’un jeune boursier du Kerala venu suivre son enseignement à l’Académie de musique de Jérusalem. Nandi-Nandi, un étudiant affable, à la peau noire cuivrée, ne comprenait rien à la société israélienne : « Il y voyait un système de castes bien plus complexe qu’en Inde avec un tiers de parias, dits Palestiniens ». Il était amoureux de sa fille – « C’était avant l’attentat, avant que lui-même cessât d’aimer la lumière du jour sur le visage des jeunes filles. »
Hochéa Meintzel est habité par le passé, le souvenir de Samra qui « s’était juré d’être fidèle à la musique jusqu’à sa mort », les images de son enfance à Lodz, en Pologne, avant de se retrouver à la rue des Rosiers à Paris, seul survivant du carnage. « Pourquoi faut-il infiniment traverser le même drame ? » Tous les visages des occupants de l’autobus qui descendait la rue du Carmel, un matin de juillet, vingt-sept ans plus tôt, lui semblent « d’une proximité hallucinante ». Semi-inconscient pendant des mois, il avait longtemps espéré que Samra ait survécu.
Dans la vieille Ambassador qui roule en direction de Pondichéry, Mutuswami se dit jaïniste, « une jaïna émancipée ». Hochéa l’interroge. Une semaine d’immersion musicale à Chennai lui a permis d’écouter des musiques de l’Inde et leurs « infinies variations ornementales ». Mutuswami lui décrit le paysage, les gens, le grand hôtel Kandjar. Ils se promènent sur le front de mer dans le bruit des vagues et des écoliers, des charrettes du marché. Près de la statue de Gandhi, un homme reconnaît Mutuswami, elle présente Hochéa à Anandham qui leur offre des glaces et fait la cour à la jeune femme.
Le lendemain, elle monte chercher le violoniste : « Il neige sur Pondichéry ! » Le vieil homme sent sur son visage « un baiser froid de spectre », on dirait de la neige, en fait c’est une pollution au phosphore due à un naufrage, de la mousse que la tempête déchiquète. Mutuswami n’est pas obligée de rentrer à Chennai et propose de lui servir de guide encore quelques jours, elle aimerait l’emmener à Kochi : « c’est si beau, le Kerala, je vous raconterais ».
Au premier tiers du roman, les thèmes sont en place : la musique, la violence, la mort, les souvenirs d’Israël et l’interrogation du judaïsme mêlés à la découverte de l’Inde à travers ses parfums et ses sonorités. « Hier est une tombe fraîche où tous les jours se désagrègent, et demain n’y rajoutera qu’un peu de terre. Mais l’heure est tranquille. »
Nuit et jour, Meintzel est un homme qui écoute, un homme qui se souvient, un homme qui accueille encore la vie, parfois malgré lui. Hubert Haddad, dans Premières neiges sur Pondichéry, raconte et décrit beaucoup. Son récit très poétique porte le flux et le reflux du questionnement intérieur en même temps qu’il ouvre aux émotions des rencontres et des échanges.
Interrogé sur le style, Haddad écrivait ceci, en 2013 : « Le style c’est l’autre, oserait-on même avancer, la reconstitution par le lecteur des valeurs d’expression et de conception, nécessairement intriquées, mises en jeu dans le texte, sachant qu’il n’existe guère, dans aucune langue, un récit, une nouvelle ou un roman qui ne soit pas subrepticement poème. »