A lire les Ecrits sur l’enseignement de Jacqueline de Romilly, pas de doute : professeurs français et belges, même combat ! Reçue à l’Académie Française en 1988, la grande helléniste a enseigné le grec au lycée, puis à l’Université de Lille ; elle a fait partie du jury d’entrée à l’Ecole Normale Supérieure, du jury d’agrégation. Professeur à la Sorbonne puis première femme professeur au Collège de France, elle parle d’expérience dans Nous autres, professeurs (1968) et L’enseignement en détresse (1991).
C’est « l’histoire d’une désillusion – la mienne – et celle d’une évolution qui, de mesure en mesure, a sapé l’enseignement – le nôtre », déclare Romilly dans la préface où elle dénonce le jargon présomptueux qui a envahi l’analyse de la langue et des textes à l’école, le manque d’entraînement des enfants à la discipline et à l’attention, la défiance envers le savoir alors que « le savoir est formateur et représente une liberté gagnée ».
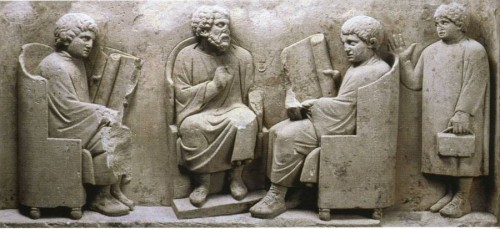
L’époque est au court, au rapide. A l’opposé de la lecture lente inhérente à l’enseignement littéraire. Quel beau défi ! Jacqueline de Romilly ne regrette pas d’avoir enseigné toute sa vie - « Cela a été mon bonheur et demeure à jamais ma fierté. » Elle témoigne de sa passion d’enseigner jusque dans les tâches les plus ingrates : corrections scrupuleuses, heures passées à choisir un texte ni trop difficile ni trop facile pour l’examen, combat contre l’indiscipline… Malgré la dégradation des conditions matérielles et morales du métier, l’expérience d’enseigner est incomparable : « Y a-t-il joie plus grande que de faire comprendre aux autres ce que l’on sait et ce que l’on aime ? » Les retrouvailles avec d’anciens élèves sont stimulantes. « Ce que l’on sème, dans l’enseignement, vit et se multiplie. »
Aux matérialistes d’aujourd’hui qui haussent les épaules – à quoi bon la culture ? – Romilly répond : « D’abord parce qu’avant d’être un luxe (le moins réservé à l’argent, précisera-t-elle plus loin, le plus propre à nier et à transcender toute hiérarchie sociale), la culture est une formation. » Ses arguments en faveur de l’apprentissage du grec, véritable école de lecture, n’ont rien à voir avec le culte du passé, au contraire. « C’est retrouver, dans leur fraîcheur première, les images d’un destin qui est le nôtre, afin de pouvoir, grâce à elles, vivre et sentir le présent ou l’avenir sous une forme plus humaine. »
Sachant qu’on la traitera de réactionnaire, l’auteur accuse, dans l’enseignement secondaire en particulier, les effets néfastes de l’égalitarisme – « un esprit généreux, mais souvent mal inspiré » - et de la politisation, l’insuffisance des crédits, le mépris des disciplines littéraires, plus menacées que les sciences. En histoire comme en littérature, les nouveaux programmes ont fait sauter le cadre chronologique ; aucune connaissance ne s’accroche plus à rien. La haine de l’élitisme – admis ailleurs, exacerbé dans le sport, « entraîne dans son sillage la ruine de la qualité de tous. » Or les Grecs distinguaient l’égalité arithmétique, qui donne à tous la même chose, et l’égalité géométrique, ou proportionnelle, qui tient compte des mérites. « Donner à tous un enseignement au rabais n’est pas une idée démocratique. »
Romilly déplore la dégradation du français – la norme ne serait plus d’actualité, alors qu’à chaque étape de l’évolution d’une langue « correspond une certification qu’il faut connaître, maîtriser et respecter ». Trop d’élèves ne savent plus analyser une phrase. Le jargon grammatical actuel, hérité plus ou moins de la linguistique, expose les élèves déjà en manque de repères à une terminologie différente d’une discipline à l’autre, de quoi ajouter à la confusion. Le recours aux textes littéraires est désormais interdit dans l’apprentissage des langues étrangères, balayant des méthodes même là où elles donnaient d’excellents résultats. Les nouveaux manuels de français privilégient les textes non littéraires, les dossiers thématiques. « La littérature en tant que telle n’est plus nulle part à l’ordre du jour. »
Jacqueline de Romilly prône un enseignement qui tire sa force du détour imposé aux esprits, obligés par la langue d’une autre époque, par un texte du passé, à prendre du recul, à s’extraire du temps pour se former d’abord à comprendre. Faire appel à la seule créativité des élèves, c’est les priver « du trésor des connaissances accumulées au cours des siècles ». Scandalisée par les pressions pédagogiques ou administratives qui découragent même les plus passionnés des enseignants, une voix forte rappelle les joies de la culture et le bonheur de les transmettre.

