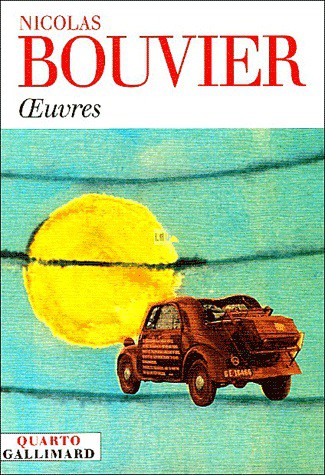Metin Arditi, l’auteur du récent Dictionnaire amoureux de la Suisse, est un « écrivain suisse francophone d’origine turque séfarade » (Wikipedia). Le Turquetto, son septième roman (sur douze déjà publiés) fait voyager ses lecteurs entre Constantinople et Venise, au XVIe siècle, dans un monde où il n’est pas facile pour un garçon très doué pour le dessin de réaliser son rêve de peindre à tout prix. Metin Arditi raconte son parcours exceptionnel.

Le Titien, Portrait d'homme, dit L'homme au gant, Paris, Louvre © 2009 RMN
Un détail de L’homme au gant du Titien en couverture et une note au lecteur ont de quoi intriguer : la toile du Louvre porte une signature où le « T » est en gris foncé et la suite en gris-bleu. Commandée par un musée de Genève qui l’a reçue en prêt en 2001, une analyse spectrométrique de cette anomalie « laisse à penser que la signature a été apposée en deux temps, par deux mains différentes, et dans deux ateliers distincts » – d’où l’hypothèse que ce tableau ne soit pas du Titien, d’où ce roman.
A Constantinople, en 1531, Elie, un garçon de douze ans vit mal à l’aise entre Arsinée, qui s’occupe de lui depuis la mort de sa mère, et son père Sami, employé pour un vendeur d’esclaves, un homme « maigre, voûté, mal soigné ». Dès qu’il le peut, il se faufile dans les rues, évite le mendiant cul-de-jatte, Zeytine Mehmet, qui voit tout et veut toujours faire la conversation. Elie va épier en cachette au Han, où se déroule la vente des esclaves, le moment où Roza, une Géorgienne, sera dénudée devant l’acheteur.
Son refuge préféré, c’est l’atelier d’un fabricant d’encres, Djelal, qui a remarqué son regard curieux et l’initie à la calligraphie. Djelal reste fidèle aux recettes de son père pour fabriquer des encres moins brillantes que d’autres mais très durables, en dehors de cela, il prie, il danse. Quand le petit, doué pour les portraits, lui offre le sien, il le refuse, la Loi musulmane interdisant la représentation – même s’ils croient au même Dieu, celui d’Abraham, explique-t-il à l’enfant, musulmans et juifs lui parlent « dans des langues différentes ».
Arsinée déplore les fréquentations d’Elie : « Chacun reste chez soi. » Son père, méprisé à cause de son métier, n’a pas d’autorité sur lui. C’est chez le pope de Saint-Sauveur, Efthymios, ébloui par les dons du garçon pour copier les fresques et qui le met en garde contre les Turcs – « Grecs, juifs, Arméniens, ils nous chasseront tous » – que le garçon à tête de « petit rat » apprend que Jésus était juif et que les moines chrétiens peuvent peindre, alors que le rabbin l’interdit. A la mort de son père, Elie se sauve. Au port, il se fait passer pour un Grec, Ilias Troyanos, et en échange d’un portrait, persuade un marin italien de le laisser embarquer pour Venise.
C’est là qu’on le retrouve en août 1574, plus de quarante ans plus tard. Il est devenu un peintre renommé sous le nom de « Turquetto », « petit Turc » comme on l’appelait à l’atelier où il faisait son apprentissage auprès du Titien. Il a épousé la fille d’un notaire et cela lui a ouvert bien des portes. D’abord connu pour ses portraits, il peint à présent des scènes bibliques. Plein d’admiration pour son maître, « si profondément humain », lui a opté pour une peinture « qui accueille et rassure ».
Rachel, une juive qui vit dans le ghetto de Venise et porte le bonnet jaune, lui sert de modèle ; il est séduit par cette beauté rousse, à rendre jalouse sa femme qui craint pour sa réputation. Au sommet de sa gloire, le Turquetto est choisi pour peindre une Cène immense qui ornera le réfectoire de la confrérie à laquelle il appartient – Cuneo, riche et vaniteux, veut faire sensation avec une œuvre qui devrait placer Sant’Antonio au premier plan. Les confréries rivalisent sans relâche à Venise pour attirer les faveurs des riches et des puissants.
Le Turquetto raconte l’histoire d’un peintre et de son triomphe avec cette Cène audacieuse qui va éblouir les artistes et les véritables amateurs d’art, mais faire scandale. Au thème de la création artistique et des conditions dans lesquelles travaillent les peintres de Venise se mêlent les intolérances religieuses, les rivalités politiques, l’exclusion sociale, et la mince cloison, parfois, entre la gloire et la chute.
L’identité d’emprunt du Turquetto, qui se fait passer à Venise pour un juif converti, lui a permis d’accomplir son rêve de peindre. Qui la découvrirait pourrait lui nuire. Metin Arditi s’est beaucoup documenté pour aborder son sujet avec justesse – « Ce souci du détail juste vient peut-être de la formation scientifique de Metin Arditi, qui, dans d’autres vies, fut homme d’affaires et surtout physicien » (Eleonore Sulser, dans Le Temps). Le romancier genevois offre là un roman passionnant, qui ramènera finalement le Turquetto à Constantinople.
 « Elie avait appris à récurer des brosses, fabriquer des enduits (de trente sortes au moins), broyer des cristaux (jusqu’à en obtenir le granulé juste), mélanger les poudres aux huiles et aux résines, et, pour chaque nuance, à obtenir les proportions parfaites, les couleurs et les transparences. Après deux ans d’atelier, il eut le droit de préparer les couches de fond. D’abord les simples, puis celles qu’il fallait appliquer en dégradé. Un an encore et il put travailler le fini des toiles. Il apprit à peindre des drapés, des dentelles et des visages, des chevelures et des nez, des bouches, des oreilles, et, pour finir, des mains, des gants et des regards. Un an plus tard, on le mit à reproduire certaines œuvres du maître dont on lui commandait des copies. Durant ces six années d’atelier, il reçut pour son travail de quoi se nourrir, des habits usagés, et un gîte qu’il partageait avec d’autres garçons, au bord du rio Sant’Angelo, une pièce humide et à l’odeur pestilentielle, été comme hiver. Il vécut ces duretés dans l’impatience, avec intensité. Il voulait tout comprendre, tout retenir. Maîtriser chaque détail. Faire comme le maître. Aussi bien que le maître. Et mieux que tous les autres. »
« Elie avait appris à récurer des brosses, fabriquer des enduits (de trente sortes au moins), broyer des cristaux (jusqu’à en obtenir le granulé juste), mélanger les poudres aux huiles et aux résines, et, pour chaque nuance, à obtenir les proportions parfaites, les couleurs et les transparences. Après deux ans d’atelier, il eut le droit de préparer les couches de fond. D’abord les simples, puis celles qu’il fallait appliquer en dégradé. Un an encore et il put travailler le fini des toiles. Il apprit à peindre des drapés, des dentelles et des visages, des chevelures et des nez, des bouches, des oreilles, et, pour finir, des mains, des gants et des regards. Un an plus tard, on le mit à reproduire certaines œuvres du maître dont on lui commandait des copies. Durant ces six années d’atelier, il reçut pour son travail de quoi se nourrir, des habits usagés, et un gîte qu’il partageait avec d’autres garçons, au bord du rio Sant’Angelo, une pièce humide et à l’odeur pestilentielle, été comme hiver. Il vécut ces duretés dans l’impatience, avec intensité. Il voulait tout comprendre, tout retenir. Maîtriser chaque détail. Faire comme le maître. Aussi bien que le maître. Et mieux que tous les autres. »