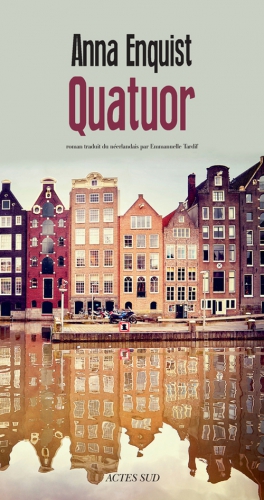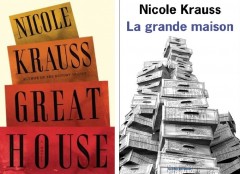Quatuor inquiet – ou d’un monde inquiet –, c’est dans un avenir indéterminé mais proche qu’Anna Enquist situe l’histoire de quatre musiciens amateurs. Quatuor (Kwartet, 2014, traduit du néerlandais par Emmanuelle Tardif) est un roman sur la musique et l’amitié, sur le deuil et la souffrance, sur le lien social, qui ne touche pas d’emblée, qui fait parfois froid dans le dos. Elle y dessine à petites touches des vies de femmes et d’hommes qui habitent une ville d’eau, Amsterdam peut-être, et y travaillent. On les découvre l’un après l’autre, sans transition. Leurs rendez-vous musicaux apportent à chacun d’eux quelque chose d’essentiel.
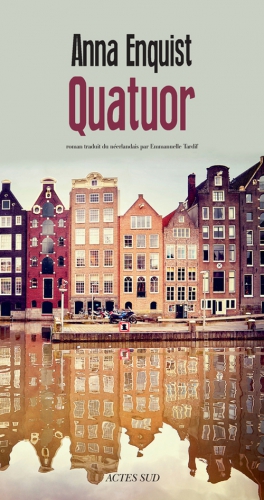
Le récit s’ouvre sur un vieil homme à la fenêtre de son jardin qu’il néglige – « Personne ne lui a encore fait de reproches, mais ce n’est qu’une question de temps. » Un genou mal en point le fait souffrir à chaque déplacement, mais il passe outre pour sortir le violoncelle de son étui : il attend son unique élève, Caroline. Finis les voyages et les concerts, les cours aux élèves les plus doués du conservatoire. A présent, toute l’énergie de ce violoncelliste renommé passe dans l’effort pour paraître encore dynamique, une condition nécessaire pour qu’on le laisse vivre seul dans sa maison. Quand il sort son sac-poubelle, un gamin souriant, dont il se méfie d’abord, lui vient en aide. Est-ce par simple gentillesse ?
Heleen travaille comme infirmière dans un cabinet médical où son amie Caroline exerce son métier de médecin généraliste. Pleine d’énergie, Heleen veille à tout, au travail et à la maison, elle correspond aussi avec des détenus de longue durée (écrire aux demandeurs d’asile est désormais interdit). Daniel, l’autre médecin du cabinet, s’intéresse au quatuor à cordes dont Caroline et Heleen font partie, comme violoncelle et second violon. Le premier violon est un cousin d’Heleen, Hugo, qui dirige un centre culturel dans l’ancien Palais de la musique ; Jochem, le mari de Caroline, joue de l’alto.
Daniel aime aussi la musique et parle avec Caroline du Quatuor des dissonances, « le plus beau quatuor de Mozart ». Caroline le connaît bien, elle ne peut se passer de musique classique – « Les mots la fatiguent, la musique lui apporte le repos ». Quel dommage que celle-ci ait perdu son importance, que les enfants ne l’apprennent plus. Heureusement Jochem a du travail à son atelier de luthier, peu pour des instruments neufs, beaucoup de restauration, ça lui va – « C’est de l’ouvrage. Et de l’ouvrage, il en a envie et besoin. Travailler l’aide à rester debout. »
Au cabinet, ses collègues la ménagent, mais Caroline a le visage fermé quand elle rentre le soir, ne s’intéresse guère au plat que Jochem lui a réchauffé pour manger avant son cours de violoncelle chez Van Aalst, elle chipote avec la nourriture. Lui contient sa colère : « Il est préférable de rester courtois, en reconnaissant que chacun de nous fait son possible et qu’il existe des divergences entre nous. » Quand Caroline propose de donner un mini-concert surprise pour les cinquante ans de Daniel, il n’est pas emballé, mais finit par acquiescer, pour elle.
Convoqué par l’adjointe au maire chargée de la Culture et des Affaires économiques, Hugo se rend à l’hôtel de ville à vélo. Le bilan d’occupation du Centre est problématique depuis qu’on a dissous les ensembles, l’Orchestre de la Capitale, etc. Les bureaux sont loués à des sociétés, des avocats, et maintenant l’adjointe veut faire du Centre un espace de prestige, un lieu d’accueil pour les missions économiques. Quand il lui promet un devis, elle l’arrête : cet édifice a été bâti par la ville, elle veut en disposer gratuitement. Hugo a compris et n’a plus qu’une envie, sortir de là. Encore un lieu perdu pour la musique.
Reinier Van Aalst a été le professeur de Caroline pendant trois ans au Conservatoire, jusqu’à ce qu’elle se décide pour la médecine – option qui présentait plus de sécurité, plus d’utilité à ses yeux. Aucune des difficultés du vieil homme ne lui échappe quand il lui ouvre la porte, mais elle ne dit rien. Il la fait rire en lui demandant si elle croit réussir « à maigrir encore » et résume sa philosophie : « accepter les choses telles qu’elles sont ». Alors elle ose s’inquiéter de son mal au genou, des médicaments qu’il prend, avec la grille d’évaluation « d’autonomie fonctionnelle » en tête : « Capacité à effectuer les travaux ménagers, à faire les commissions, mobilité, gestion, productivité, hygiène. » Trop de cases vides et on procède au « transfert » du patient qu’on ne reverra plus. Aussi le vieux professeur veille à masquer son infirmité au maximum et préfère entamer la leçon.
« On peut être à la fois grosse et belle », dit son mari à Heleen, qui prend plaisir à bien les nourrir, lui et ses trois fils. Elle se dit une fois de plus qu’elle devrait « juste éviter de suivre leur rythme » et manger moins, plus lentement. Quand ils partent s’entraîner au club de foot, elle en profite pour écrire des lettres, en suivant les consignes de discrétion en ce qui la concerne, tout en parlant de ce qu’elle fait.
C’est à la première répétition du quatuor que les drames personnels se précisent : la petite fille d’Hugo, divorcé, est chez sa mère. Il la confie parfois à Caroline et Jochem, avec un peu d’inquiétude – ils ont perdu leurs deux enfants dans un accident de car et, dévastés par le deuil, n’arrivent plus à communiquer entre eux. Anna Enquist sait de quoi elle parle, elle a perdu sa fille dans un accident en 2001. « Ça pourrait être du Bergman. C’est du Bergman. Une intrigue infime, des silences lourds de sens, des chagrins indéracinables, des âmes nues titubant de chagrin… » écrit Florence Noiville dans Le Monde des livres.
« Musicienne, pianiste concertiste, Anna Enquist est aussi psychothérapeute, spécialité qu’elle a longtemps exercée en milieu hospitalier. » (Quatrième de couverture) Axé sur les relations entre les personnages, Quatuor aborde sans fioritures les aléas de l’existence dans une société qui ne donne plus la priorité à l’humain, où les responsables politiques sont incapables ou corrompus, et où chacun s’efforce de résister à sa façon. Une fois le décor planté, la romancière confronte le quatuor à une épreuve inattendue et le climat romanesque bascule. C’est très « tenu » et d’autant plus violent, dramatique.
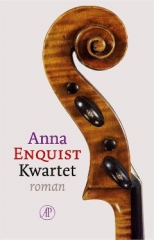 « Comment définir un son ? »
« Comment définir un son ? »