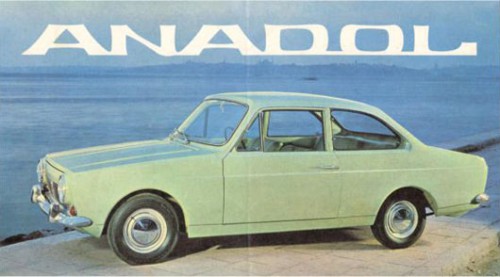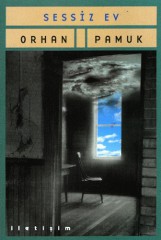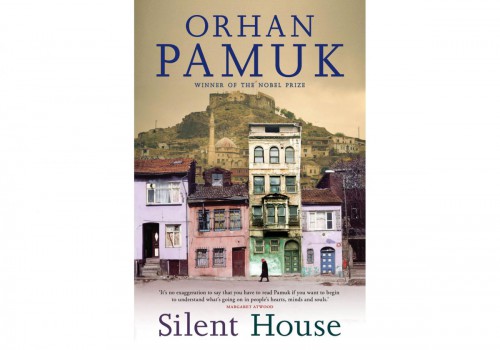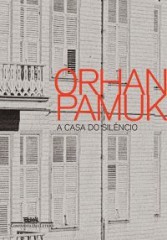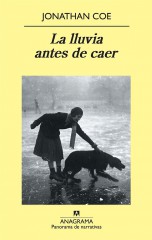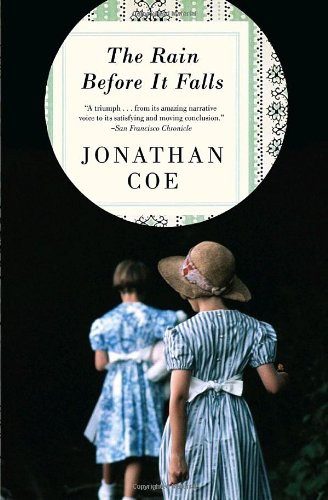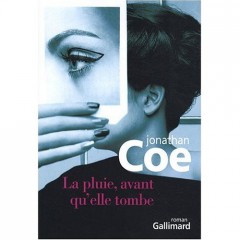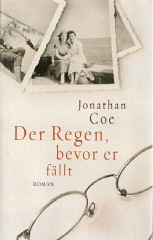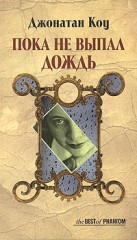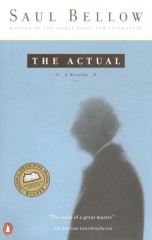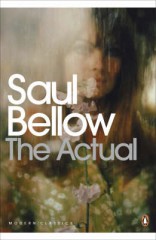Premier roman d’Orhan Pamuk traduit en français, La maison du silence (Sessiz Ev, 1983, traduit du turc par Munevver Andac) raconte les retrouvailles à Uskudar, au bord du Bosphore, des petits-enfants de Dame Fatma dans sa vieille maison. « Dame », comme l’appelle Rédjep qui est à son service, n’est pas commode. Rien n’est jamais à son goût dans ce qu’il lui prépare et, à 90 ans, elle pèse de tout son poids sur lui pour monter les dix-neuf marches qui mènent à sa chambre.
Quand Rédjep sort le soir, c’est dans l’espoir de rencontrer quelqu’un à qui parler à l’heure où la plupart sont devant la télévision. Dans un café du bord de mer, des garçons se moquent de lui – la faute à un article dans le journal sur « la maison des nains à Uskudar », lui explique le garçon : l’épouse du sultan Mehmet II y avait fait construire, « parce qu’elle adorait les nains », une maison construite à la taille de ses favoris, détruite dans un incendie au XVIIe siècle. A 55 ans, Rédjep est triste de devoir encore subir de telles moqueries à cause de sa petite taille.
A chaque chapitre de La maison du silence, le romancier turc change de narrateur, ce qui permet de varier les points de vue et de révéler les préoccupations de chacun. Dans l’attente de ses petits-enfants qui vont arriver le lendemain, Fatma, insomniaque, se souvient de Sélahattine, son mari médecin. Banni d’Istanbul en raison de ses opinions politiques pro-occidentales, il avait consacré le plus clair de son temps à écrire son « Encyclopédie » pour éclairer les ignorants.
Hassan, le neveu de Rédjep (le fils de son frère infirme, qui vend des billets de loterie), fréquente de jeunes « Idéalistes » (des fascistes) et les accompagne quand ils rackettent les commerçants. Le coiffeur, dégoûté, le traite de « cancrelat ». (Sans les aborder de front, Orhan Pamuk suggère les tensions politiques qui ont traversé la Turquie au XXe siècle.) Toujours à épier les autres, Hassan remarque l’Anadol blanche de Farouk qui arrive chez sa grand-mère avec sa sœur Nilgune.
C’est Rédjep qui les accueille. La vieille dame questionne ses petits-enfants sur ce qu’ils font : Nilgune étudie la sociologie, Métine termine le lycée et rêve de partir aux Etats-Unis. Farouk, l’aîné, chargé de cours et divorcé, bouffi par l’alcool, s’intéresse aux objets de son grand-père conservés dans la buanderie, « poussière du passé ».
Deux mondes se côtoient à Uskudar : les jeunes riches et bronzés qui se retrouvent chez la fantasque Djeylane, et ceux que la pauvreté rend envieux et frustrés. Parmi ceux-ci, Hassan, amoureux de Nilgune, ose à peine lui adresser la parole mais suit de loin ses faits et gestes quand elle se rend au cimetière avec toute la famille ou à la plage avec ses amis.
Comme sa grand-mère hantée par les discours obsessionnels de son mari contre l’ignorance et contre la religion (son athéisme militant avait éloigné peu à peu tous ses patients), Farouk est tourné surtout vers le passé. A Guebzé, il dépouille les archives locales. Ce travail d’archiviste lui plaît, le contact avec les vieux papiers jaunis, loin des jalousies entre collègues historiens : « derrière ces paperasses, il y avait suffisamment d’histoires pour y consacrer toute une vie ».
La présence des jeunes fait plaisir à leur grand-mère mais l’inquiète aussi : elle craint sans cesse que Rédjep ne leur parle, ne trahisse un secret – celui qui les lie, lui et son frère, à leur famille – qui pourrait les détourner d’elle. On suit donc en alternance le regard intérieur de Fatma sur sa vie passée et les préoccupations tout autres de ses petits-enfants, ainsi que l’évolution de la société turque sur plusieurs générations.
Métine est lui aussi amoureux, de Djeylane. Il la rejoint dès que possible, se mêle à sa bande d’oisifs qui trompent leur ennui en voitures de sport, canots à moteur, discothèques – mais il se sent à part. Et quand l’alcool coule à flots, il n’est plus assez lucide pour bien interpréter l’attitude de Djeylane à son égard.
La maison du silence est le roman des silences entre ses personnages, de la solitude et des pensées secrètes qui mènent parfois au drame. Les lecteurs familiers de l’univers romanesque d’Orhan Pamuk y verront bien des thèmes développés dans ses romans ultérieurs. L'écrivain y fait même une brève apparition, cité parmi d’anciens copains évoqués par Farouk : « Chevket s’est marié, Orhan écrit un roman. » Ces jours d’été à Fort-Paradis, l’ancien nom du port turc, révèlent davantage ce qui sépare tout ce petit monde que ce qui rassemble.