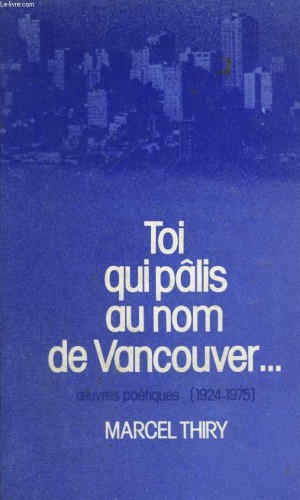Succédant à son père, Marcel Thiry achète et revend des stocks de charbon, de bois, il voyage. « Son existence est à présent ponctuée d’échéances, d’horaires de trains, de chambres d’hôtels, de Bourses du Commerce, de buffets de gares. » (Bernard Delvaille) Nouvelles sources d’inspiration.
« Tu vends des peupliers au marché de Roermonde.
Tu es venu par le moins lyrique des trains.
Bourse aux arbres : la roue ironique du monde
T’arrête ici pour faire un calcul en florins.
Bientôt, wagons, vous nous aurez assez blasés
De notre ancien plaisir de passer les frontières ;
Seuils des pays, nous vous aurons assez usés,
Et les virginités des gares douanières.
Où est le voyageur-Psyché qui adorait
Les Eros endormis des wagons de seconde,
Et les trains plus aventureux que la forêt ? .
Il vend des peupliers au marché de Roermonde. »
(Statue de la Fatigue, 1934)
1935 est pour lui l’année de partage entre la paix et la guerre, à nouveau. La Hollande où il se rend pour ses affaires entre dans son univers poétique et surtout le thème de la fuite du temps, abordé aussi dans des nouvelles, des récits, des proses.
« L’ange A-quoi-bon descend quelquefois dans les villes.
C’est souvent par des soirs changeants, qu’il va pleuvoir,
Que la rose des vents s’effeuille au ciel des villes ;
Alors l’ange A-quoi-bon sort des squares tranquilles.
On passe à travers ses lins simples sans le voir,
On croit que c’est le vent qu’on a sur la figure
Et sur le dos des mains heureuses, mais c’est sa
Robe et son corps immatériel qu’on traversa,
Et l’on en garde un bleu immortel en vêture.
Car l’à-quoi-bon bleuit subtilement la ville,
Un bleuté d’aquarium vient délaver la vie.
Rare et heureux celui qui a traversé l’ange,
Connu son corps de vent caressant comme un linge
Et qui en sort vêtu d’un bleu indifférent.
Rien ne lui est plus rien de l’amour, du courant
Des tramways cristallins, de la mort, des lumières ;
Il passe à travers les passants et les matières
Comme l’ange à travers son passage a passé,
Il laisse un peu de bleu au tramway traversé
Et ses yeux sont lavés d’avoir traversé l’ange
Et sont plus clairs d’avoir été des yeux d’aveugle
Et sauront voir, quand il descendra vers le Fleuve,
L’Ange à-quoi-bon assis sur la berge à l’attendre. »
(Ages, 1935)
Le thème du temps destructeur gagne du terrain – Usine à penser des choses tristes – mais il l’envisage sans trop de mélancolie, serein, lucide. Il se réjouit que sa fille Lise (virologue renommée) accompagne son « grand âge ». Et chaque année, heureusement, ramène les fleurs de saison, jacinthes bleu-Pâques, asters, colchiques. Les arbres, il en fait commerce et il les aime, ils reprennent vie dans des vers libres :
« Tous les arbres que j’ai tués se mettront quelque jour à revenir
Non tels que je les aurai mutés par commerciales métamorphoses,
Non pas distribués comme ils le sont par mes contrats et mes factures
Au large du monde avide et réceptif… »
(Prose des forêts mortes in Trois longs regrets du lis des champs, 1955)
Marcel Thiry, poète, marchand, a aussi été très actif dans la vie publique : membre, puis secrétaire perpétuel de l’Académie royale de langue et de littérature française de Belgique, membre à vie du Conseil international de la Langue française, cofondateur du Rassemblement wallon, un parti défenseur des francophones pour lequel il a été sénateur, puis sénateur européen. A l’écart des courants et des modes, « Marcel Thiry incarne en quelque sorte l'homme pressé de la poésie belge d'expression française » (Karel Logist )
« Hiver. Les révélés du noir sur vert et gris.
Hiver pour la fine écriture des branchages
Tracée en phrase collective au long des pages
De ciel, par longs dessins épiés incompris,
La diffuse arabesque au-delà des langages,
Dont même celle qui nous attend, notre lot
Final, elle la totale, n’a pas le mot. »
(L’Encore, 1975)