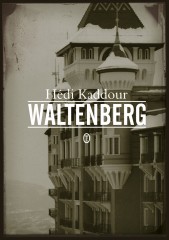Organiser une rencontre entre Proust et Joyce au Ritz, le 18 mai 1922 – il a dû s’amuser, Patrick Roegiers, en écrivant La nuit du monde (roman, 2010), en tout cas il nous amuse. C’est brillant d’érudition, jamais pédant, une douce folie pour deux génies de la littérature du vingtième siècle. Bourré d’anecdotes et d’inventions, son roman, dédié « à ceux qui lisent », construit autour de ce rendez-vous imaginaire parfaitement vrai trente-deux chapitres qui ont chacun leur couleur, leur ton, leur rythme.

Jacques-Emile Blanche (1861-1942), Portrait de Marcel Proust, 1892 © ADAGP, Paris - photo RMN
Première partie : La soirée du Ritz. Elle débute par l’apparition d’un « personnage irréel que l’on n’attendait plus » ; « affété comme une gravure de mode, emmitonné dans cet accoutrement d’une autre époque », Proust porte huit manteaux l’un sur l’autre, ce qui ne l’empêche pas de grelotter, même en mai. « Il avait l’air d’un enfant très vieux négligé par sa mère et qui sentait le moisi. » C’est ce qui s’appelle réussir son entrée. Le chapitre deux est tout aux sonorités du nom – « qui s’énonçait « Prou » » – et du palace – « le vlouf ! des chasses d’eau, le broooeeewww de la baignoire qui se vidait, le cloc ! clop ! floc ! plic ! ploc ! du robinet qui gouttait », etc. Marcel Proust (qui détestait qu’on le nomme par son
nom seul) « trouvait le métier d’hôtelier un des plus humains qui soient et savait comme personne que la vie de l’hôtel, où les hommes se fuient, était l’image même de la société. »
Ce jeudi soir, Violet et Sydney Schiff ont offert, en tant que mécènes, une représentation du Renard d’Igor Stravinski aux « gensdelettres et amis des zarts ». Ils se targuent d’avoir révélé l’œuvre de Proust aux Anglais et trouvent l’écrivain changé depuis leur dernier passage à Paris. Le « filsàmaman » né en 1871 vient de terminer A la recherche du temps perdu. Déjà introduit par leurs hôtes dans « le petit salon rouge cerise », Joyce qui a salué « madame Sniff » confond ce Schiff avec « Ettore Schmitz, vrai nom d’Italo Svevo, qui avait en partie servi de modèle à Bloom » ou avec Schimpff, libraire, et d’autres Schniff’s. Violet Schiff « guignait Joyce, tout rétrignolé sur son siège, la tête rejetée en arrière, les yeux baissés sous les grosses lentilles, les jambes croisées – sa pose habituelle –, la cheville gauche placée sur le genou droit, qui frottait l’une sur l’autre ses longues mains étroites et baguées qu’il nouait souvent sur les rotules ou bien calait sous le menton. »

James Joyce photographié par Berenice Abbott, 1926.
L’Irlandais est à Paris, « la dernière des villes humaines » depuis juillet 1920, pour finir son « Ulysse à Dublin ». Tennis aux pieds, il veille à l’excentricité de sa tenue, n’ayant pas les moyens de s’offrir des vêtements neufs. Proust : « Voyez-vous du monde à Paris, cher Joyce ? » – Joyce : « On m’a présenté à des tas de gens sur lesquels j’ai tout fait sauf, semble-t-il, une bonne impression. » James Joyce est superstitieux et curieux, de l’homosexualité entre autres : « Est-ce une question de goût, de glande ou de tact ? » – Proust : « Non pas, c’est une question d’habitude. »
Roegiers s’intéresse de près aux intimes de Proust, aux lubies de Joyce, à leurs préférences alimentaires, à leurs phobies. Il raffole des détails. En 1919, Proust reçoit le prix Goncourt pour A l’ombre des jeunes filles en fleurs. « Du jour au lendemain, il était devenu une marque déposée » : eau de Cologne, poudre Legras, boules Quiès, coiffeur François, gilets Rasurel, lavallières Liberty… Liste de ses fournisseurs préférés. Liste des vacheries : « un snob, un attardé, un imposteur, un oisif, un élitiste, un indolent, un cloisonné, un soporifique » – l’auteur ne se prive pas d’énumérer tout ce qui s’y prête. Idem pour Joyce, « le pauvre type » traité « de fou, de pitre, d’espion, d’ignoble bouffon, d’alcoolique incurable, d’anthropophage, de cocaïnomane » et la suite n’est pas triste. Proust et Joyce sont comparés, distingués, taillés en facettes comme des brillants, résumés par leur même conception de l’écriture : « la vie comme un livre, le livre comme un monde. »
La seconde partie du roman, plus courte, s’intitule L’enterrement de Marcel. L’auteur y raconte la fin du plus sensible des écrivains, achevé par « son hygiène bizarre », à cinquante et un ans. Le 22 novembre 1922, à son enterrement au Père-Lachaise arrive Joyce « en costume noir de seconde main », doublant le pas pour rejoindre le groupe d’illustres écrivains au rendez-vous de l’amitié littéraire : « Tous ne l’avaient pas lu, mais tous étaient en larmes. » L’auteur convoque dans ce cortège Shakespeare et Cervantès, Molière et Baudelaire, Racine et Kafka, entre autres, pour une joyeuse comédie de mort fictive, avant de conduire Joyce lui-même à son dernier mot. Patrick Roegiers, la nuit, réinvente le monde.