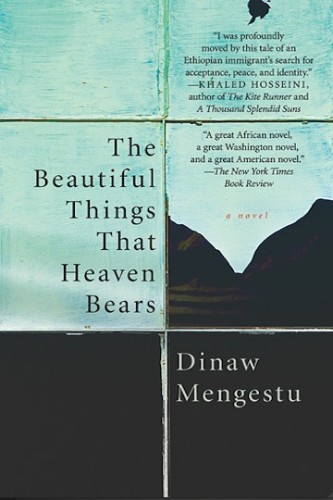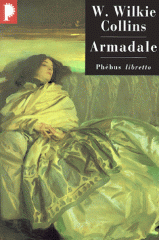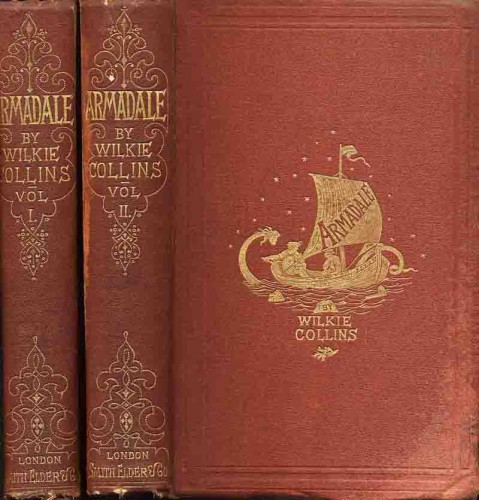Stéphanos tient une petite épicerie sur Logan Circle à Washington. Il est le narrateur d’un roman émouvant de Dinaw Mengestu, Les belles choses que porte le ciel (2006, prix du Premier Roman étranger 2007, traduit de l’américain par Anne Wicke). Tous les jeudis, ses amis Joseph et Kenneth viennent l’y retrouver. Ils se sont connus dix-sept ans auparavant, quand ils étaient tous les trois de nouveaux immigrants engagés comme bagagistes au Capitol Hôtel.
Kenneth est toujours bien habillé : ce grand Kenyan devenu ingénieur se soucie de la bonne tenue du commerce de son ami, le conseille, l’encourage à ouvrir sa boutique très régulièrement. Joseph – Joe du Congo – travaille à présent comme serveur et boit trop. Avec Stéphanos, d’origine éthiopienne, ils jouent depuis quelque temps « au coup d’Etat » : lancer un nom de dictateur africain, ensuite trouver le pays et l’année.
L’arrivée d’une nouvelle voisine apporte un peu de sel à la vie routinière de l’épicier. Le quartier change. Judith – une Blanche dans ce quartier noir et pauvre ! – fait restaurer la belle maison de briques à quatre étages abandonnée depuis dix ans près de chez lui, et s’y installe avec sa fille métisse, Naomi. Mrs. Davis, qui habite en face, se méfie : « Pourquoi, d’après vous, une femme comme ça peut avoir envie de vivre ici ? » – « C’est un pays libre, Mrs. Davis. Les gens peuvent vivre où ils le veulent. »
La fillette de onze ans vient bientôt traîner à l’épicerie de « Monsieur Stéphanos » et lui réclame des histoires. Quand il a lâché ses études pour ouvrir cette épicerie, il y a dix ans, Stéphanos a déçu son oncle, Berhane Sélassié, qui l’avait pris en charge à son arrivée et lui souhaitait un avenir brillant. « De fait, je n’étais pas venu en Amérique pour trouver une vie meilleure. J’étais arrivé en courant et en hurlant, avec les fantômes d’une ancienne vie fermement attachée à mon dos. Mon objectif, dès lors, avait toujours été simple : durer, sans être remarqué, jour après jour, et ne plus faire de mal à qui que ce soit. » Tenir une épicerie, c’était aussi avoir du temps pour lire – un livre tous les deux jours en moyenne.
Un soir, Judith l’invite à dîner chez elle. En congé pour un an, elle enseigne l’histoire politique ; des disputes continuelles avec le père de Naomi les ont amenés à se séparer. Naomi une fois couchée, Judith montre toute la maison à Stéphanos. Quand il s’en va, elle l’embrasse brièvement. Comme le pressentaient ses amis, il en est tout « enamouré ».
Son récit fait le bilan d’une vie qui s’englue, se ranime, se décourage, se reprend. Les bonnes résolutions sont précaires. Les rencontres heureuses semblent trop fragiles pour garantir un avenir. L’épicerie périclite. Joseph, l’ami de Stéphanos, lui a fait découvrir ce vers parfait dans L’Enfer de Dante : « Par un pertuis rond je vis apparaître / Les belles choses que porte le ciel. » Au professeur dont il suivait le cours sur le symbolisme de Dante, Joe avait expliqué « que personne ne peut mieux comprendre ce vers qu’un Africain » parce que c’est ce qu'ils ont vécu. « L’enfer quotidien, avec seulement quelques aperçus du ciel par moments. »
Lumière des journées sombres, la petite Naomi procure au jeune épicier le pur bonheur de lire pour elle, tout haut, Les Frères Karamazov, entre les passages des clients, de plus en plus rares. Mais une lettre d’avocat l’a prévenu des trente jours qui lui restent pour évacuer les lieux, à la suite des loyers non payés – « prévisible », selon Kenneth.
Nous découvrons peu à peu les circonstances dans lesquelles Stéphanos a dû quitter l’Ethiopie, l’arrestation de son père qui a menti sur l’âge de son fils aîné pour le protéger (à cause des tracts d’étudiants trouvés dans leur maison), ses premiers pas dans la société américaine. Nous suivons la relation entre Judith et son voisin avec les mêmes doutes et les mêmes craintes qu’eux. Noël est une période terrible pour qui a « conscience d’une existence solitaire et creuse ».
Dans le quartier de Logan Circle, la tension monte. La restauration des maisons anciennes et l’arrivée de nouveaux arrivants plus riches entraînent leur lot d’augmentations du loyer, d’expulsions. Des pétitions sont lancées. Et bientôt des pierres. Dinaw Mengestu, né en 1978 à Addis-Abeba, a fui l’Ethiopie en pleine révolution deux ans plus tard, avec sa famille. A travers le personnage bouleversant de Stéphanos l’épicier, le journaliste américain devenu romancier raconte ce que c’est que de « vivre » ainsi. J’ai pensé en le lisant à La dernière larme du lac Kivu, de Patrick François, récit traversé des mêmes espoirs et des mêmes douleurs de l’exil.
« Que disait toujours mon père, déjà ? Qu’un oiseau coincé entre deux branches se fait mordre les ailes. Père, j’aimerais ajouter mon propre adage à ta liste : un homme coincé entre deux mondes vit et meurt seul. Cela fait assez longtemps que je vis ainsi, en suspension. » Et aussi : « Nous essayons de faire de notre mieux. »