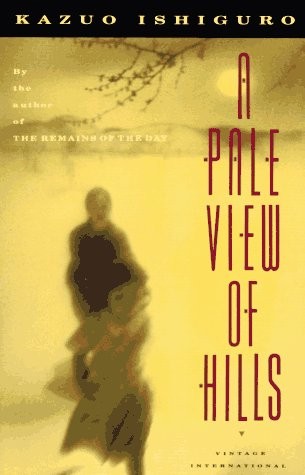Le titre du premier roman d’Anne-Sophie Stefanini, Vers la mer (2011), pourrait induire en erreur, le paradis n’est pas garanti au bout du conte. C’est l’histoire douloureuse d’une mère, Catherine, et de sa fille, Laure, bientôt dix-neuf ans. A la fin de sa première année d’université, celle-ci vient de rompre une liaison, décidée à entreprendre seule un long voyage en Afrique – Le Livre des Voyageurs, reçu pour ses six ans, est devenu son livre de chevet, Isabelle Eberhardt son modèle – comme sa propre mère qui a quitté la sienne au même âge pour un voyage à Rome, où Laure a été conçue.

Mère et fille forment depuis toujours une cellule-refuge. Laure ne connaît pas son père, sa mère est toujours restée évasive à son sujet. Comme Catherine, professeur d’histoire romaine à l’université, perpétuellement plongée dans les livres, Laure a choisi d’étudier un pan lointain du passé et de préférer la solitude tranquille du cocon familial. Avec le garçon rencontré à l’université, « elle était devenue une fille agréable (…), sortait, dansait, aimait. Mais c’était un mensonge. » Sans même parler de son départ le lendemain, elle a rompu, il n'a pas cherché à la retenir.
Catherine « avait pensé que Laure partirait sans bruit, pas même un mot sur la console du couloir », mais sa fille lui a proposé de l’accompagner jusqu’à la mer et elles ont décidé d’aller ensemble jusqu’à Nice, dans la vieille voiture dont elles ne se servent jamais à Paris. Une voiture ramenée de Rome, dont Catherine n’a même pas les papiers, « mais cela n’avait aucune importance. » D’habitude, elles préfèrent le train, les transports en commun, mais cette fois ce sera comme une aventure de prendre la route à elles deux.
Leur voyage commence gaiement, plein de rires et de paroles, et puis Laure, qui ne sait pas conduire, s’endort. Après Auxerre, Catherine s’arrête sur une petite aire d’autoroute, fatiguée. Sa discipline quotidienne lui a permis jusqu’alors d’endurer ses angoisses – « elle connaissait le mal dont elle souffrait » - mais à présent elle ne ressent plus ni peurs ni désirs, « il ne restait qu’un grand vide. » Quand Laure se réveille, elle va chercher deux cafés au distributeur, puis elles repartent dans la nuit.
Chez Catherine, tout déborde : son bureau, ses placards, ses bibliothèques. Elle ne range pas, ne se soucie de rien, paye ses impôts sans vérifier. Ni papiers, ni contrat d’assurance. Ses souvenirs de Nice affluent malgré elle : sa mère y est morte, devenue incapable de compter, de retenir son âge ou celui de sa fille. Sa maladie avait été prise en charge à un âge trop avancé, selon les médecins, qui s’étaient également enquis de sa santé à elle. Elle n’en a jamais parlé à Laure, « pour la protéger de cette peur, de cette souffrance ». Ni des premiers symptômes de la maladie d’Alzheimer reconnus chez elle-même.
L’éclatement du pneu avant gauche sonne un retour désagréable au présent et à la réalité. Catherine et Laure n’arrivent pas à changer la roue. Le garagiste qui les dépanne s’inquiète de l’état de leur véhicule, qui serait à vérifier avant de continuer. Il envisage de l’immobiliser, de prévenir la police, mais je ne sais quoi dans le regard de ces deux femmes l’en dissuade, et chacun repart de son côté.
Vers cinq heures du matin, mère et fille décident de faire une étape – Nice est encore loin et elles étouffent un peu. Elles s’arrêtent à Vienne, près de la gare où un bar-tabac vient d’ouvrir. « Vienna, la ville au bord de l’eau » : elles vont marcher le long du fleuve, puis s’aventurent dans les ruelles de cette ville modeste autrefois « cité romaine importante ». Les souvenirs de Rome affluent, mais Catherine n’explique rien, ne dit rien, laisse Laure la précéder sur le chemin archéologique.
Chacune rumine de son côté. Catherine pense à sa mère, à Rome. Laure comprend soudain qu’elle ne veut pas vivre comme sa mère, que leur séparation marquera la déchirure : « j’irai à Alger, à Annaba, à Tunis, à El Oued, à Cagliari aussi et puis je retrouverai l’Afrique, Ouergla et Aïn Sefra. » Un intrus habillé de gris s’incruste, insiste pour leur faire visiter le site du théâtre, elles n’arrivent pas à s’en défaire.
Au bout de cette journée, elles ne retrouvent plus la voiture. Arriveront-elles un jour à Nice ? Arriveront-elles à se parler ? à se séparer ? Vers la mer est une dérive lente hantée par les non-dits, les désirs et les peurs. Une quête émouvante, angoissante aussi, de sa propre vérité, difficile à partager. « Je voulais que ce soit un livre sur le voyage, et comprendre ce qui pousse à partir », a confié Anne-Sophie Stefanini dans un entretien. Récit d’un voyage ou d’une fuite ? L’étranger, c’est parfois le plus proche, et non le plus lointain.