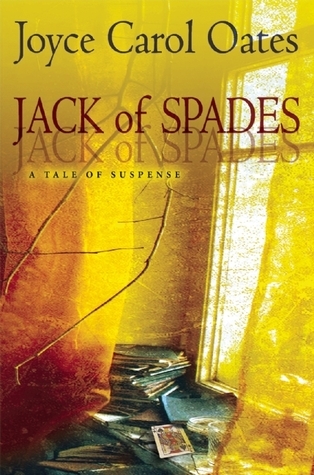La fille sans qualités de Juli Zeh m’avait laissé un assez bon souvenir, c’est ce qui m’a poussée à emprunter Décompression à la bibliothèque (2012, Nullzeit (Temps zéro), traduit de l’allemand par Matthieu Dumont, 2013). La couverture n’apparaît plus sur le site de l’éditeur, celle de l’édition anglaise est plus explicite. La plongée sous-marine ne m’attire pas du tout, mais bien le « thriller intelligent et jubilatoire » annoncé en quatrième de couverture.

Parc national de Timanfaya à Lanzarote (source)
Novembre à Lanzarote. A l’aéroport, Sven Fiedler attend Theodor Hast et Jolante von der Pahlen, de nouveaux clients très élégants. Dans le minibus, il propose comme d’habitude de se tutoyer, Theo et Jola sont d’accord. Cela fait quatorze ans que Sven et Antje se sont installés à Lahora, au bord de l’Atlantique. Sven y possède deux maisons : la « Residencia », où il habite avec Antje, et la « Casa Raya », plus petite, « logement de villégiature ».
Antje avait fait émerger là une « oasis » où il y avait des fleurs toute l’année « à la lisière du désert de pierres ». C’était elle qui installait les clients, gérait les réservations, se chargeait de l’entretien, pour laisser Sven à ses activités de moniteur de plongée. Ils forment un couple discret en contraste avec Theo et Jola, l’écrivain et l’actrice attirent les regards.
Le récit dont Sven est le narrateur alterne avec le Journal de Jola. Dès le premier jour, son état d’esprit y apparaît : le goût de la contradiction, le mépris du « vieil homme » (Theo) – « Je ne le provoquerai pas, et il ne se laissera pas provoquer. Cessez-le-feu. » – et sa motivation, décrocher le rôle de Lotte Hass, célèbre photographe et plongeuse sous-marine, une pionnière. Elle trouve Sven « rayonnant », s’interroge sur ses relations avec Antje, une jolie blonde.
Quand Sven « google » le nom de Jola, il est surpris du nombre de résultats : l’actrice allemande, d’origine aristocratique, trente ans, est recensée partout, célèbre pour son rôle dans une série télévisée. Theo, son compagnon écrivain, a douze ans de plus qu’elle. Dès le repas de bienvenue, Jola parle du livre sur Lotte Hass qu’elle est en train de lire, elle veut améliorer ses compétences pour mieux jouer la célèbre plongeuse dans un film.
Bien que la vie privée de ses clients ne le concerne pas, Sven comprend vite que ces deux-là, en désaccord sur presque tout, ne sont pas « faits l’un pour l’autre ». Antje trouve que Jola, qui n’a pas mangé grand-chose, a « l’œil un peu hagard », et qu’une femme comme elle serait moins nerveuse si elle avait des enfants – une remarque que Sven n’apprécie pas, il n’a pas envie d’en avoir et n’aime pas les jugements sur les autres. De son côté, dans son Journal, Jola écrit qu’elle les trouve « normaux » et « sains », contrairement à eux deux.
Lors de la première sortie en mer, Sven découvre la silhouette parfaite et musclée de l’actrice, « une statue vivante », tout le temps en train de provoquer son compagnon, qui lui rend coup pour coup. Pendant l’exercice de surplace à huit mètres sous l’eau, Theo est soudain privé d’air et se propulse vers la surface. Aucun danger à cette profondeur, mais Sven est furieux : il a compris que Jola a fermé un robinet dans le dos de son compagnon. De retour sur la plage, il éclate. Il leur laisse une dernière chance. Si l’un d’eux fait encore une telle « connerie », il arrête l’entraînement, « peu importe qui ils étaient, pour qui ils se prenaient et combien ils payaient. »
Les réactions des uns et des autres confirment rapidement que Décompression est bien un « thriller », en raison des risques de la plongée et de l’atmosphère de perpétuel règlement de compte entre Jola et Theo. Sven, que Jola cherche ouvertement à séduire pour susciter la jalousie, n’a probablement pas encore compris à quel point la compagnie de ces deux-là est risquée – pour eux, mais aussi pour sa relation avec Antje qui observe leur manège.
Un soir où il se retrouve seul avec Theo, celui-ci lui explique le milieu où est née Jola, fille d’un important producteur de cinéma, qui attend toujours « qu’on lui donne ce qu’elle veut ». « Pour elle, je ne suis qu’un substitut dans la quête de l’amour paternel. Tant que je ne lui en donne pas, elle reste avec moi. Et se venge un millier de fois par jour. » Pourtant il l’aime. Et il recommande à Sven d’être prudent. Le moniteur paraît naïf dans cette affaire.
Juli Zeh sait comment « fabriquer » le malaise, l’attiser, compliquer les situations, faire douter le lecteur de la réalité des choses, surtout quand le récit de Sven et le Journal de Jola donnent des versions contradictoires sur ce qui s’est passé dans la journée. La description froide de la violence dérange. Bref, Décompression met en scène les pièges de la manipulation. Le roman m’a paru fort long, mais m’a tout de même tenue jusqu’au bout, par curiosité. S’il divertit, sans plus, ce roman ne m’a pas donné envie de poursuivre avec son autrice.
 « Nos genoux touchèrent fond à trois mètres à peine. Ils respiraient tous les deux un peu trop précipitamment en gardant une main sur le détendeur comme s’ils craignaient que celui-ci tombe de leur bouche. Mais c’était normal pour des débutants. La plupart des clients vivaient un petit choc quand ils respiraient pour la première fois sous l’eau. Ensuite, il y avait deux catégories de gens. Les premiers ressentaient une euphorie incroyable, une sorte d’orgasme cérébral déclenché par l’impression de faire la nique aux éléments hostiles grâce à la technique. Entièrement entourés d’eau et pourtant aussi libres de respirer qu’un poisson. Tels des hôtes dans un univers étranger. Les seconds se sentaient mal à l’aise. Ils avaient le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, ne faisaient pas confiance à l’appareil qui les approvisionnait en oxygène, et étaient mus par un besoin irrésistible de remonter à la surface. Ceux-là manquaient de sérénité sous l’eau. Il leur fallait beaucoup de pratique pour devenir de bons plongeurs.
« Nos genoux touchèrent fond à trois mètres à peine. Ils respiraient tous les deux un peu trop précipitamment en gardant une main sur le détendeur comme s’ils craignaient que celui-ci tombe de leur bouche. Mais c’était normal pour des débutants. La plupart des clients vivaient un petit choc quand ils respiraient pour la première fois sous l’eau. Ensuite, il y avait deux catégories de gens. Les premiers ressentaient une euphorie incroyable, une sorte d’orgasme cérébral déclenché par l’impression de faire la nique aux éléments hostiles grâce à la technique. Entièrement entourés d’eau et pourtant aussi libres de respirer qu’un poisson. Tels des hôtes dans un univers étranger. Les seconds se sentaient mal à l’aise. Ils avaient le sentiment de ne pas appartenir à ce monde, ne faisaient pas confiance à l’appareil qui les approvisionnait en oxygène, et étaient mus par un besoin irrésistible de remonter à la surface. Ceux-là manquaient de sérénité sous l’eau. Il leur fallait beaucoup de pratique pour devenir de bons plongeurs.