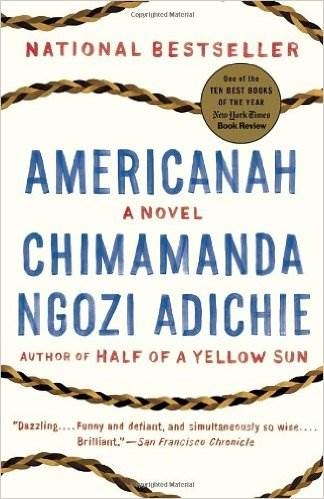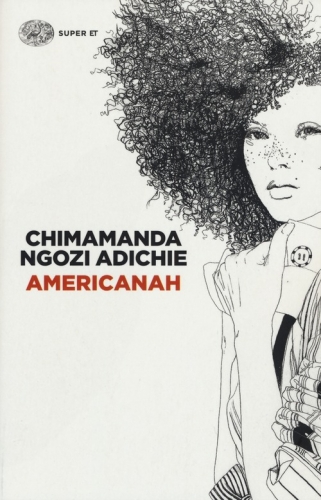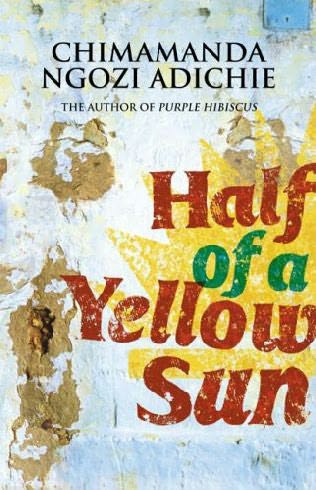Après avoir lu L’autre moitié du soleil, je m’étais promis de lire le dernier roman de Chimamanda Ngozie Adichie, Americanah (traduit de l’anglais (Nigeria) par Anne Damour, 2015), best-seller en anglais. Le temps des études est une des plus passionnantes périodes de la vie et ici, la romancière nigériane a choisi pour héroïne Ifemulu, qui a obtenu une bourse à Princeton, « le club consacré de l’Amérique ».
C’est entre autres parce qu’elle ne trouvait pas de salon de coiffure où les Noires puissent faire tresser leurs cheveux qu’Ifemulu a créé un blog sur les modes de vie : « Observations diverses sur les Noirs américains (ceux qu’on appelait jadis les nègres) par une Noire non américaine ». Un blog à succès (on en lira quelques billets dans le roman), des conférences à donner, une liaison – en apparence, tout va bien pour elle, mais au bout d’une quinzaine d’années, Ifemulu a le mal du pays et de son premier amour, Obinze, qui lui avait communiqué son rêve de vivre en Amérique ; à présent il est marié. Americanah raconte leur histoire, en alternance.
Après trois ans de liaison sans heurts avec Blaine, Ifemulu le quitte et fait part à tous ses amis de sa décision : elle va rentrer à Lagos, y travailler pour un magazine. La petite Sénégalaise qui lui refait des tresses l’a prise pour une yoruba – « Non, je suis igbo ». Très étonnée qu’Ifemulu veuille quitter l’Amérique, elle voudrait que celle-ci convainque son petit ami igbo d’épouser une non igbo, ce qu’il prétend impossible.
Obinze, son ancien petit ami, a réussi son ascension dans la société nigériane en servant de prête-nom à Chief, un homme d’affaires rencontré grâce à une cousine. Resté humble, il voudrait mener une vie honnête, mais il lui faut assurer le train de vie de sa femme Kosi et de leurs enfants. Quand Ifemulu lui envoie un mail, après des années de silence, il lui répond aussitôt.
Flash-back. Avant de partir pour l’Amérique, Ifemulu « avait grandi dans l’ombre des cheveux de sa mère ». C’est auprès de sa tante Uju qu’elle a trouvé son principal soutien, surtout après que son père a été licencié et que les retards de loyer se sont accumulés. La rencontre d’Obinze, qui aime les gens qui agissent comme bon leur semble plutôt qu’en obéissant aux conventions, marque le début d’une complicité sans faille. « Il lui apprit à s’aimer. » La mère d’Obinze, connue pour avoir résisté à un prof malhonnête, se montre très favorable à leur relation.
Ifemulu pensait que tante Uju pourrait leur avancer sans problème l’argent du loyer, elle est stupéfaite de découvrir que la maîtresse du Général qui vit dans l’aisance n’a quasi pas d’argent à elle. Quand Uju se retrouve enceinte, celui-ci l’envoie accoucher en Amérique d’un garçon, Dike ; il portera le nom de sa mère. La mort du Général dans un accident d’avion un an plus tard met définitivement fin à la vie facile de tante Uju.
A l’université de Nsukka (sept heures de bus), Ifemulu est une étudiante bien intégrée et considérée, prudente dans ses relations sexuelles avec Obinze, bien qu’ils envisagent de se marier. Des grèves continuelles les privent de leurs cours et tante Uju obtient alors pour Ifemulu une bourse en Amérique, où elle-même est partie s’installer pour achever des études de médecine.
Les premières impressions déçoivent Ifemulu. Il fait très chaud en Amérique, et si Dike est un enfant joyeux, sa mère est dans les difficultés : un examen raté, trois emplois pour survivre, des cheveux négligés – « L’Amérique l’avait domptée. » Ifemulu passe le premier été à découvrir comment on vit en Amérique, comment on y mange, tout en s’occupant de Dike qui va grandir comme un jeune Américain, tandis que tante Uju décroche son diplôme de médecin généraliste.
Ifemulu doit se débrouiller, elle a trop peu d’argent : emprunter une carte de sécurité sociale pour pouvoir travailler, prendre l’accent américain pour se faire accepter. Les études lui paraissent faciles, les étudiants s’expriment tout le temps et elle apprend à faire comme eux ; elle trouve sa place à la bibliothèque, lit Baldwin conseillé par Obinze, qui l’encourage à distance. Mais pas moyen de décrocher un job ; pour payer son loyer, elle finit par accepter de « masser » un entraîneur sportif pour cent dollars, puis fait une dépression.
Heureusement, une amie lui trouve une bonne place de baby-sitter chez l’amicale Kimberly Turner. Sans explications, Ifemulu laisse Obinze sans nouvelles du jour au lendemain, efface ses mails, n’ouvre plus ses lettres. Chez les Turner, elle observe les manières et les conversations, réagit quand quelqu’un y parle des Nigérians comme d’Africains « privilégiés ». Deviendra-t-elle une « Americanah », comme on surnomme les Nigérianes revenues d’Amérique, aux manières souvent affectées ?
Peu à peu, Ifemulu trouve là-bas une façon d’être elle-même. Elle sympathise avec Blaine, un Afro-Américain assistant à Yale, et se met à écrire sur le « tribalisme américain », basé sur la classe, l’idéologie, la région, la race. Son franc-parler, ses cheveux africains qu’elle finit par laisser naturels mettent certains mal à l’aise. Elle écrit : « Pourquoi les Noires à la peau foncée – américaines et non américaines – aiment Barack Obama. » Puis elle tombe sous le charme de Curt, le cousin à la peau claire de Kimberly.
Americanah est le roman d’apprentissage des jeunes Nigérians que la situation politique sans cesse troublée de leur pays pousse à chercher un avenir ailleurs, une formation en tout cas. Ils comptent sur les amis, la débrouille, les bons et les mauvais plans. Chimamanda Ngozie Adichie, qui vit aujourd’hui à Lagos et aux Etats-Unis, aborde sans tabou des questions sociales (race, classe, préjugés, comportements collectifs, différences entre Afro-Américains et Africains non américains) comme des aspects de la vie quotidienne les plus concrets (les cheveux des Noires, leur peau, leurs goûts alimentaires, par exemple).
Leurs amis n’ont pas compris la rupture soudaine entre Ifemulu et Obinze qui leur paraissaient inséparables. De son côté, lui est arrivé, avec difficulté, à obtenir un visa pour l’Angleterre et y a survécu un certain temps à l’aide de petits boulots très divers, avant de revenir au pays. Leurs chemins très différents vont-ils se croiser à nouveau ? On se le demande quand Ifemulu rentre à Lagos sans avoir trouvé quelqu’un avec qui partager vraiment ce qu’elle est devenue. Americanah est aussi une quête du grand amour.