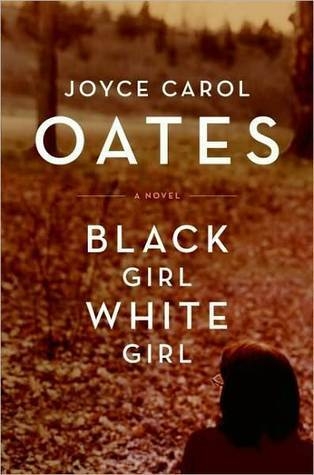En lisant le roman de Joyce Carol Oates, Fille noire, fille blanche (2006, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claude Seban, 2009), drame de la culpabilité et de la honte, de la vérité et du mensonge, j’ai repensé à ce qu’a écrit la romancière américaine dans Paysage perdu : « La solitude fait de nous tellement plus que ce que nous sommes au milieu de gens qui prétendent nous connaître. »
« J’ai décidé de commencer un texte sans titre. Ce sera une exploration, je pense. Une enquête sur la mort de Minette Swift, ma camarade de chambre à l’université, disparue il y a quinze ans cette semaine, à la veille de son dix-neuvième anniversaire, le 11 avril 1975. » Ainsi commence le préambule où la narratrice. Genna, ajoute : « j’étais celle qui aurait pu la sauver, et je ne l’ai pas fait. Et personne ne l’a jamais su. » Son père disait : « Certaines vérités sont des mensonges. »
Lors d’une forte tempête à l’automne 1974, une fêlure, due à la chute d’une branche, apparaît dans la vitre au-dessus du bureau de Minette : Genna et elle partagent depuis peu une chambre à Haven Hall, une résidence qui accueille des étudiantes boursières. Minette est la fille d’un pasteur noir ; Genna celle d’un avocat blanc, descendant de la riche famille d’Elias Meade, le fondateur de leur université, Schuyler College.
Genna qui n’a pas de bourse fait tout pour ne pas être perçue « comme une jeune Blanche gâtée et privilégiée. » Haven Hall est réputée réunir des jeunes femmes « de races, de religions, d’horizons ethniques et culturels différents », un modèle d’intégration. A Chadds Ford, leur « manoir français » célèbre pour son délabrement et ses vingt-cinq hectares, Genna Meade avait une grande chambre mais un mode de vie « spartiate » comme ses parents, Max et Veronica, et son frère Rickie qui a « rompu avec les idéaux des Meade pour étudier la finance à l’université de Pennsylvanie », indifférent aux questions sociales.
« Dès le début, Minette fut une énigme pour moi. Un mystère et un éblouissement. Je me sentais gauche en sa présence, ne savais jamais quand elle était sérieuse et quand elle ne l’était pas. » Eduquée dans le rejet du christianisme, Genna est fascinée par l’affiche que Minette a collée près de son bureau, une grande croix dorée sur fond fluo et, en capitales rouge sang, « Je suis la voie la vérité et la vie ».
Le 8 août 1974 a été une journée historique pour les Meade. Max, un activiste de gauche radical, criait après sa fille pour qu’elle vienne voir Nixon annoncer sa démission, la chute du président criminel, un miracle ! « Mad Max » au crâne rasé méprise la télévision, mais pour la circonstance, son père et Veronica (sa mère refuse depuis sept ans, depuis son retour après une longue absence, d’être appelée autrement) fêtent l’événement au whisky. « Et voici le détail choquant : Max se penchant brusquement en avant et crachant sur l’écran. »
La première fois que Genna a vu Minette, sans la connaître, c’était lors de la journée d’accueil : Veronica tenait à ce qu’elles revisitent la demeure Elias Meade. « Le paradoxe des Meade était le suivant : ils comptaient parmi les familles fortunées de Philadelphie mais, parce que quakers, ils menaient une vie spartiate. Dès sa jeunesse, Elias Meade avait fait don de son argent, convaincu que L’argent est une bénédiction qui devient vite une malédiction. » D’où l’ameublement minimal, fonctionnel. Une pièce y était consacrée à Generva Meade, « féministe militante et éducatrice », l’arrière-grand-mère de Genna qui porte son prénom.
Dès le début, ses attentions sont repoussées par Minette, qui ne s’entend avec personne. Elle est bientôt victime de divers incidents, comme la disparition de sa coûteuse anthologie de littérature américaine, ce qui fait naître un climat de suspicion. Genna s’étonne de la foi débordante et de la boulimie de Minette. Mais elle la défend toujours devant les autres qui la trouvent arrogante, bizarre.
Depuis longtemps, Genna s’inquiète des comportements des autres, que ce soient ses propres parents, puis leurs protégés accueillis dans leur maison (l’un tente de se suicider). Son père, trop proche de ses clients, est surveillé par le FBI. Les confidences à demi-mot de sa mère à son sujet ne font qu’augmenter son angoisse quand Max disparaît pour de longues périodes.
Fille noire, fille blanche raconte le trouble de Genna face à Minette. Elle voudrait la persuader de voir en elle une alliée, mais sa camarade reste fondamentalement secrète. Si Genna se confie davantage, elle a aussi appris à cacher tout un pan de la vérité familiale. Son inquiétude sur les deux tableaux ira crescendo – on connaît l’art de Joyce Carol Oates pour accroître peu à peu la tension, fouiller « le labyrinthe secret des consciences » (Nathalie Crom, Télérama) La fin tragique et l’épilogue permettront de comprendre la réponse de Genna à son père : « Aucune vérité ne peut être mensonge. »