A Colo
« Une jeune Anglaise dans l’Espagne de Franco », annonce la quatrième de couverture : Une femme inconnue de Lucia Graves (A Woman Unknown, Voices from a Spanish Life, 1999), traduit de l’anglais par Béatrice Dunner, est une des bonnes surprises de la collection Anatolia aux Editions du Rocher.
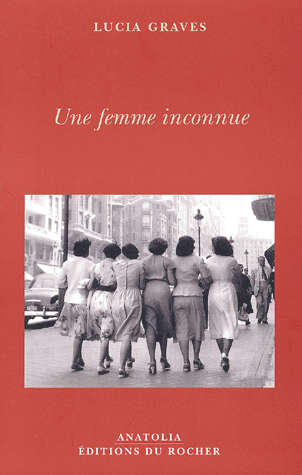
« Jeunes filles se promenant sur la Gran Via, Madrid, 1953 »
Illustration de couverture © Català Roca
La fille du poète Robert Graves a passé son enfance à Majorque où ses parents se sont installés quand elle avait trois ans. Elle revient en Espagne, des années plus tard, pour accompagner sa mère qui y vit toujours et doit subir à Barcelone une opération des yeux. Tant de choses lui parlent, dans cette langue catalane qui est la sienne, avec d’autres, que Lucia Graves, née en 1943, entrouvre les fenêtres de sa mémoire pour raconter sa vie en Espagne, le pays où elle a épousé un musicien barcelonais, où elle a élevé ses filles.
« Je parlais le majorquin, une variante du catalan, avec tout le monde au village, l’espagnol avec ceux qui venaient du continent ou qui vivaient à Palma – où, par ordre du régime franquiste, le « dialecte » majorquin se trouvait quasiment relégué aux cuisines. » Lucia Graves rend hommage à Blanca, la sage-femme du village ; c’est le premier des portraits de femmes courageuses, généreuses, qu’elle a rencontrées sur son chemin. « C’était une île, et le village dans la montagne était une île dans l’île, sa vie réglée par les rythmes d’un habitat naturel, et par des rituels si anciens que nul ne se rappelait plus leur origine. » Son enfance se déroule au plus près de la nature : « Le temps était variable, et les choses ne restaient jamais longtemps les mêmes ; après la pluie, les oliviers viraient au vert sombre sur leurs troncs noirs ; ils étaient gris argenté dans le vent et les montagnes pouvaient soudain disparaître entièrement dans un banc de brouillard. »
Ses parents s’installent à Palma pour qu’elle fréquente de meilleures écoles, la maison du village devient leur résidence secondaire. Si son école est « dirigée par un ordre français », elle n’échappe pas au système d’éducation national-catholique : « L’union de l’Eglise et de l’Etat était à la base même de l’idéologie fasciste de Franco. » Le cours d’histoire sert la propagande franquiste, les catholiques sont impitoyables envers la petite Anglaise protestante. Son salut devient pour Lucia « une source de permanente anxiété », jusqu’au jour où elle osera en parler avec son père, qui l’en guérira à jamais. Heureusement il y a Olga, son professeur de danse, son idole, une Lettonne de Riga. Et puis Jimena, qui est devenue pour les Graves « beaucoup plus qu’une femme de ménage, une amie, presque un membre de la famille ».
A quatorze ans, après un an à la maison pour parfaire son anglais, ses parents l’expédient avec son petit frère à Genève, dans une école internationale. Lucia prend conscience de ses difficultés linguistiques, en anglais surtout : « être trilingue, cela voulait dire que je n’avais jamais pu me concentrer véritablement sur aucune de mes langues, que chacune ne couvrait qu’un champ d’expériences donné, et qu’aucune des trois ne me permettait de m’exprimer en toute plénitude. » Son métier de traductrice, Lucia Graves en voit la source dans cette navette incessante entre l’espagnol et l’anglais, cette « permanente dualité » de son existence. En Suisse, son mode de vie très libre – look américain et rock and roll, baignades dans le lac et bains de soleil en maillot – contraste terriblement avec les conditions des Majorquines de son âge – « otra vida » – et pourtant elle regrette son « chez-moi ». Toute sa vie, elle s’est sentie exilée, en Espagne comme en Angleterre.
En 1960, elle rencontre Ramon, un batteur catalan : coup de foudre. Avant de l’épouser cinq ans plus tard, elle étudie les langues modernes à Oxford. Amoureuse, issue d’une famille libérale, elle s’attriste de ce qu’elle constate sur l’île quand elle y retourne : la liberté sexuelle des garçons alors que les filles n’en ont aucune, la « relation morne et sans joie » des couples officiellement fiancés, l’autoritarisme des maris, la soumission des épouses. « Au fil des années, j’ai vu les Espagnoles changer, je les ai vues lutter pour devenir des personnes à part entière, ce qu’elles auraient dû être naturellement si elles n’avaient pas été élevées dans une inconcevable pruderie, enfermées dans une longue répression qui leur avait coupé les ailes. »
Une femme inconnue, livre de mémoire, est loin de se limiter à l’autobiographie et ne suit pas forcément l’ordre chronologique. Lucia Graves y décrit une région, la Catalogne, une époque, les mentalités, la vie quotidienne, et les personnes qui ont marqué sa vie. Discrète sur sa famille (de huit enfants), elle parle surtout de son père, ce poète admiré dont un jour elle traduira les œuvres. Mais les paysans, les pêcheurs, les commerçants, les voisins, les amis, nombreux sont les liens qu’elle a noués dans le pays où elle a grandi puis vécu une large part de sa vie.
Une amie qui enseigne à l’école de ses filles, Joana, lui a conseillé d’un jour visiter Gérone et le call, son vieux quartier juif. Elle s’intéresse au sort des Juifs d’Espagne, les sépharades qui, eux aussi, avaient « de puissantes attaches » dans deux pays ; ils inspirent son premier roman, La maison de la mémoire. Lucia Graves aborde également l’histoire et la culture de la Catalogne, le déclin puis la renaissance de la langue catalane : « Nos filles ont donc été parmi les premiers enfants de Catalogne, depuis la fin de la guerre d’Espagne, qui aient appris à écrire correctement le catalan, à connaître leurs tables de multiplication dans leur langue paternelle ». A travers la seconde moitié du XXe siècle, c’est le bilan de sa propre vie de femme que nous découvrons dans ce témoignage d’une Anglaise sur l’Espagne où elle a vécu tant de choses essentielles.
Commentaires
Lucia Graves traductrice d'Anaïs Nin : pas vraiment la même rive idéologique que le franquisme...
Je pense à votre billet précédent "Vu de loin" (extrait de "Le coeur régulier" d'Olivier Adam) et je me dis qu'il pourrait se rapprocher de celui-ci... quand on vit dans deux pays, on comprend mieux ce qui s'y passe.
J'ai eu la chance de voir un long reportage sur ces retrouvailles de la mère et sa fille se promenant, revisitant le village de Deiá où elles avaient habité. Certains habitants se souvenaient fort bien de la famille, de Robert Graves.
J’ignorais que Lucia écrivait aussi.
Lors d'une prochaine excursion je ferai si tu veux des photos du petit cimetière (avec une vue superbe, tout en haut du village) où est enterré son père...et préparerai un billet sur lui.
Un livre que je lirai sûrement, il "me parle" tant!
Merci pour le lien "brouillardeux"...
@ JEA : Il y a dans ce livre de belles pages sur la traduction, et le témoignage de Lucia Graves est intéressant, à la fois intérieur et extérieur, puisqu'elle n'en est pas à une dualité près.
@ MH : Bonsoir, MH. Oui : vu de loin, vu de près...
@ Colo : Des photos et un billet, ce serait formidable, merci ! Le livre est pour toi, bien sûr.
c'est une époque délicate que dépeint ce livre, faite de résolutions, d'absolutions et de rédemption, pas toujours comme on s'y attend d'ailleurs.
j'ai l'impression de faire une balade littéraire avec deux amies qui me guident, Tania comme d'habitude ce billet est très intéressant et le destin de cette femme très singulier, j'entends en arrière fond la voix de Colo, pour moi Graves c'était l''écrivain de la mythologie et c'est amusant de voir les ramifications
@ Delphine : Lucia Graves en parle au quotidien, fait ressentir l'atmosphère pesante, à l'école, dans la rue. Les changements ne se font pas du jour au lendemain, en effet.
@ Dominique : Elle rend compte bien sûr des mythes que lui a contés son père. Quand elle a eu la rougeole, à douze ans, et qu'elle devait rester au lit dans la pénombre, à la seule lumière d'une ampoule rouge, l'auteur de "La Déesse blanche" lui dit qu'elle ressemble à "Perséphone aux Enfers" - c'est le titre d'un chapitre.