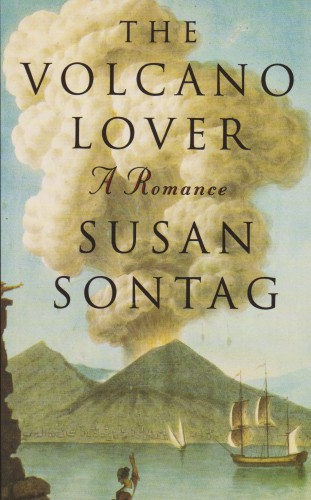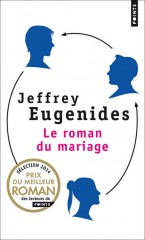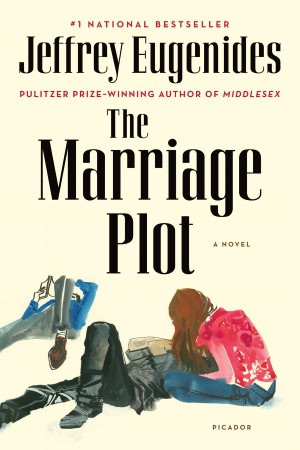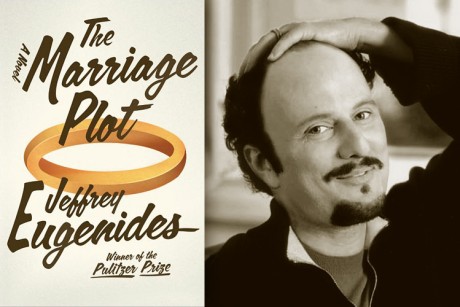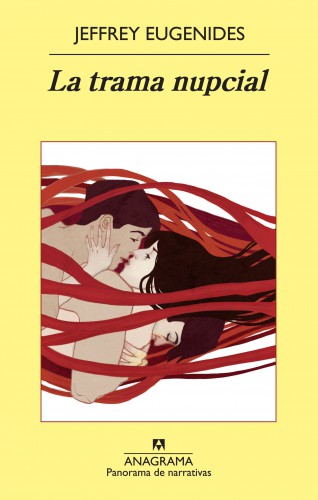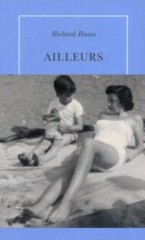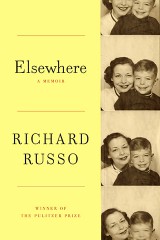Dans son prologue à L’amant du volcan (1992, traduit de l’anglais par Sophie Bastide-Foltz), Susan Sontag campe le sujet en trois temps : un marché aux puces à Manhattan, en 1992 – « Pourquoi entrer ? As-tu tellement de temps à perdre ? Tu vas regarder. T’égarer. Tu vas oublier l’heure. » ; une vente aux enchères à Londres, en 1772, où une « Vénus désarmant Cupidon » ne trouve pas preneur ; une éruption du Vésuve, spectacle sans pareil.
Il Cavaliere, comme on nomme l’ambassadeur anglais à Naples, quitte l’Angleterre après un congé qui a « rendu à son visage osseux une couleur laiteuse de bon aloi ». Il y laisse sa Vénus invendue – heureusement le British Museum a acheté tous ses vases étrusques et bien d’autres choses. Des malles, des caisses, des coffres sont déjà partis sur un cargo ; sa femme Catherine, « ses gens » et lui embarquent sur un trois-mâts jusqu’à Boulogne avant de regagner Naples « par voie de terre ».
Marié depuis seize ans à la « fille unique d’un riche hobereau », sans enfant, le Cavaliere a pu grâce à sa fortune asseoir sa carrière et nourrir sa passion de collectionneur, de tableaux surtout, dans un confort permanent. Diplomate hyperactif, il s’intéresse à tout et cultive une autre passion : fou du Vésuve, il y grimpe souvent, en ramène des morceaux de lave et lit tout ce qu’il peut sur le volcan.
Ami du jeune roi de Naples, qui l’oblige à lui tenir compagnie même à la chaise percée, il a appris à connaître ce « royaume de l’outrance, de l’excès, des débordements ». Catherine, qui souffre d’asthme, se tient autant que possible loin de la cour, c’est une musicienne remarquable au clavecin et une épouse irréprochable.
Quand arrive un lointain cousin du Cavaliere, l’entente est immédiate entre Catherine et le jeune homosexuel, sensible comme elle à la musique. Mais l’hiver venu, il repart. Le Cavaliere, déjà attristé par la mort de son singe Jack, perd alors son épouse de 44 ans, qui s’est endormie dans son fauteuil favori face aux myrtes. En deuil, il découvre l’indifférence à tout, la mélancolie.
Quatre ans plus tard, Charles, son neveu, qui administre les terres de Catherine au pays de Galles, lui envoie sa belle maîtresse de 21 ans, qui aime tant « admirer ». Le Cavaliere, de 36 ans plus âgé, résiste d’abord à « Mme Hart », puis prend goût à la regarder, à l’instruire, à lui montrer ce qui l’intéresse – c’est-à-dire tout : elle le questionne, l’écoute, s’enthousiasme inlassablement. Par lettres, elle a imploré Charles de la rapatrier, mais lui la pousse dans les bras de son oncle et elle en prend son parti. Une belle voix de chanteuse et l’art de poser sont d’autres de ses atouts – jadis modèle d’un peintre, elle incarne à présent, pour le Cavaliere d’abord, puis en public, les grandes figures féminines de l’antiquité.
En plus des progrès de ce couple surprenant – la maîtresse de Charles a un passé douteux, des manières « vulgaires », mais le Cavaliere va l’épouser –, Susan Sontag raconte des visites prestigieuses (Goethe, Elisabeth Vigée-Lebrun…), l’observation du volcan, la vie de cour, et les échos à Naples de la Révolution française puis de la Terreur, à laquelle répond l’éruption du Vésuve en 1794.
Arrive alors « le héros le plus valeureux que l’Angleterre ait jamais produit », un capitaine de 35 ans venu apporter au Cavaliere des dépêches urgentes, après que la France a déclaré la guerre à l’Angleterre. L’épouse du Cavaliere l’aide à obtenir du Roi le renfort de troupes napolitaines. Cinq ans de combats valeureux, un bras perdu, un rang d’amiral gagné, et puis « le héros fondit sur leurs vies ».
Ils se sont écrit entre-temps, tous les trois – l’épouse du Cavaliere « aimait admirer et voilà quelqu’un qui valait vraiment la peine d’être admiré. » Quand l’amiral revient à Naples, il est la coqueluche du roi et de la reine, du Cavaliere et de sa femme. A l’approche des républicains français, il embarque tout ce beau monde en fuite sur les navires anglais. Le Cavaliere loue alors un palais à Palerme et l’y accueille à bras ouverts.
L’ambassadeur devine que « le héros » s’est entiché de son épouse, quoique la sienne l’attende au pays. Mais il apprécie leur discrétion et songe à ses collections perdues dans un naufrage. L’amant du volcan conte ces amours diverses et une époque tumultueuse. Au récit se greffent d’intéressants apartés sur le bonheur, la passion de collectionner, l’art, la musique, la lecture, la beauté…
En observant le passé d’un œil contemporain, Sontag offre un point de vue singulier et un ton piquant à ce long roman. Eleonora de Fonseca Pimentel, poète napolitaine, « pure flamme » dans la Révolution, attendant d’être exécutée, y ajoute un contrepoint qui surprend, la mise en perspective finale.