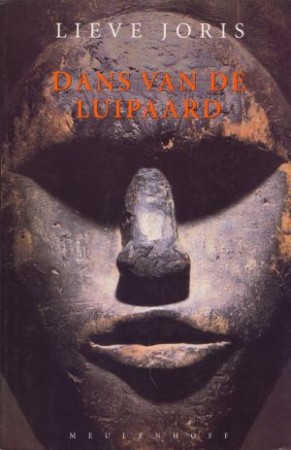Three junes - Jours de juin (2002), le premier roman de Julia Glass, s’ouvre dans la collection Points sous une belle couverture de plumes colorées, allusion à Felicity, l'attachant perroquet femelle confié à Fenno McLeod, le protagoniste des trois temps de l’intrigue, d’une maison à l’autre, dans la dernière décennie du vingtième siècle. Un bon livre pour commencer l’été.
C’est à Tealing, la maison des McLeod, que Paul a réalisé le rêve de sa femme : une grande demeure campagnarde, des fils, un élevage de collies, la première passion de Maureen. L’aîné, Fenno, et les deux jumeaux, Dennis et David, s’y retrouvent pour accompagner leur mère qu’un cancer va emporter. Fenno a quitté l’Ecosse et ouvert une librairie à Manhattan. Paul se sent mal à l’aise quand il voit revenir son fils homosexuel en compagnie de Mal, amaigri par le sida.
Juin 1989. Peu après la mort de sa femme, Paul s’est décidé à découvrir la Grèce, ses îles. Parmi ses compagnons de voyage, une jeune femme, Fern, retient son attention. Il aime la regarder dessiner, converser avec elle. A propos de Paris où elle séjourne grâce à une bourse, elle se montre moins enthousiaste qu’il ne l’imaginait à son âge : « Ce que je veux dire, c’est que les gens traînent leur vieille existence partout où ils vont. Il n’existe pas d’endroit assez parfait pour vous en débarrasser. » Paul aimerait errer d’île en île, et pourquoi pas, s’y trouver « une petite maison sur une colline surplombant des terrasses plantées d’oliviers et la mer Egée ».
Juin 1995. Les McLeod reviennent à Tealing pour les funérailles de leur père. Dennis, excellent cuisinier, et son impeccable épouse française ont trois filles. David, qui a hérité de sa mère la passion des animaux, s’est marié avec Lillian qui l’aide à la clinique vétérinaire, mais ils n’arrivent pas à avoir d’enfant. En préparant la réception des funérailles, Fenno les observe et se sent, comme toujours, différent, coupé de certaines choses, même si d’autres lui ont été données. La chance de vivre de sa passion pour les livres, grâce à sa librairie spécialisée dans les ouvrages sur les oiseaux ; l’amitié de Mal – le personnage le plus fascinant du roman, Malachy Burns, l’impitoyable critique musical du New York Times, occupe dans l’immeuble en face un intérieur merveilleusement raffiné ; la compagnie de Felicity, l’incroyable cantatrice aux plumes rouges et mauves que Mal, trop malade, ne peut garder chez lui. Plus compliqués sont les rapports de Fenno avec Tony, un photographe qu’il a rencontré devant une minuscule maison blanche inattendue dans New York, et qui passe sa vie à garder le domicile des autres en leur absence. A Tealing, Fenno l’expatrié est l’objet de toutes les attentions et découvre qu’on attend de lui bien plus que son avis sur le sort à réserver aux cendres de son père. A New York, Mal aussi a besoin de lui.
Juin 1999. Tony habite une maison près de la mer à Amagansett avec une amie, Fern. La jeune peintre des îles grecques est maintenant graphiste et travaille à des maquettes de livres. Son mari est mort, elle est enceinte d’un autre homme qui n’est pas encore au courant. « Souvent, elle se représente attachée à plusieurs laisses très longues, chacune tenue par un membre de sa famille éparpillée. Elle ressent des tiraillements et des secousses, et n’éprouve jamais un sentiment de totale liberté. » L’arrivée de Fenno et de son frère Dennis à Amagansett va éclairer les relations entre eux tous et faire naître de nouvelles complicités.
J’ai aimé l’atmosphère de Jours de juin, avec ses personnages entre souvenirs et désirs, entre ici et là, curieux des autres, affectueux avec leurs bêtes, et qui avancent parce que « L’ennui, c’est que si vous vous persuadez que le passé est plus glorieux ou plus digne d’intérêt que l’avenir, vous perdez toute imagination. »