Lui et l’autre ? L’auteur et son double ? Rivalités ? Gardons plutôt Valet de pique, le titre choisi par Joyce Carol Oates (2015, traduit de l’anglais (Etats-Unis) par Claude Seban, 2017) pour ce thriller qui commence brutalement par un coup de hache. « Cinq mois, deux semaines et six jours auparavant, cela avait commencé innocemment. Rien ne permettait de soupçonner que le « Valet de pique » jouerait le moindre rôle. »
Andrew J. Rush, 53 ans, honorable « auteur de romans à énigmes et à suspense », parfois surnommé le « Stephen King du gentleman », vit dans son village natal du New Jersey avec sa femme, Irina. Celle-ci ignore tout du « Valet de pique », dont personne ne connaît l’identité, son pseudonyme pour écrire des romans beaucoup plus noirs où il lâche la bride à ses fantasmes. Vu le succès croissant de son double, Rush craint de plus en plus que quelqu’un ne perce son secret et songe à y mettre fin.
Sa fille cadette, Julia, en visite chez eux pour le week-end, tombe sur une pile de livres de poche du Valet de pique, à la couverture racoleuse, qu’il a négligemment laissés sur une table de son bureau. Féministe, elle a envie de jeter un coup d’œil à ce bouquin manifestement « sexiste » et l’interroge sur l’auteur, qu’il prétend ne pas connaître.
Et voilà qu’il reçoit du tribunal du comté une assignation à comparaître : quelqu’un a porté plainte contre lui pour vol, un certain C. W. Haider – quelle absurdité ! Il décide d’appeler le tribunal pour en savoir plus, mais la greffière en chef ne lui donne aucune information, elle insiste pour qu’il comparaisse le jour dit. Cette affaire l’empêche de travailler sereinement. Il cherche son accusateur dans l’annuaire pour lui téléphoner, même s’il sait que c’est probablement une erreur – il voudrait savoir de quoi on l’accuse.
Une voix de femme lui répond et l’accuse de plagiat : il lui a volé des pages et des pages pour ses romans, elle entend bien le dénoncer et obtenir une compensation. « Elle est folle. C’est de la folie. Rien à voir avec toi. Appelle un avocat. Ne t’en mêle pas. » lui souffle Valet de pique. Bouleversé, Rush sent soudain menacée sa paisible et confortable existence.
Dans la ferme du XVIIIe siècle qu’ils ont rénovée, en bordure de la Mill Brook où vivent surtout des gens fortunés, il écrit dans son bureau au premier étage, une pièce lumineuse dont les fenêtres « donnent sur une pente herbeuse et sur un grand étang où glissent languissamment des oiseaux aquatiques (colverts, oies du Canada, cygnes). » Au-delà, une forêt caduque et « la courbe gris bleuté de la Mill Brook ». Sur une petite table ancienne à l’écart, il écrit à la main ses « romans Valet de Pique » en buvant du scotch, souvent après minuit, quand il ne craint pas d’être interrompu – sa « récompense » après avoir écrit une dizaine de pages du prochain roman d’Andrew J. Rush.
Cette manière de rompre sa « terreur routinière de la vie ordinaire » vient peut-être du drame vécu dans son enfance quand il allait avec son petit frère dans la carrière du parc de Catamount Park où seuls les grands se risquaient sur le plongeoir du haut – les images lui en reviennent souvent. Quand sa femme, se retrouvant seule au milieu de la nuit, vient voir s’il va bien, il supporte difficilement son intrusion ou son inquiétude à son sujet.
L’avocat de son éditeur prend contact avec l’écrivain pour le rassurer, il le représentera au tribunal où il lui conseille de ne pas se déplacer en personne, c’est plus prudent avec ce genre de « timbrée ». Il a déjà représenté Stephen King en personne – un modèle pour Rush, qui collectionne les exemplaires rares de livres d’horreur dans une bibliothèque secrète à la cave. Son client avoue avoir téléphoné à la plaignante, l’avocat le regrette, mais il est sûr de régler facilement cette affaire.
Valet de Pique est construit sur ces différents plans de la vie d’Andrew J. Rush : ses rapports étranges avec son double, sa vie perturbée par cette plainte inattendue, ses relations de plus en plus tendues avec sa femme qui s’inquiète de son comportement. Irina s’absente plus souvent pour son travail (elle donne des cours de dessin et s’est engagée dans diverses associations) ou des sorties entre collègues. En plus de cela, Julia a retrouvé dans un des romans du Valet de Pique des éléments inspirés de son propre vécu et met son père en garde contre cet auteur qui semble les connaître de près.
Joyce Carol Oates, dont les grands romans sont plus subtils que celui-ci, secoue son shaker rempli de ces ingrédients pour produire un suspense de plus en plus crispé : on sent qu’à tout moment, cela risque de déraper, et on peut compter sur JCO (qui a elle-même écrit des romans policiers sous pseudonymes) pour glisser vers la crise et nous secouer, en pimentant le tout d’inattendu. Si un divertissement bien noir vous tente, Valet de Pique vous attend.
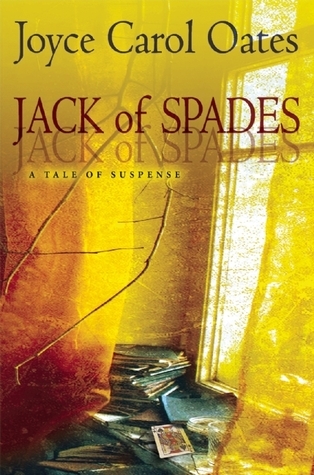
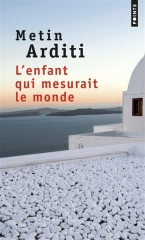 « Bien sûr, il y a le destin, ses coups de dés, les désordres qu’il sème à tout-va. Pourtant, le libre arbitre existe. Dans les choses petites ou grandes, nous avons toujours une part de liberté, petite ou grande, elle aussi. Moi, lorsque je me sens à deux doigts d’être emporté par la colère, je fais la promenade qui, du monastère, mène jusqu’au phare. Cela n’a l’air de rien. Et pourtant… Cette promenade me transforme chaque fois. Je la poursuis jusqu’à son extrême pointe, là où, par gros temps, les vagues s’écrasent contre les rochers. J’en reviens trempé mais calmé. Et cette promenade, je l’ai faite de ma seule volonté. A toi de chercher ce qui, dans ta vie, dépendra de ta seule volonté. Ne serait-ce qu’une promenade le long de la mer. C’est ta part de libre arbitre. »
« Bien sûr, il y a le destin, ses coups de dés, les désordres qu’il sème à tout-va. Pourtant, le libre arbitre existe. Dans les choses petites ou grandes, nous avons toujours une part de liberté, petite ou grande, elle aussi. Moi, lorsque je me sens à deux doigts d’être emporté par la colère, je fais la promenade qui, du monastère, mène jusqu’au phare. Cela n’a l’air de rien. Et pourtant… Cette promenade me transforme chaque fois. Je la poursuis jusqu’à son extrême pointe, là où, par gros temps, les vagues s’écrasent contre les rochers. J’en reviens trempé mais calmé. Et cette promenade, je l’ai faite de ma seule volonté. A toi de chercher ce qui, dans ta vie, dépendra de ta seule volonté. Ne serait-ce qu’une promenade le long de la mer. C’est ta part de libre arbitre. »

