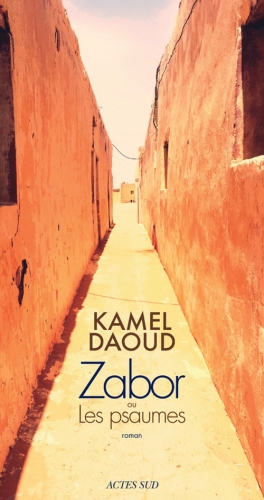Dans un style très différent de Meursault, contre-enquête, le dernier roman de Kamel Daoud, Zabor ou les psaumes est un hymne à l’écriture et à ses pouvoirs. « Ecrire est la seule ruse efficace contre la mort », c’est la conviction et le don de Zabor, fils du premier lit du boucher d’Aboukir, écarté par son père d’abord fier puis honteux de ce fils « qui n’arrêtait jamais de lire », ce qui lui vaut les moqueries de la plupart, de ses demi-frères et des enfants du village.
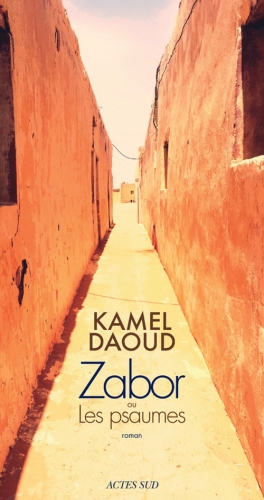
A presque trente ans, célibataire, vierge, Zabor remplit autant de cahiers que de personnes rencontrées dans la journée ou de mourants auprès de qui on l’appelle – « Car, si j’oubliais une personne, elle mourait le lendemain. » En trois parties (Le Corps, La Langue, L’Extase), Daoud raconte comment un enfant repoussé, qui vit dans une maison du bas du village avec sa tante Hadjer et son grand-père, analphabètes, affine peu à peu son rêve d’écrire en faisant l’inventaire de toutes choses puis en repoussant la mort.
« Que croire, si la vie n’était pas une épreuve imposée par un dieu qui ne parlait que notre langue, mais la conjugaison d’un verbe étranger, venu de la mer, qui sous la main d’un débile de village à la voix de chèvre parvenait à redonner la respiration aux blessés, aux enfants malades empoignés par les fièvres et aux centenaires qui parcouraient, nombreux déjà, les rues du village, avec des sourires béats de nouveau-nés ? »
Quand Abdel l’appelle au chevet de leur père mourant, Hadj Brahim, riche de ses troupeaux et de douze fils en plus de lui, Zabor désire d’abord la mort de celui qui a répudié sa mère avec lui, nouveau-né, pour mettre fin à la jalousie d’une autre épouse. Lui n’aurait pas d’enfant, « pour briser ce cycle ». Puis il accepte de se rendre une première fois auprès de lui, avec trois heures devant lui pour écrire, mais il sera interrompu et chassé.
Zabor a été sauvé du malheur par les livres et il donne le titre de ceux-ci à ses cahiers, pour exercer sa « magie douce ». Mais sa différence ne lui permet pas de se mêler aux autres, il dort le jour et sort la nuit. Seule l’écriture donne sens à sa vie, cette mission qu’il s’est donnée de tout répertorier. Il aimerait épouser Djamila, une voisine avec deux enfants que sa répudiation condamne à l’isolement chez elle, mais sa tante, jamais mariée et qui lui voue un amour absolu, cherche à l’en dissuader.
A quatre ans déjà, l’enfant, alors appelé Ismaël, a été chassé du haut du village, injustement accusé d’avoir poussé un autre au fond d’un puits. Puis tout l’a marqué comme un être à part, un malade : sa voix chevrotante, sa mémoire stupéfiante à l’école, avant d’en être renvoyé, ses évanouissements devant le sang, son refus de manger de la viande – la honte de son père.
Sur un rythme incantatoire, Kamel Daoud déroule le récit de Zabor (ce nom veut dire « les psaumes » en arabe), de ses apprentissages et de ses douleurs, de ses découvertes et de ses désirs. Tel un « Robinson arabe », il s’est détourné des manuels scolaires et des versets sacrés pour écrire sa propre langue, ivre de joie quand il a trouvé la réponse au manque de livres et de bibliothèque dans son village : il avait ses cahiers pour tout inventorier, décrire, raconter. « Le monde ne doit sa perpétuité qu’à la nécessité de sa description par quelqu’un, quelque part – c’est une certitude. »
Les mots, la langue, le livre, la calligraphie, l’encre… Tout ce qui se joue dans l’écriture est fouillé dans ce roman qui se veut chant et livre, comme un acte de liberté dans un monde d’exclusions. Obsessionnel, poétique, parfois difficile à suivre, Zabor ou les psaumes est un monologue où l’on peut se perdre sans jamais échapper à la note répétée, tantôt aiguë, tantôt grave. Un roman qui dénonce aussi la condition des femmes, l’obscurantisme religieux, le tabou de la sexualité.
Sur le site de l’éditeur, Kamel Daoud confie ceci : « J’ai écrit Zabor pour raconter mes croyances : toute langue est autobiographique. Écrire, c’est se libérer ; lire, c’est rejoindre ou embrasser ; imaginer, c’est assurer sa propre résurrection. Le dictionnaire est une escalade du sens. Mais aussi une impasse : les livres sacrés racontent la chute mais ne disent rien du goût du fruit défendu. La langue est dans l’antécédent du mot : le goût. C’est aussi le but de cette fable, rappeler cette hiérarchie.
L’idée était de sauver la Shéhérazade des Mille et Une Nuits et de reposer la plus ancienne des questions : peut-on sauver le monde par un livre ? Vieille vanité à laquelle le dieu des monothéismes a cédé quatre ou cinq fois. »
Dans un entretien à RTL, l’écrivain algérien qui donne là un roman très personnel, où la fiction porte ses questions fondamentales, se dit « né dans un monde où le statut de la langue a changé, où c’est l’arabe qui est devenu langue de coercition, de violence contre les libertés et le corps et une langue de mort. » Le français est devenu sa « langue de dissidence ».
 « Tu écris ce que tu vois et ce que tu écoutes avec de toutes petites lettres serrées, serrées comme des fourmis, et qui vont de ton cœur à ta droite d’honneur.
« Tu écris ce que tu vois et ce que tu écoutes avec de toutes petites lettres serrées, serrées comme des fourmis, et qui vont de ton cœur à ta droite d’honneur.